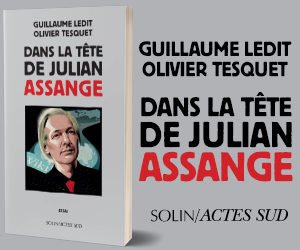L’envers du décor – à propos de La Figurante de Pauline Klein
Dans Essai sur le lieu tranquille (Gallimard, 2014), Peter Handke raconte qu’adolescent, les toilettes lui servaient de refuge, lorsque vivre au milieu des autres s’avérait insurmontable. Camille, l’héroïne de Pauline Klein dont vient de paraître le quatrième roman, a elle aussi besoin d’abris : « Le seul endroit où se dessinait un territoire dans lequel je serais capable de gouverner ma vie prendrait racine dans les marges, dans les caves, dans les toilettes d’endroits officiels où l’on entendait résonner les voix d’autres que moi. »
C’est d’ailleurs la cave d’une galerie d’art parisienne qui lui sert de capsule de protection. Camille n’aspire pas à remonter à la surface pour monter en grade professionnellement. Rester en bas, se faire oublier lui convient. Elle archive des œuvres contemporaines enveloppées de papier bulle. Tenir le greffe des noms de peintres sans intérêt mais boursouflés de leur fausse importance, c’est inutile ou presque, la narratrice le sait et elle s’en moque, pourvu qu’elle reste à l’abri des regards : « J’arrivais le matin avec le sentiment d’être finalement digne de la tâche pourtant ingrate qui m’était demandée. »
Comme les précédents livres de cette auteure née en 1976, La Figurante se pose avec intelligence et avec une ironie indolente des questions essentielles : comment en venons-nous à inventer un sens à notre existence, à endosser un costume (de garçon de café comme disait l’autre) ? Pourquoi se « faire une vie » alors qu’on « gît mollement dans un segment d’espace-temps » ? Parce que si l’on ne ment pas comme on respire, on croupit, on s’éteint, on s’écrase. Il faut donc se payer de mots, de gestes et de postures pour avoir une place. Pour supporter ces concessions à la médiocrité, moquons-nous-en. C’est ce que fait la singulière et talentueuse Pauline Klein dans ses livres.
La Figurante est une étude de mœurs où ironie grinçante et douce mélancolie sont indémêlables.
La Figurante dresse l‘autoportrait de la narratrice, la trentenaire Camille Tazieff, à travers des saynètes qui la mettent en présence de caractères parisiens et de notre temps : sa mère, célibataire, étouffante, désireuse pour sa fille unique d’ascension sociale, après l’avoir élevée en jonglant avec des fins de mois compliquées ; la directrice snob et radine d’une galerie d’art, une copine qui ouvre son cabinet de psychologue où la consulteront nos enfants malades ; enfin le fils adulte et gâté (à tous points de vue) de richissimes Libanais, installés dans un XVIe arrondissement taillé pour les neurasthéniques. S’y ajoutent quelques étrangers, notamment le directeur d’une galerie d’art new-yorkaise, pervers et glacial à la manière du héros du film Shame, de Steve McQueen.
Camille, femme gauche (qui n’est pas particulièrement de gauche), lucide et drôle, nous prend à témoin de sa difficulté à adhérer au monde tel qu’il est et qu’elle décrypte. Elle en comprend le mode d’emploi, mais refuse de jouer. Les conséquences de sa tendance à l’apathie ne sont pas dramatiques, mais handicapantes : Camille gagne peu d’argent, a peu d’amis, et par période une vie sexuelle et sociale d’un calme plat. Elle n’est pas pour autant la réplique contemporaine de Bartleby puisqu’elle a de l’humour et quand elle s’y met, du succès auprès des hommes.
Enfin le roman de Pauline Klein, contrairement à la nouvelle de Melville, ne se termine pas de façon tragique. La Figurante est une étude de mœurs où ironie grinçante et douce mélancolie sont indémêlables. Camille et Pauline Klein se ressemblent peut-être : il arrive à la narratrice d’émettre des considérations sur la littérature et l’écriture : « Si chaque être humain était aussi potentiellement un texte, il y avait des vies plus intéressantes que d’autres. » Ou encore, lorsque Camille verse de l’eau chaude dans son bain : « Je me faisais bouillir moi-même, c’est avec ce type de métaphore que se forma sans doute mon impression de devenir un genre d’écrivain. »
La Figurante est un roman comique dans lequel s’enchâssent d’autres romans comiques.
Camille est un électron libre qui peine à embrasser le monde : « Être de la fête m’était toujours apparu comme une sorte de cauchemar (…) Je n’avais jamais ressenti le besoin d’apporter “ma pierre à l’édifice” ». La Figurante pointe et épingle plusieurs expressions toutes faites et à la con. De chaque situation, Camille saisit avec précision le ridicule.
En prenant du recul, comme si elle sortait de son corps, elle commente ce qui se passe et que l’on attend d’elle, qu’elle consent à offrir le plus souvent. Voici la scène de sexe que lui mitonne Geoffrey, patron de restaurant qui roule des mécaniques et l’emmène le premier soir de leur rencontre dans son appartement : « Il faisait partie de ces hommes qui avaient décidé de faire l’amour en attaquant le corps de l’autre comme une petite troupe armée. Une petite troupe tétanisée à l’idée de perdre la guerre. Je fus un peu déroutée lorsque je le vis se ruer vers moi, singeant l’énergie du désespoir, alors qu’il me semblait limpide que j’étais, à cet instant de notre histoire, du « tout cuit ». Geoffrey me flanqua contre son grand lit douillet, un lit fait avec une telle coquetterie qu’il ne présageait rien de bon en termes de sexualité. Mais nous étions chez lui, et je le vis mettre en place une forme de violence ratifiée, dans le cadre animal d’une torture sexuelle autorisée. Il me cambra le dos, m’écartela les côtes et les cuisses, me colla les genoux derrière la nuque (je fus moi-même surprise d’avoir gardé une telle souplesse) avant de m’attraper le bassin et de me faire glisser sur le sol, où je finis à quatre pattes sur le tapis râpeux. »
La Figurante est un roman comique dans lequel s’enchâssent d’autres romans comiques. Car avant Geoffrey, Camille entretient à New York une liaison avec Michael, un modeste employé de la banque Lehman Brothers. Il est collant mais Camille le ménage pour qu’il ferme les yeux sur son compte largement déficitaire. Afin d’arrondir ses fins de mois à Manhattan, Camille, en dehors de son travail dans une galerie d’art collabore à SmartSex, une entreprise de services érotiques par téléphone. Elle ne tient pas les échanges qu’elle a avec les hommes pour sordides, elle leur trouve un intérêt.
Les piques que Pauline Klein lance contre l’air du temps ou les faiblesses intemporelles ne freinent ni la curiosité, ni le désir d’aventures de son personnage.
Ni victime, ni bulldozer, Camille est une observatrice sensible et solide. L’un des clients de SmartSex, qu’elle écoute davantage qu’elle ne lui parle, manifeste un goût pour les métaphores : « Il se plaignait que tout soit fermé à l’heure du déjeuner alors qu’il avait envie d’une bonne grosse viande ; à la poste, la queue était énorme entre midi et deux ; il allait acheter des légumes pour se faire une purée. Progressivement, cette immersion dans la sexualité masculine contamina aussi mes horaires de bureau à la galerie. » Excitée par ce métier parallèle, Camille devient une spectatrice assidue de YouPorn.
Pauline Klein, qui a travaillé comme son héroïne dans une galerie d’art new-yorkaise, ne s’enferme pas dans une spirale d’aigreur. Les piques qu’elle lance contre l’air du temps ou les faiblesses intemporelles ne freinent ni la curiosité, ni le désir d’aventures de son personnage. « L’Amérique sert aussi à ça, à rapporter des traces qui ne nous appartiennent pas tout à fait pour se rendre un peu plus spectaculaires » : de retour en France en 2008, juste après la crise des subprimes, Camille joue les initiées en livrant son diagnostic sur la situation économique outre-Atlantique : « Ainsi va la vie concluais-je en regardant ailleurs. »
La Figurante promène son miroir et reflète de grands sujets, de grands problèmes : la conjugalité, la vieillesse (« J’avais pensé dur comme fer vivre avec l’inconnu devant moi. Mais plus je vieillis, plus l’avenir se resserre dans une épatante prévisibilité. »), la sexualité, le travail et la domination ou encore : la domination sexuelle au travail.
La narratrice de Fermer l’œil de la nuit, le deuxième roman de Pauline Klein, ressemblait à Camille : elle était à la fois encombrée de maladresses et aérienne.
Camille met en scène cette articulation dans quelques saynètes rapportées de son enfance : « Dans les jeux que j’imaginais, j’étais généralement directrice internationale. J’avais des talons et le sentiment de pouvoir que me procurait mon déguisement de chef – donner des ordres avec une bienveillance choisie à une équipe de poupées soumises – était systématiquement associé à une certaine excitation. Je ne violais jamais à proprement parler mes poupées, bien sûr, je me contentais de leur caresser les cheveux et de les tripoter gentiment en m’arrêtant à temps, je connaissais les limites. » Il lui arrivait aussi d’emmener des condisciples filles dans les toilettes (décidément) : « C’est à l’école élémentaire que j’ai ressenti sans en avoir conscience les premiers liens entre l’amour et les classes sociales. »
Les lieux sont un motif récurrent de La Figurante. Il y a l’appartement minuscule dans lequel Camille habitait quand elle était enfant, celui gigantesque où son amant libanais la baise, la voiture dans laquelle elle roule en compagnie de sa future belle-mère et de son futur époux et dans laquelle elle a « l’impression d’être une petite chienne », abandonnée aux (mauvais) soins de ses maîtres.
La narratrice de Fermer l’œil de la nuit (Allia, 2012), le deuxième roman de Pauline Klein, ressemblait à Camille. Elle était à la fois encombrée de maladresses et aérienne. A la recherche d’un logement, elle répondait à une annonce : « Je vois que l’immeuble est en pomme de terre. C’est solide, ça ? L’agent immobilier avait marqué un temps d’arrêt avant de me répondre que PDT c’était pour pierre de taille. » La Figurante charrie cette même légèreté, cette même naïveté intelligente. C’est un roman sur l’injonction à se faire une place dans la vie, et sur les cachettes que l’on se trouve pour se reposer de jouer un rôle.
Pauline Klein, La Figurante, Flammarion, 208 pages.