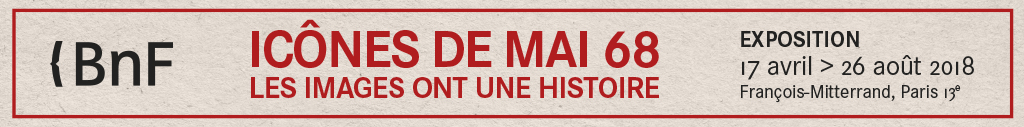Accès à l’université : les réformes de l’angoisse
L’écrivain Georges Perec pensait que les murs des villes éclairent plus sur l’état d’une société que de longs discours. En ce Printemps 2018, la découverte d’affiches publicitaires vantant les mérites de produits pharmaceutiques à destination des étudiants ne pourra manquer d’illustrer sous un jour nouveau les enjeux de la réforme de l’accès à l’enseignement supérieur, portée depuis l’automne 2017 par le gouvernement de M. Edouard Philippe.
Que voit-on sur ces affiches ? Affalée devant sa copie, l’air fourbu et harassé, une jeune candidate s’apprête à présenter un concours. Elle se voit soutenue dans cet effort qui semble insurmontable par la patte puissante d’un lion, qui lui apporte une boîte de cachets de type anxiolytiques. Le message transmis est on-ne-peut-plus-clair : en période d’examen, le médicament offre un soutien aussi utile qu’adéquat à la gestion du stress, et s’impose donc comme une condition à la réussite scolaire.
Chaque année, les troubles anxieux et la phobie scolaire représenteraient environ 5 % des consultations en pédopsychiatrie.
Une telle proposition suppose que l’angoisse puisse être traitable par voie chimique. Elle suppose également que le désordre dont elle est le symptôme soit le produit de sa psyché, c’est-à-dire d’un désordre interne et hautement individuel. Les troubles anxieux et la phobie scolaire ne sont bien sûr pas un phénomène nouveau dans le monde éducatif. Chaque année, ils représenteraient environ 5 % des consultations en pédopsychiatrie, sans que les chiffres sur cette question ne soient très étayés.
Or, depuis les travaux pionniers d’Émile Durkheim sur le suicide, on sait que l’anxiété n’est pas seulement le fruit d’un fonctionnement psychique propre à chaque individu, mais également le produit d’une organisation sociale et institutionnelle. Lorsque les règles et les conventions qui organisent l’ordre social disparaissent, ou lorsque l’on n’y croit plus, l’individu se confronte à une situation d’incertitude –