Les sciences sociales sont-elles scientifiques ?
Les sciences humaines et sociales (disons ici « sciences humaines » ou SHS) sont-elles des sciences ? Si oui, de quelle sorte ? Peuvent-elles énoncer des lois ? À quelles conditions ? Bernard Lahire [1] a eu le mérite de se poser ces questions et de relancer une discussion plus que jamais nécessaire. Malgré l’absence de cumulativité théorique, l’éparpillement et la pluralité théorique de ces disciplines, Lahire pense qu’il leur est possible d’énoncer des principes généraux, des invariants, des constantes, des régularités et des fondamentaux qui traduisent des propriétés objectives du réel.
Dans leurs commentaires à ce texte et dans de nombreuses et pertinentes remarques, Jean-Louis Fabiani [2] et Jean-Pierre Olivier de Sardan [3] opposent à ce retour optimiste du positivisme l’empirisme irréductible de savoirs qui ne peuvent jamais espérer être nomothétiques, mais qui peuvent revendiquer la rigueur de la description, un comparatisme modéré et l’énoncé d’hypothèses seulement plausibles. C’est déjà pas mal. Une chose est certaine, les sciences sociales ne sont pas expérimentales. Ce sont des sciences d’observation, pas très différentes de ce que pouvaient être la zoologie ou la botanique à leurs débuts.
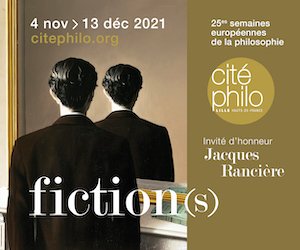
Bernard Lahire pose cependant deux constats qui me semblent entièrement justes. D’abord que les sciences humaines et/ou sociales (notamment la sociologie, l’ethnologie, l’histoire, la préhistoire, les sciences économiques et politiques, la démographie, la géographie humaine) sont en fait une seule et même science et que les parois disciplinaires qui les séparent sont strictement des artefacts institutionnels non scientifiques et des traditions disciplinaires arbitrairement séparées. Ensuite, que si l’on veut trouver un cadre général d’explication, il faut se donner pour objet l’ensemble des sociétés humaines, prémodernes et modernes, ainsi que le proposait à juste titre Alain Testart, cité par Lahire.
Mais surtout, Bernard Lahire fait intervenir une troisième
