Une science sociale ? En réponse amicale à Bernard Lahire
L’ambitieux programme esquissé par Bernard Lahire dans son récent manifeste pour « la » science sociale, présentée au singulier, sonne comme une rupture avec un ensemble de réflexions épistémologiques qui ont marqué les sciences historiques et sociales depuis près d’un demi-siècle. Les remarques qui suivent n’entendent pas porter un jugement sur la fécondité et la faisabilité de ce projet : ses conditions de félicité dépendent selon l’auteur de l’existence de réunions mensuelles d’un groupe privé (le groupe Edgar Theonick, conçu à l’image du groupe de mathématiciens Bourbaki) et du soutien « enthousiaste » d’une maison d’édition, La Découverte. Le lecteur n’en saura pas plus. On ne peut que souhaiter le meilleur à l’entreprise et l’on est curieux de voir ses premiers résultats.
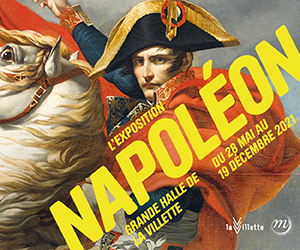
Parmi les points positifs du manifeste, on doit signaler l’ouverture aux sciences cognitives et aux sciences biologiques pour rendre compte du comportement humain en général : il s’agit d’une rupture évidente avec les excès du constructionnisme social et les historicisations excessives qui ont accompagné l’institutionnalisation en France de la sociologie : celles-ci ont servi trop souvent de bréviaire idéologique à des travaux répétitifs et sans imagination. Sur ce point, Bernard Lahire prend, au moins implicitement, ses distances avec un ensemble de positions largement répandues, qu’on pourrait dire « sociocentristes », et qui font du déterminisme social la clé de toutes les analyses.
On peut ajouter le fait que, si l’on veut mettre au jour les invariants du comportement humain dans leur dimension transhistorique, entreprise tout à fait légitime, on est inévitablement conduit à faire passer au second plan la problématique de « l’homme pluriel » que l’auteur a défendu naguère avec succès[1].
Venons-en à la rupture qu’envisage Bernard Lahire. Il enterre en n’en parlant pas deux ouvrages qui ont eu un rôle prééminent dans les sciences sociales au cours des dernières décennies. Le premier est évidemment le Raisonnement sociologique de Jean-Claude Passeron, dont la première édition a exactement trente ans (1991)[2]. Le second est celui de Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe (2000), dont on vient de célébrer les vingt ans dans le monde entier.
On ne saurait confondre ces deux points de vue avec l’atmosphère post-moderniste qui a fait florès au cours du dernier demi-siècle (« il n’y a pas de faits, il n’y a que des interprétations ») : je suis bien d’accord avec l’auteur du manifeste pour tenter de sortir collectivement de ce marécage idéologique. La question est ici d’un autre ordre.
L’interprétation sociologique du rêve nomologique
Pour l’éclairer, il convient de faire un détour par un sociologue qu’on ne pourrait suspecter ni de relativisme ni d’anarchisme épistémologique, Raymond Boudon. Dans un de ses ouvrages majeurs, La place du désordre[3], il critique le préjugé nomologique, « selon lequel l’objectif incontournable de la connaissance scientifique serait de produire des énoncés empiriques de validité universelle » (p. 74).
La critique s’appuie sur le fait que ce que nous appelons « lois » à propos du monde social s’applique uniquement à des conjonctures historiques particulières, que leur domaine de validité ne peut être jamais circonscrit et que l’on ne peut énumérer l’ensemble des conditions qui pourraient confirmer l’applicabilité universelle de la loi. Pour dire les choses simplement, parler en termes de lois universelles est un abus de langage, parce qu’on efface dans leur énoncé le fait qu’elles sont toujours fondées sur des assertions de possibilité (si A, alors possiblement B) ou de probabilité (si A, alors probablement B). Boudon est donc conduit, dans le cadre d’un raisonnement de type poppérien, ce qui suffit à le distinguer de Jean-Claude Passeron, à parler de « conjectures ».
La dimension conjecturale de nos savoirs ne conduit évidemment pas à renoncer à l’identification (et la réplicabilité) de mécanismes sociaux fondés sur le constat de régularités et à travailler en vue d’affiner ses conjectures. Nous ne sommes pas condamnés à demeurer arrimés à un contexte singulier et à nul autre pareil.
Bien au contraire, nous ne cessons d’apparier des contextes ou de les confronter pour les contraster, sous la forme d’un comparatisme dont Émile Durkheim, Marc Bloch et Jean- Claude Passeron ont bien montré qu’il constituait l’espace unique au sein duquel nos savoirs pouvaient être mis à l’épreuve – ou, pour parler comme le premier, l’espace qui pouvait offrir une situation « quasi expérimentale ». Bernard Lahire le sait fort bien, lui qui a construit sa réputation sur une critique bien fondée de la Distinction de Bourdieu en mettant au jour ce qu’il appelle justement les « dissonances individuelles », qui infirment la loi d’airain de la distinction[4].
Alors que je m’apprête à fêter cinquante de sociologie, je voudrais apporter une contribution plus modeste à la réflexion aujourd’hui nécessaire sur l’état des sciences sociales[5]. Il nous faut partir de ce qu’Olivier Schwartz appelait « l’empirisme irréductible[6] » de nos savoirs et qui impose la plus extrême prudence à propos des « ambitions excessives[7] » (le terme est de Jon Elster) qui affectent nos disciplines comme une sorte de maladie infantile toujours renouvelée : nous les considérons éternellement comme des sciences « jeunes » – même si, comme le dit justement Jean Baechler, Aristote est le père fondateur de la sociologie (j’y ajoute volontiers Ibn Khaldoun).
Nous devons accueillir avec circonspection les promesses, fréquentes depuis Auguste Comte (que pense à ce propos Bernard Lahire de la loi des trois états ?) d’une science sociale déterministe qui aurait le dernier mot. Nos placards sont remplis de lois qui sentent un peu la naphtaline (Lahire souscrirait-il aux lois de l’imitation de Gabriel Tarde ?). J’ai montré que l’impossibilité pour Bourdieu d’établir une théorie générale des champs ne rendait pas vaines pour autant les analyses en termes de champ, que j’ai moi-même pratiquées régulièrement, pour peu qu’on circonscrive de manière réaliste leur domaine de validité[8].
Le réalisme critique est une bonne manière de définir ce que nous pouvons attendre des sciences sociales. Nous devons les analyser telles qu’elles sont et non pas telles que nous pensons qu’elles devraient être. Cela ne veut pas dire qu’elles n’aient pas d’ambition théorique, puisque leur projet, de part en part scientifique, consiste à repérer des régularités dans le comportement des individus en interaction avec d’autres, puis de construire ce qu’on appelle des modèles de l’action ou identifier des mécanismes sociaux que l’on va pouvoir appliquer à des situations diversifiées dans l’espace et dans le temps.
Au cours de son histoire mouvementée, la sociologie n’a jamais réussi à produire quelque chose comme un paradigme unifié, au sens que donnait Thomas Kuhn à ce terme pour la physique[9]. La discipline a toujours fait preuve d’une exubérance épistémologique qui l’éloigne du modèle des sciences de la nature : elle est volontiers querelleuse et oscille en permanence entre le souci de fonder la société en raison et la volonté de la subvertir de fond en comble.
La première attitude est celle qu’on peut voir dans l’entreprise de Durkheim, dont l’œuvre ne peut pas se comprendre sans référence à la constitution et à la consolidation de l’État au cours de la première partie de la Troisième République ; c’est ce qui apparaît aussi nettement dans la théorie de l’action sociale de Talcott Parsons entre 1940 et la fin des années 1960 aux États-Unis. La mission de la sociologie y est définie comme la recherche du fonctionnement sans à-coups (smooth functioning) de la société. Dans les deux cas, il s’agit de prévenir les crises ou les pathologies et de veiller à la bonne organisation de la société à partir d’un diagnostic scientifique.
Tout autre est la posture de la sociologie critique, qui comme son nom l’indique, s’efforce de mettre au jour les éléments implicites, les formes de méconnaissance, de refoulement ou d’aliénation qui ont pour conséquence le fait que les individus sont agis plutôt qu’ils n’agissent.
Dans le premier cas, le consensus est l’objectif de la sociologie. Dans le second, c’est autour du conflit et des luttes sociales que le dispositif d’analyse est construit. Le projet d’ensemble s’apparente ici à celui de Marx, qui confiait au savoir le soin de transformer le monde en recherchant l’émancipation.
Au cours du dernier demi-siècle, la sociologie critique a semblé dominer la scène, en partie parce que la discipline a perdu tout espoir d’hégémonie sur les autres sciences sociales. L’économie, le droit et à un moindre degré la science politique ont pris le dessus comme savoirs destinés à conseiller le Prince.
Au cours du dernier quart de siècle, les ambitions des sciences sociales ont été quelque peu mises à mal par la multiplication des études sur différents objets sociaux : les études de genre sont les plus connues, mais d’autres n’ont cessé de se multiplier et d’être institutionnalisées dans des enseignements et des programmes doctoraux (études noires, études juives, études culturelles et même études corses). La plupart des groupes ethniques ont ainsi leur spécialité universitaire : c’est une manière de voir confirmer sur le terrain savant l’existence sociale de ces groupes, une forme de reconnaissance ou de légitimation. Il y a même aujourd’hui des études sur les sourds (deaf studies). La liste est inépuisable : il suffit qu’un groupe s’efforce de vouloir convaincre de l’importance de son existence et aussi de la stigmatisation dont il est l’objet pour qu’il trouve à terme un débouché universitaire.
Le résultat est double : d’un côté nos connaissances à propos de groupes dont la visibilité sociale est mal assurée augmentent considérablement. Une multitude de nouveaux problèmes sociaux apparaissent qui suscitent l’intérêt du chercheur : les études de genre ont été à l’origine d’un considérable enrichissement et surtout d’une réorientation radicale de la manière dont nous approchons nos objets de recherche. D’un autre côté, la multiplication des études ouvre la voie à une fragmentation des savoirs sur le social.
Le danger est que la recherche en sciences sociales finisse par s’identifier aux intérêts d’un groupe et que les sociologues ne soient pas autre chose que des militants ou des activistes. D’où viendrait alors la légitimité de leur savoir ? Notre ambition demeure de voir notre discipline reconnue dans sa légitimité en tant qu’elle peut faire reconnaître des assertions qu’on peut définir comme vraies ou fausses, en les appliquant de manière probabiliste à des ensembles bien configurés du monde social.
Plaidoyer pour Jean-Claude Passeron
Contrairement à ce que semble conclure Bernard Lahire, qui connaît très bien le travail de ce sociologue, il me semble prématuré d’enterrer l’entreprise épistémologique de Jean-Claude Passeron.
Le point de départ de la description épistémologique qu’il a produit réside dans l’historicité de l’objet des sciences sociales. Leur base empirique commune n’est autre que le cours historique du monde. La nature de cet objet empirique commande l’ensemble des particularités épistémologiques de ces disciplines.
Les conditions de prélèvement de l’information sur le monde déterminent la nature des énoncés des sciences historiques : pour que l’on puisse dire s’ils sont vrais ou faux, il est impossible de les désindexer des contextes dans lesquels les informations sont prélevées. La mise en rapport de variables dans les constructions statistiques n’échappe à cette obligation que pour autant qu’elle abandonne le projet d’énoncer quoi que ce soit sur le monde historique.
Ceux qui oublient cette contrainte ne font que produire l’illusion que les variables sociologiques comme le sexe, l’âge ou l’appartenance à un groupe social sont identiques aux variables de la physique. Le statut des sciences historiques a une inévitable conséquence sur la nature de leurs énoncés : « Il n’existe pas et ne peut exister de langage protocolaire unifié de la description empirique du monde historique[10]. »
Plus qu’à la culture sur brûlis, la sociologie peut être comparée à un conservatoire botanique où l’on s’attache à maintenir en vie de très anciennes espèces tout en en observant – pas très souvent – de nouvelles.
Il y a pire : selon Jean-Claude Passeron, la cumulativité des résultats de la sociologie (c’est-à-dire l’accroissement du savoir par addition de nouveaux domaines ou de nouveaux objets ou par changement de paradigme et révision d’ensemble de nos schèmes d’interprétation du monde) est logiquement exclue, dans la mesure où les énoncés qui ne s’inscrivent pas dans un même paradigme ne sont cumulables ni contradictoires entre eux.
Ce point de vue est excessif. La coexistence de plusieurs langages théoriques de description du monde social, parfois au sein de la même recherche, est incontestable, mais nous finissons par nous comprendre plutôt bien. S’il n’y pas de progrès visible en sciences sociales, s’y maintient au cours du temps la volonté de produire et d’affiner nos schèmes explicatifs. La propriété des grandes œuvres de la sociologie est de créer des espaces de controverses qui ne cessent d’être alimentées par de nouvelles enquêtes. Ainsi La Distinction de Pierre Bourdieu est peut-être plus intéressante par les débats qu’elle suscite à propos du concept de légitimité culturelle que par le portrait qu’elle dresse de la France des années 1960.
Le caractère dominant, à un moment donné de l’histoire, de certaines conceptualisations, qui connaissent un succès plus grand que d’autres, et qui peuvent se trouver en situation quasi monopolistique, n’est-jamais uniquement imputable à un effet d’imposition ou de mode. Il existe certes dans nos disciplines ce qu’on pourrait appeler des effets d’orthodoxie – et plus récemment des effets de marketing – qui donnent une vaste audience à des théories fort peu compréhensibles du grand public. Mais n’y a pas que des rapports sociaux de force entre les théories, rapports dans lesquels les plus assurées de vaincre ne seraient pas nécessairement les plus fécondes sociologiquement.
Jean-Claude Passeron utilise la métaphore de l’agriculture sur brûlis successifs pour qualifier le mode de développement historique de la sociologie : cette analogie semble suggérer que l’innovation a toujours lieu sur des terres vierges, ce qui ne correspond pas à la réalité des « traditions sociologiques » que met au jour Randall Collins et qui crée un système de relations conceptuelles entre pairs aussi bien qu’entre générations et ne cesse de reprendre des motifs et d’effectuer des variations sur des thèmes. Plus qu’à la culture sur brûlis, la sociologie peut être comparée à un conservatoire botanique où l’on s’attache à maintenir en vie de très anciennes espèces tout en en observant – pas très souvent – de nouvelles.
La nécessaire déprovincialisation de « la » science sociale
J’en viens maintenant au silence de Bernard Lahire relatif à l’ébranlement du socle non questionné sur lequel nos savoirs se sont constitués. Mon point de vue sur ce point est tout sauf radical : il n’est pas question de jeter le bébé des sciences sociales avec l’eau du bain de la critique de l’eurocentrisme ou de l’occidentalisme.
Il s’agit simplement de dire qu’on ne peut plus simplement faire comme si cette critique n’existait pas. Si le passé de la sociologie n’est en rien un passé criminel, il n’en reste pas moins que notre point de vue reste largement informé par les origines de la sociologie, née à un moment où l’Europe dominait le monde. On ne peut qu’adhérer au projet de provincialiser l’Europe développé en 2000 par Dipesh Chakrabarty[11]. Ce livre est une source fondamentale pour les études postcoloniales.
L’auteur défend l’idée selon laquelle les théories sociales occidentales sont à la fois « indispensables et inadéquates » si l’on veut penser tout ce qui n’est pas l’Occident. Il critique avec vigueur les illusions de l’évolutionnisme qui veut que toutes les sociétés passent par toutes les étapes d’un itinéraire identique. Il n’y a pas de chemin unique, pas plus que de hiérarchie des civilisations.
Une des faiblesses des sciences sociales tient au fait qu’elles ont pris naissance dans des sociétés fortement sécularisées, et que de ce fait elles n’ont pas prêté suffisamment attention à la question religieuse, qui demeure au centre de la plupart des sociétés non-occidentales. On le constate sans peine aujourd’hui. Les chercheurs tendent ainsi à prendre comme allant de soi le concept marxiste de conscience de classe pour analyser les travailleurs indiens, ce qui revient à négliger une large part de la conscience de ces personnes.
Chakrabarty nous confirme que nous ne sommes qu’une péninsule à l’Ouest de l’Asie. Il nous dit surtout que l’Europe n’est pas seulement une région géographique mais un mode de production des connaissances qu’il faut soumettre à l’examen. C’est une nouvelle tâche sur l’agenda des sociologues que personne, y compris les plus ambitieux, ne peut esquiver.
Les fausses promesses de l’unité
Je termine par une question qui mériterait un débat plus long. Dans un texte les plus connus de la nouvelle histoire des sciences, Peter Galison montre de façon très convaincante que « la science est désunie (disunited) et – à l’encontre de nos premières intuitions – c’est précisément la désunification de la science qui fait sa force et sa stabilité[12] ». Il montre que les formes de travail scientifique, les modes de coopération et les attachements ontologiques sont tous différents au sein des nombreuses traditions qui composent la physique à n’importe quel moment du XXe siècle.
Bien que Galison travaille principalement sur la physique, on peut considérer que son point de vue est susceptible d’affecter la manière dont nous concevons le mode de production des savoirs produits par les sciences sociales. La recherche à tout prix de l’unité a quelque chose de fantasmatique. L’activité scientifique est toujours plus désordonnée que ce qu’en disent les vieux manuels d’épistémologie.
Il faut savoir gré à Bruno Latour d’avoir, avec d’autres, rendu possible l’ethnographie de l’activité scientifique, au plus loin de l’épistémocentrisme qui sévit souvent parmi les chercheurs en sciences sociales. Souvent méprisés socialement – la sociologie est une discipline paria, disait Bourdieu – nous tendons souvent à nous grandir par l’exhibition de nos prouesses théoriques, et particulièrement par la promesse jamais réalisée d’une théorie générale. L’abandonner nous coûte souvent beaucoup, ce qui ne m’empêche pas de souhaiter bonne chance à Bernard Lahire dans sa nouvelle entreprise.
