Qui a peur de la déconstruction ?
« Je serai bref. »
Jacques Derrida
Si, selon la promesse bien connue d’Andy Warhol, chaque individu pourra désormais aspirer à connaître son quart d’heure de célébrité, le débat public français semble avoir inventé depuis peu la minute d’infamie. À la bourse des noms d’oiseaux, les valeurs sont devenues singulièrement volatiles : la « peste intersectionnelle » évoquée tantôt par Raphaël Enthoven est devenue un lointain souvenir, « l’islamogauchisme » dont s’inquiéta la Ministre de l’Enseignement Supérieur se trouve désormais relégué au rang de vestige, le « woke » déjà s’infléchit en « wokisme », cependant qu’une nouvelle venue accapare les regards : la déconstruction.
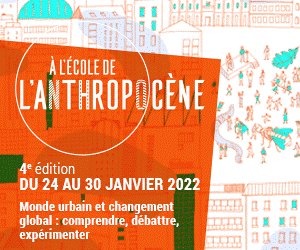
On sait qu’elle fit l’objet les 7 et 8 janvier d’un étrange rassemblement en Sorbonne intitulé « Après la déconstruction : reconstruire les science et la culture », où Jean-Michel Blanquer appela d’entrée de jeu à « déconstruire la déconstruction » ; mais on peut noter aussi son apparition discrète au bas du programme de la candidate Valérie Pécresse, dont les propositions en matière de politique culturelle énoncées le 11 janvier se clôturent par cet étrange engagement : « ne pas déconstruire l’histoire en déboulonnant les statues » ; formulation qui, avancée sur le même plan que le projet d’instauration d’un taux de TVA à 5,5 % sur les biens culturels, fait un effet un peu criant.
Intersectionnalité, islamogauchisme, woke, wokisme, déconstruction. Dans ce jeu de substitutions, et même si l’on croit comprendre qu’il s’agit chaque fois d’alerter sur les conséquences néfastes des formes aujourd’hui empruntées par l’antiracisme, le féminisme et plus généralement l’analyse des systèmes de relégation et de stigmatisation institutionnels ou culturels, un étrange papillotement paraît affliger la désignation de cet adversaire polymorphe : là où la généralité d’un terme est d’ordinaire gage de sa longévité (puisque son imprécision le soustrait alors au démenti du réel), tout se passe comme si le flou
