La politique des appariements algorithmiques
À la mi-juillet, les résultats de la phase principale de Parcoursup indiquaient que près de 94 000 candidats étaient toujours en attente d’une formation dans le supérieur, tandis que 100 000 places étaient encore disponibles[1]. La gigantesque opération de tri que constitue Parcoursup n’avait pas alors trouvé de paires mutuellement compatibles pour environ 17 % des candidats. Quels sont les enjeux sociaux et politiques soulevés par ce type d’opérations d’appariement de grande ampleur ?
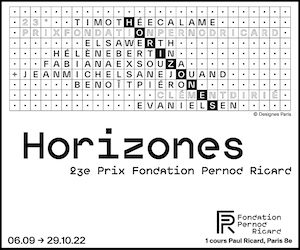
S’il retient légitimement l’attention à l’aube d’une nouvelle année universitaire, Parcoursup n’est pas le seul dispositif concerné par le phénomène de l’appariement (le matching). L’appariement constitue une modalité singulière d’allocation de ressources cruciales pour les parcours de vie : un logement, un partenaire, une formation, un emploi, un traitement médical. En outre, l’appariement ne s’embarrasse pas de la frontière entre le domaine privé lucratif et le domaine public : on le retrouve à la fois dans le monde marchand classique, et dans le monde de l’administration publique des ressources. Cet article souligne quelques enjeux analytiques de l’appariement, et propose trois points de discussion sur ses conséquences politiques.
L’appariement
Les dispositifs d’appariement consistent à « faire des paires » entre des individus, ou entre des individus et des ressources (une formation, un logement, un traitement médical ou un emploi par exemple). Ces paires sont réalisées selon un principe de double compatibilité : une paire est formée entre deux individus a et b lorsque a préfère b à tout autre appariement possible, et que b préfère a à tout autre appariement possible. On choisit et on est choisi en même temps. Lorsque qu’il s’agit de paires entre des individus et des ressources, l’expression des préférences des ressources sur les individus provient d’une institution ou d’une organisation : dans le cas de Parcoursup, par exemple, des commissions pédagogiques sont en charge
