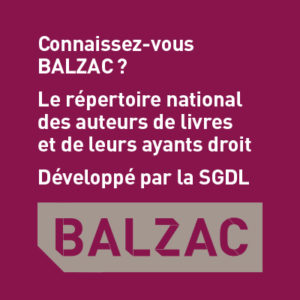Justice terroriste, l’exception du quotidien
« Procès Jawad », « Procès Abdelslam », depuis deux semaines les agendas judiciaires ont ouvert les premières étapes du long chemin d’audiences qui mènera aux jugements des attentats du 13 novembre 2015. Les logiques judiciaires, médiatiques et politiques qui ont accompagné ces deux procès, l’un à Paris et l’autre à Bruxelles, exposent aux yeux des opinions publiques des scènes judiciaires terroristes singulières. Plus de trois cents journalistes accrédités pour le « procès Abdelslam », autour d’une centaine pour le « procès Jawad ». Des accusations juridiques qui interrogent : « violence contre policiers » ou « terrorisme » pour Abdelslam, « recel » ou « participation » à un groupe terroriste pour les « logeurs » du 13 novembre. Dans ce dernier dossier, dont le verdict sera prononcé le 14 février, plus de six cents personnes se sont constituées parties civiles en tant que victimes directes ou indirectes des attentats et de l’arrestation quelques jours plus tard à Saint-Denis de deux des auteurs, Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh. Si la plupart des magistrats et certains avocats, y compris des victimes, ont répété durant dix jours que ces procès n’étaient pas ceux du 13 novembre, force est de constater que dans l’espace public ces audiences sont bien considérées comme celles des événements du « 13/11/15 » qui ont conduit la France dans l’état d’urgence permanent.
Venant à la suite d’un autre procès fortement exposé, celui d’Abdelkader Merah (octobre 2017), ces audiences judiciaires montrent une justice terroriste dans laquelle les pressions politiques, sociales et médiatiques s’affichent quotidiennement, entre silence des accusés (« procès Abdelslam ») et prises de parole intempestives voire considérées comme provocantes (« procès Jawad », « procès Merah »). Dans cet environnement, la compréhension du droit pénal et de ses spécificités en matière terroriste donne lieu le plus souvent à des commentaires loin des considérations et vérités juridiques. Comme l’explique en audience un avocat : « Tout le monde devient juriste mais sans connaître le droit et ses règles ! » (A, octobre 2017). Ces procès offrent un regard important sur la scène judiciaire concernant la culpabilité et les origines de l’engagement terroriste mais aussi la place des victimes, les stratégies de la défense ou encore la couverture médiatique et politique de cette violence politique. Néanmoins, ces audiences demeurent encore difficiles à analyser avec un recul suffisant alors que seulement trois procès en cours d’assises spécialement composées ont déjà eu lieu depuis 2015 et que les prochains ne sont prévus qu’à partir de ce printemps. Par contraste, il est tout de même possible à travers ces audiences de mettre en lumière d’autres jugements qui se tiennent à la XVIe chambre correctionnelle du Tribunal de Paris, de manière quotidienne cette fois-ci et le plus souvent loin de l’exposition médiatique des jugements d’assises.
Observé depuis 2015 de façon ethnographique, les procès des revenants et velléitaires du théâtre guerrier irako-syrien permettent de comprendre que la justice pénale n’est en rien écartée des pratiques quotidiennes de la lutte contre le terrorisme et qu’elle reste centrale dans le traitement de la radicalisation idéologique et/ou violente. L’État français poursuit, juge et condamne les membres de groupes se réclamant du djihad armé dans un flux d’affaires jamais connu par la justice contemporaine. (NDLR : Toutes les citations ont été recueillies par l’auteur lors des audiences ou d’entretiens avec des magistrats. Les audiences sont notées A et les entretiens EM.)
Si ce phénomène inédit résulte d’une situation sociale sans précédent avec le départ de plus de 1 700 individus (hommes, femmes et enfants) sur la zone irako-syrienne, il est essentiel de le considérer également comme la conséquence de la politique pénale française. Les procédures judiciaires contre les personnes accusées d’être affiliées aux groupes terroristes sur ce terrain de guerre traduisent concrètement la volonté politique et judiciaire de pénaliser de plus en plus largement les engagements dans un islam considéré comme radical et potentiellement violent. Cette perspective française est d’autant plus nécessaire à souligner qu’elle a constitué une singularité forte dans le paysage européen en matière de traitement des velléitaires et des revenants. Dans le cadre de ces procès correctionnels, les peines encourues sont de 10 ans maximum et la ritualisation particulière des cours d’assises spéciales n’y prévaut pas, ce qui donne à ces audiences, d’une après-midi ou de une à deux semaines maximum, une forme de « normalité » parfois loin des représentations dominantes.
La première impression qui se construit au fil des audiences est que ces procès terroristes se déroulent selon un rituel relativement identique aux autres contentieux correctionnels.
La « massification » de ces dossiers, selon les termes du parquet de Paris, s’observe à partir des années 2013-2014. On compte ainsi 26 procédures en 2013, 136 en 2015, 362 en octobre 2016 et 415 en février 2017. En novembre 2014, le premier prévenu jugé pour participation à une filière de départs vers la Syrie est condamné à une peine de 7 ans de prison fermes. Le nombre de procès des velléitaires ou de revenants augmente alors rapidement, pour atteindre un rythme quasi hebdomadaire à partir de 2016.
La première impression qui se construit au fil des audiences est que ces procès terroristes se déroulent selon un rituel relativement identique aux autres contentieux correctionnels. L’accès public aux audiences, la faible distance entre les bancs du public et le box des prévenus, ou encore le contact direct que l’on peut avoir avec les avocats, les prévenus (quand ils comparaissent libres) et leurs familles renforce cette impression de non-exceptionnalité, à laquelle s’ajoute la répétition quasi quotidienne des audiences. Les machines à café du palais de justice sont des endroits de socialisation essentiels, l’ensemble de la scène d’audience pouvant parfois être réuni en ce lieu.
Si certains jours, les bancs de la XVIe chambre sont vides ou clairsemés, d’autres audiences bénéficient d’une couverture médiatique importante, voire d’une surexposition. Le marché de l’image semble alors guidé par une quête de l’idéal-type du djihadiste. Ces situations peuvent parfois conduire à la production d’images trompeuses ou de stéréotypes. En juin 2016, les supports de presse Le Monde, Le Figaro et Libération reproduisent ainsi uniquement le dessin du box des prévenus barbus, alors même que le box qui lui fait face rassemble trois jeunes hommes glabres. Interrogé sur l’éviction des prévenus rasés de près dans la représentation des prévenus, un journaliste nous répondra « C’est triste à dire, mais ça se vend moins bien » (A, juin 2016). On entendra par ailleurs une journaliste souffler à sa collègue de la rejoindre de son côté de la salle d’audience pour avoir vue sur « les barbus ». Ce jeu autour de l’image semble toutefois ne pas être unilatéral, à en croire l’attitude sur-virilisée de certains prévenus, dans des vêtements de sport souvent aux couleurs des grands clubs de foot européens. Cette adaptation aux attentes des médias culmine lorsque des prévenus demandent à prier pendant l’audience (avril 2016) ou pendant l’interruption de séance sous les yeux des caméras (décembre 2016). Si les médias télévisés ne se déplacent que pour les affaires les plus en vue, la presse écrite et radiophonique suit assez assidûment cette actualité judiciaire particulière. Habitués de ces audiences, ces journalistes appartenant pour la plupart à l’association de la presse judiciaire entretiennent des relations relativement directes avec les protagonistes des procès (ministère public, avocats, voire familles).
Un second élément illustre la dimension singulière de ces procès, il s’agit de l’émergence d’un espace social et judiciaire spécifique, constitué au fil des audiences. Une constellation d’acteurs semble effectivement se spécialiser sur ce contentieux terroriste. Se construit par exemple une forte spécialisation pour une poignée d’avocats. Signe de cette tendance, on observe certains d’entre eux écouter leurs collègues sur les bancs du public pour mieux saisir les habitudes de cette chambre correctionnelle : « C’est quand même la XVIe… Ils se connaissent tous et sont des spécialistes de ces affaires, c’est une chambre particulière ! » (A, mai 2017). Des avocats jouent d’ailleurs de cette spécialisation dans leur ligne de défense « Madame la Présidente, nous connaissons ces affaires, nous avons l’expérience ici… ce n’est pas le premier dossier sur lequel nous nous retrouvons ! » (A, novembre 2017). D’autres, peu présents dans ces dossiers, mettent au contraire en exergue cette non-spécialisation et leur regard neuf. De la même manière, on relève une spécialisation des présidents de cours, des assesseurs ou du parquet qui montrent une fine connaissance de l’inscription géopolitique du djihad armé. Cette spécialisation qui doit se lire au prisme de l’organisation judiciaire spécifique de l’anti-terrorisme, n’est pas sans conséquences sur la manière de juger et de condamner.
L’association de malfaiteurs terroristes se différencie du système pénal classique en créant une équité entre la dimension matérielle et morale de la participation à un groupe terroriste.
La succession des attentats sur le sol français depuis janvier 2015 a conduit à une superposition importante des législations légitimées politiquement comme une réponse « nécessaire » aux attaques de 2015 et 2016. Ces évolutions législatives s’accompagnent également de modifications de la politique pénale qui relèvent clairement d’une volonté « d’adapter les outils de judiciarisation à l’éventail de plus en plus large des groupes, filières et acteurs » (EM, 2015). Cette course à l’adaptabilité, qui s’accélère en 2015, poussent parfois les magistrats à s’interroger : « Nous avons la tête dans les dossiers, tous ces changements, ces créations (…) cela se fait, je trouve, au détriment d’une réelle visibilité et même d’une compréhension de ce que nous sommes en train de produire » (EM, 2017).
Dans ce contexte législatif et politique, l’accusation de « participation à une entreprise terroriste » s’est imposée pour devenir aujourd’hui le principal instrument d’accusation et de condamnation. Dans les salles d’audience et couloirs du palais de justice de Paris, une expression s’est imposée : « l’AMT » (association de malfaiteurs terroristes).
Cette infraction juridique, issue de l’association de malfaiteurs, se différencie du système pénal classique en créant une équité entre la dimension matérielle et morale de la participation à un groupe terroriste. L’idée première est de pouvoir arrêter l’ensemble d’une filière avant son passage à l’acte, y compris les personnes ayant offert un soutien idéologique ou logistique aux acteurs les plus actifs. C’est d’ailleurs sur ce point que Abdelkader Merah sera condamné et que certaines parties civiles dans le « procès Jawad » ont demandé dès le début de l’audience une requalification de l’affaire afin de poursuivre les logeurs non plus pour recel mais pour participation à une AMT.
Lors d’une audience fin 2017 où comparait une jeune fille arrêtée alors qu’elle prévoyait avec d’autres amies de « faire comme le 13 novembre sur des terrasses de café à Paris », l’absence d’armes lors de leurs arrestations conduira la défense à interroger la réalité du passage à l’acte : « Et si et si… on ne saura jamais s’il y a passage à l’acte, et on ne saura jamais car c’est l’AMT ! (…) L’AMT a une utilité, car elle permet à la société d’arrêter des projets criminels et terribles avant qu’il puisse y avoir des victimes. Pourtant nous connaissons les critiques de cette infraction qualifiée d’infraction fourre-tout avec des peines souvent maximum. Mon but est de dire ce soir qu’il faut l’utiliser avec rigueur, contre cette automaticité qui se fait avec une liste rapide d’éléments qui caractériseraient l’infraction, et cela en 3 minutes ! » (A, novembre 2017). Les principales critiques contre cette infraction soulignent plus largement la nécessité de l’utiliser avec précision, à la fois sur son temps, sur les personnes impliquées et sur les preuves. D’autres allant jusqu’à parler « d’infraction poubelle », comme l’avocat Dupont-Moretti durant toute l’audience du procès Merah.
Les limites juridiques inhérentes à ce type d’accusation apparaissent dans le cas du « procès Jawad » et de sa compréhension par l’opinion publique. La différence entre un « recel » et une « participation » à une AMT étant difficile à saisir malgré les conséquences que cela peut avoir sur les peines prévues et requises lors de l’audience. Ainsi de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, et notamment du personnel politique, considèrent que la peine de 4 ans requise contre les logeurs illustre une nouvelle fois le laxisme de la justice quand bien même une telle échelle des peines est inscrite dans la loi.
Autre exemple de la fluidité de l’AMT, à propos des femmes et de leur absence régulière dans les procédures malgré des engagements parfois très actifs dans les séjours en Syrie. Ainsi, ce président lors d’une audience de décembre 2016 devant trois hommes partis avec leur famille soulignera : « Votre femme semble très fortement engagée dans votre départ et séjour en Syrie ? Elle dit que vous avez eu peur, qu’elle est restée… C’est elle qui a le plus de courage en fait ? Elle a été le moteur… et pourtant elle n’est pas là aujourd’hui ! » (A, décembre 2016). Cette différenciation de la prise en compte des individus au regard de leur genre a pris fin officiellement à l’été 2016. Depuis la tentative d’attentat de jeunes filles à Notre-Dame-de-Paris, les femmes velléitaires ou revenantes de Syrie sont elles aussi judiciarisées mais le plus souvent sous contrôle judiciaire, à la différence des hommes qui sont, eux, incarcérés systématiquement. L’AMT, tout en posant des questions d’ordre juridique importantes, se voit donc confrontée à des réalités d’engagement complexes et à des utilisations ambiguës de la part des autorités judiciaires.
L’objectif actuel n’est plus la mise à l’écart temporaire du condamné dans le but de sa réinsertion, mais bien celui de protéger la société par des incarcérations longues dans une approche qui répond non plus à une logique « de surveiller et punir » mais « de punir et surveiller ».
Depuis 2015, au fil des audiences, une échelle des peines s’est progressivement construite dans le sens d’un alourdissement important des années de prison requises et prononcées. Selon le ministère de la Justice, la moyenne des peines dans les contentieux terroristes a augmenté en France, passant de 4,4 ans en 2013 à 7 ans en 2016. De manière plus spécifique, il est aujourd’hui possible de considérer que les peines prononcées pour les velléitaires oscillent entre 4 et 6 ans, les peines pour les revenants allant, elles, de 8 à 10 ans.
L’une des principales transformations introduites par la loi du 3 juin 2016 concerne d’ailleurs ce renforcement de la sévérité des peines et du parcours pénitentiaire. Depuis juin 2016, le crime d’AMT, jugé en cours d’assises, est désormais puni de 15 ans de réclusion criminelle et de 30 ans pour ceux accusés d’être à la tête de ces groupes. Autre signe de ce durcissement sans précédent, le ministère public décide de faire appel de manière systématique des jugements inférieurs aux réquisitoires du parquet. Ainsi, dans plusieurs dossiers, des peines prononcées en première instance de 8 à 9 ans et 2/3 de sûreté, au lieu des 10 ans et 2/3 de sûreté requis par le parquet, ont fait l’objet d’appel. Une telle stratégie n’est pas sans poser des questions pour la gestion future des cours d’appel qui vont par conséquent, elles aussi, être confrontées à un flux sans précédent d’audiences. Face à cette politique pénale dans le sens d’un alourdissement des peines et d’un recours systématique en appel, les différentes formations de jugement de la XVIe chambre s’inscrivent dans des approches souvent différenciées : « Il est impossible actuellement de bien saisir l’effet de nos décisions… mais peut-être encore plus problématique, on a souvent du mal à saisir quelle est la cohérence des peines que l’on prononce ! » (EM, juillet 2017).
Lors d’une audience voyant se présenter trois revenants aux déclarations ambiguës sur leurs séjours, le président en guise d’introduction à son prononcé de jugement déclare : « Une dimension très importante de ces jugements, c’est l’avenir… surtout dans le contexte des attentats » (A, février 2017). Cette question de l’avenir et du devenir des condamnés est déterminante, en ceci qu’elle pose en creux la problématique classique de la dangerosité et de la récidive, qui prennent dans les affaires de terrorisme une dimension sociale et politique importantes. Un autre magistrat rappellera d’ailleurs lors d’une audience l’absence de droit à l’erreur dans ce type d’affaires. Face à deux jeunes velléitaires ayant été arrêtés à Sofia sur le chemin de la Syrie, un procureur conclura son réquisitoire par ce sentiment d’audience : « comme on l’a vu durant tout le procès, ils persistent dans ce discours encore aujourd’hui… c’est ce qui fait le plus peur ! » (A, octobre 2017). Pour une jeune femme incarcérée immédiatement à son retour de Syrie à une époque où peu de femmes sont judiciarisées de la sorte, son attitude de repentance lors de l’audience et sa volonté de montrer la fin de sa radicalité — « je me maquille maintenant, je ne prie plus et je ne porte plus le voile… » (A, mars 2017) — seront soulignées par le parquet comme une preuve de son désengagement. D’ailleurs, dans la motivation de jugement de cette affaire, ces éléments seront repris par les juges afin de justifier une peine clémente par rapport à la jurisprudence.
Depuis la loi du 3 juin 2016, si l’aménagement de la peine et de la liberté conditionnelle demeure un droit pour les condamnées en matière terroriste, son utilisation devient de plus en plus exceptionnelle, entraînant, selon de nombreux avocats et certains magistrats, la constitution d’un régime de la peine dérogatoire au droit commun. Le sens de la peine dans son rapport à la société est de ce fait profondément transformé. L’objectif actuel n’est plus la mise à l’écart temporaire du condamné dans le but de sa réinsertion, mais bien celui de protéger la société par des incarcérations longues dans une approche qui répond, selon les termes de Christine Lazerges et Hervé Henrion-Stoffel, non plus à une logique « de surveiller et punir » mais « de punir et surveiller ». En 2017, lors d’une audience de jugement d’un velléitaire encore fortement engagé dans son idéologie, une telle problématique est apparue dès le début de l’audience : « Je le sais, mes propos, mes vidéos sont radicaux, et moi aussi… je sais que ça ne vous plaît pas ! Que mes questions sur la Syrie… elles ne vous plaisent pas ! Radical c’est comme une maladie pour vous… en détention c’est ridicule. Leur but c’est de nous faire changer d’avis sur quelque chose qu’ils ne connaissent pas… l’évaluation, la déradicalisation ça sert à rien, c’est fini ! » (A, mai 2017).