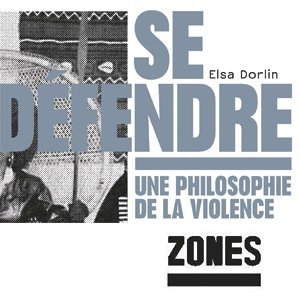Carnaval noir contre black faces
Depuis cinquante ans, le carnaval de Dunkerque – qui se tient pendant les trois jours intenses du dimanche, lundi et mardi gras, mais aussi s’étale du 6 janvier au 8 avril en de nombreuses soirées masquées à thème – réserve une soirée spéciale, celle du 10 mars, à la « Nuit des Noirs ». Les caricatures outrancières ont été légitimement dénoncées par le leader du CRAN comme s’inscrivant dans un racisme esclavagiste et colonial, comme on a pu le dire aussi du personnage de Pierre le Noir au carnaval d’Amsterdam mais tout autant, dans différents carnavals européens et latino-américains, des masques et déguisements de « Juifs », de « Tsiganes », de « Maures », de « Turcs », de « Negritos » et autres figures de l’étranger et du sauvage. De son côté, le maire de la ville en appelle à la liberté carnavalesque et au « droit de changer de peau » pendant ce temps à part. Sans chercher à minimiser la polémique, il peut être intéressant au contraire de l’approfondir, et de se demander de quel monde – ou quels mondes au pluriel – le carnaval est le lieu, à qui il appartient, et comment chacun s’approprie et transforme cet espace.
La culture populaire est « polémologique » et « utopique », écrivait l’historien Michel de Certeau dans L’invention du quotidien (1980). C’est une bonne grille de lecture pour nous aider à penser le carnaval, celui de Dunkerque et sa polémique autour de la prochaine « Nuit des Noirs », comme le carnaval en général et ses infinies variantes dans le monde. Il est un espace polémologique au sens où il se nourrit de la critique sociale et ne cesse, en retour, de nourrir les polémiques. C’est cette propriété-là qui le rend populaire, voire « petit » ou « sale » comme on le nomme parfois, très lié aux quartiers et aux villes où il naît, qui se lancent des défis, esthétisent et surtout ritualisent leurs différences et leurs différends en les déplaçant du monde social quotidien vers des formes et cadres esthétiques, des fictions ou des rêves. Il est ainsi à ranger du côté des arts de la rue sans atteindre partout cette reconnaissance-là, tant les jets de farine, d’oranges pourries, de boue ou d’eau sale peuvent le rendre repoussant pour qui aurait la mauvaise idée de n’en être que spectateur.
Le carnaval est aussi un espace utopique parce qu’il crée un autre possible, « par définition miraculeux » écrivait encore De Certeau. Par des retournements, des transferts, déplacements ou décalages surprenants, risibles et grotesques mais toujours très sérieusement pensés et mis en scène par les carnavaliers, un monde tout autre est créé dans un espace-temps rituel, c’est-à-dire sur un parcours bien délimité, pendant quelques jours précis, avant de « mourir » pour « renaître » l’année suivante à la même date. C’est ce cadre rituel qui permet la symbolisation des conflits de la vie sociale, par ses « combats » et autres « mises à mort », ce qui ne les élimine pas ni ne les adoucit mais leur donne un espace-temps d’existence bouillonnante pendant que la vie ordinaire, elle, est (au moins dans les grandes villes de carnaval) comme arrêtée dans un « temps mort », attendant juste que cela s’arrête, pendant trois jours, cinq, dix ou douze comme dans les fêtes carnavalesques issus des calendriers pagano-chrétiens, ces jours-là étant parfois répartis sur plusieurs semaines comme dans certains carnavals des Caraïbes, qui débutent le 6 janvier avec la « fête des rois », ou comme dans celui de Dunkerque du 6 janvier au 8 avril. C’est ce « miracle » culturel qu’il ne faut pas perdre dans la polémique sociale. Comment faire ?
Pour commencer, nous pouvons aller voir ailleurs ce qui nous semble éloigné dans l’espace, mais ne l’est pas dans l’esprit carnavalesque. L’ambivalence du carnaval est partout, elle permet de saisir les rapports entre culture et politique, et de comprendre que ce lien, devenu risible, dérisoire, décalé et irrévérent, est constitutif du carnaval lui-même. Elle nous permet aussi de considérer que la polémique sur la « Nuit des Noirs » au carnaval de Dunkerque, est peut-être une bonne chose.
Du point de vue du carnaval de Dunkerque, ce serait une histoire en forme de miroir inversé : le carnaval dit « afro » à Bahia au Brésil, un carnaval créé par et pour les Noirs. Si celui de Dunkerque a pour contexte la société coloniale puis postcoloniale de la France, le carnaval de Bahia commence, lui, avant l’abolition de l’esclavage (1888) et se poursuit dans le cadre d’une société post-esclavagiste puis de plus en plus globalisée, avec une exceptionnelle richesse imaginative et polémique.
Le carnaval « afro » de Bahia s’est formé dans les années 1970 comme un espace de contestation : se considérant rejetés par la société racialisée et à domination blanche, ses inventeurs ont voulu empêcher l’accès des Blancs à leur groupe de carnaval, formant un espace « miraculeux » où n’eurent accès donc que les Noirs. Le groupe Ilê Aiyê, fondé en 1974, fut à l’origine de ce mouvement, il a généré dans les années suivantes plusieurs dizaines de « blocos [« blocs » ou groupes de percussions, danse et marche] afro ». Le récit que m’en donnèrent près de vingt ans plus tard ses fondateurs et leaders mettait au premier plan leur volonté de contestation raciale. Elle correspondait à une période où, mondialement, résonnaient les mouvements pour les droits civiques aux Etats-Unis et les contestations de l’apartheid en Afrique du Sud, alors qu’au Sud du Brésil, des mouvements politiques se formaient avec en particulier le Mouvement Noir Unifié (MNU) sans cependant mobiliser les foules. Cette dimension contestataire, contre la discrimination raciale, fut le moteur polémique et donna le sens social de ce qui fut aussi appelé « l’africanisation du carnaval ». Pour porter cette contestation raciale et la sublimer, il fallait faire plus. Un « monde » propre fut créé, appelé mundo negro (« monde noir ») et progressivement « famille Ilê Aiyê » – les deux auto-désignations les plus fréquemment utilisées. Il prit forme en s’inscrivant dans une filiation culturelle plus large et englobante – celle des écoles de samba autant que des « familles-de-saint » du candomblé (le culte afro-brésilien).
Lors de la première apparition du bloco Ilé Aiyê au carnaval de 1975, son thème était « Nous sommes les Africains à Bahia ». Ce fut une manière de dire « Nous créons notre propre monde ». L’espace carnavalesque permet ce dédoublement de soi : une séparation rituelle avec l’environnement social, une frontière temporelle pendant les jours et nuits de carnaval, une présentation de soi différente. C’est une « deuxième vie » selon Michael Bakhtine dans son étude du carnaval et de la culture populaire de l’époque médiévale, mais elle n’existe jamais par elle-même, elle est « dialogique », elle dialogue avec la vie ordinaire et les identités (nous, je) de la vie sociale, qu’elle parodie, transforme et recrée différemment pendant les quelques jours de la « licence » carnavalesque.
Puis cette rupture carnavalesque déborde le carnaval dans ses limites spatiales et temporelles. À Bahia, elle a déclenché une polémique politique qui restait très vive encore vingt ans plus tard. Comme le groupe afro Ilê Aiyê n’a pas voulu de personnes de couleur blanche dans son défilé de carnaval, et l’a dit très fort dès son premier défilé, les journaux, les autorités officielles du carnaval et de nombreux intellectuels et politiciens ont dit et écrit : « Ilê Aiyê est raciste, dans un pays comme le Brésil c’est inimaginable, inacceptable ». Les premiers participants (quelques centaines de personnes, avant d’atteindre plusieurs milliers d’inscrits les années suivantes) et les jeunes des quartiers noirs, soutiens enthousiastes du groupe carnavalesque, voulurent faire plus que réagir à la discrimination raciale, en imaginant une performance – le « monde noir » – qui allait se prolonger au-delà du moment carnavalesque. Au long des années, si les premières dénonciations n’ont pas cessé, les commentaires ont petit à petit associé les termes de « orgulho negro » (fierté d’être Noir) ou « elite negra » (l’élite noire) au nom Ilê Aiyê. La performance eut sur le long terme une remarquable efficacité rituelle et politique.
L’efficacité rituelle a pu être vite mesurable. La nécessaire invention des symboles donnant un sens autre que le sens dominant racial (raciste) à l’identité ainsi mise en scène, a entraîné un extraordinaire travail symbolique. Celui-ci fut marqué par un volontarisme de la part des carnavaliers, pour aller chercher dans l’histoire du culte afro-brésilien une ressource pour le présent. C’est ce qui permit par exemple de transformer la figure qu’on appelle au Brésil la « mère noire », mãe preta. Nourrice noire de la maison des maîtres dans le système esclavagiste, celle qui s’occupe des bébés blancs, aimée et valorisée à ce titre dans le paternalisme brésilien post-esclavagiste, la mère noire est re-jouée comme « la vraie mère noire, la mãe de santo [mère de saint, prêtresse] du candomblé ». La femme qui trône sur le haut du camion de carnaval dans le défilé d’Ilê Aiyê est une vraie mère-de-saint, en outre la mère du fondateur du groupe. D’autres symboles ont fleuri au fil des ans et des nouveaux défilés, tels que la figure de la masculinité noire, Zumbi, héros de la résistance à l’esclavage, ou l’élection de la « beauté noire » féminine (beleza negra) généralement associée à l’icône de la féminité Oxum dans le culte des divinités du candomblé, ou encore les épopées de rois, princesses et guerrières puisées dans l’histoire de l’Afrique du Sud, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, etc. Tous ces symboles sont le produit d’un assemblage entre le langage religieux du candomblé ou du christianisme, la mémoire afro-descendante, la tradition carnavalesque nationale et les apprentissages scolaires, dialoguant avec le présent de la discrimination raciale, du blocage de l’ascension sociale des Noirs, du langage et des attitudes racistes très répandus dans la société.
Il y a un lien étroit entre l’efficacité politique et l’attention portée au travail culturel. Avec le carnaval, la culture n’est pas un domaine séparé de la politique, elle participe directement de son appropriation subjective et de ses énoncés. Les percussions marquent bruyamment, et parfois brusquement, cette imbrication, comme le montre le sens particulier, très « politique », qui est donné à la forme de la syncope. Les groupes carnavalesques « afro » insistent sur ce point : le surdo au Brésil est le tambour le plus grave, celui qui marque le pas (il est appelé à Bahia marcação parce qu’il donne la cadence), il envahit et domine toute la sonorité des groupes afro-bahianais à partir des années 1970-1980. A peu près en même temps, en Guadeloupe, les « groupes à peaux » se font les héritiers revendiqués du tambour Gwo-Ka. Le groupe Ilê Aiyê à Bahia en 1974, et Akiyo en Guadeloupe en 1978, imposent dans la rue la force de la percussion grave fortement cadencée, syncopée, en la faisant ressembler de plus en plus à une marche contre l’oppression des Noirs par les Blancs, sous l’esclavage et jusqu’au présent. Le Gwo-Ka, c’est à la fois la musique, les danses, les rythmes associés aux chants violents, et le tambour qui rappelle la révolte du marronnage. Contemporains l’un de l’autre, ces deux groupes ont été porteurs d’une agitation culturelle qui a irradié dans le champ politique : Ilê Aiyê est à l’origine du Mouvement culturel noir au Brésil, comme le carnaval d’Akiyo a initié le « Mouvman Kiltirel Gwadloup ». Du point de vue de l’efficacité rituelle et politique, on peut donc se demander si la syncope carnavalesque n’est pas la condition qui permet au sujet carnavalesque d’exister corps et âme en rupture contre les assignations identitaires de la vie ordinaire… Depuis sa création au XIe siècle, le carnaval présente un risque séditieux, celui qui verrait la « parodie rituelle » basculer dans un vrai renversement de l’ordre… On se souvient à Trinidad des soulèvements carnavalesques de 1881 et 1884, les émeutes des Cannes brûlées (Canboulay Riots) qui virent des affrontements sanglants entre les carnavaliers joueurs de bâton et les policiers.
Être cet « Africain de Bahia » dans la mise en scène d’un soi dédoublé dans et par le carnaval, c’est d’abord ne pas être le « Noir » du racisme de la société brésilienne dans la vie quotidienne. Ainsi, se crée un décalage entre une identité assignée et un sujet qui affirme la refuser. Bien plus que d’une affirmation identitaire, il s’agit d’un espace où des sujets, à un moment donné et dans un lieu propice à cette expression, émergent en imposant leur parole contre l’identité inscrite dans le langage racial qui les soumet, les infériorise ou les diminue. Dans ce désir de parole autant que de paraître, ils affirment porter non pas des « déguisements » mais des « vêtements » africains : « à la couleur du tissu, on voit que je suis africain », dit un des sambas composé un des nombreux auteurs amateurs de l’association Ilê Aiyê. Carnavaliers et auteurs de samba composent, avec tout ce qu’ils trouvent d’africain autour d’eux, la symbolique de ce sujet à la fois très profondément ressenti et très mis en scène. Ils font bien en cela une expérience de la liberté dans le carnaval, moment où un sujet politique débridé peut se penser et se « performer » lui-même face aux autres.
Que nous dit ce pas de côté bahianais sur d’autres carnavals ? Il nous dit que dans l’esprit carnavalesque, la polémique est une part essentielle. Celle qui s’est développée à propos de la « Nuit des Noirs » au carnaval de Dunkerque fait bien partie de l’esprit carnavalesque. Le carnaval est un espace qui est, par définition, en relation avec le monde social. Ses inventions et ses « sosies parodiques » (selon les termes encore de M. Bakhtine) sont à la contemporains et en dehors de la vie sociale ordinaire.
Et si l’on prenait cette scène rituelle au sérieux, c’est-à-dire en partant de ses propriétés qui ont déjà été observées ailleurs ou autrefois, de ses capacités de mise en scène des identités, de « jeux » libres où s’exprime, bien mieux que dans la vie ordinaire, un sujet politique ? Ce serait rendre au carnaval, à la fois espace de liberté et d’un ordre autre, ritualisé, sa qualité de prise de parole, voire séditieuse.
Car, de quoi s’agit-il ? De prendre la rue, d’occuper les places, ce qui devrait inquiéter les cassandres de la fin de la politique. Il s’agit de se vêtir, se parer, se colorier comme on le veut : des Noirs avec masques blancs pour « inverser » les rapports de domination, et plus encore des Noirs aux visages peints en noir pour tordre et retordre l’inversion, comme on le voit en Colombie dans les scènes de « petits diables » et « negritos » qui démasquent les préjugés, ou des Noirs peints et vêtus en « Nègres marrons », souvenirs de rébellions d’esclaves, aux carnavals de Guadeloupe ou de Guyane. Le carnaval autorise de « jouer » avec les identités qui obsèdent tant les sociétés et les mondes politiques, il permet de renverser la caricature, la retourner sur elle-même, la ridiculiser.