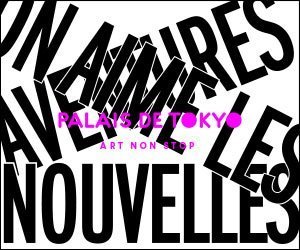Open design : produits sans qualités
Une des conséquences, parmi d’autres innombrables, des quatre révolutions industrielles[1] qui se sont succédé depuis le XVIIIè siècle est l’établissement et le renforcement progressif d’une disjonction entre production et consommation (au sens d’abord étymologique du terme : du latin consummaciun [v. 1120] « état de ce qui est mené à son accomplissement, à sa perfection », emprunté du latin chrétien consummatio « achèvement, couronnement, fin, terminaison ») — de l’affirmation d’une dichotomie que beaucoup disent originaire, première, sur laquelle reposerait toute l’économie de marché (polarité de l’offre et de la demande). Certains, d’un côté, décidant de produire ce que d’autres, de leur côté, décideront de consommer ; se revendiquant chacun en tapinois d’une plus grande influence, les deux parties entendent en réalité décider du sort de l’autre.
Ce qui pouvait passer encore naguère en un même lieu, un même temps et parfois dans les mains d’un même homme (notamment celles de l’artisan) d’un état préliminaire, précaire – au cours des différentes étapes de confection, de fabrication, d’assemblage pour les choses matérielles – à un état achevé, accompli dans l’usage s’est alors vu progressivement distrait, aux limites de l’écartèlement. C’est aujourd’hui toute la société marchande, devenue société marchande capitaliste, puis « turbo-capitaliste » comme prise dans une certaine frénésie, qui repose sur cette division. Karl Marx l’aura excellemment décrit, analysé dès 1857 dans son Introduction générale à la critique de l’économie politique : il y signale le caractère irrésolu du départage production-consommation, à plusieurs égards symptomatique des maux d’une époque.
Ce que, au fil du temps, la production mécanisée, automatisée, distribuée et dorénavant largement « cobotisée » (collaboration Homme-Robot) aura fourni ou épandu, elle l’aura mené par le truchement d’une transformation d’échelle continue et quasi-exponentielle. Unité (quantité) et cadence (rythme) furent sans cesse dépassées, surpassées. La production en série, devenue grande et très grande, aura atteint des seuils que plusieurs estiment proprement démesurés. Pourtant, cette massification de la production industrielle ne semble s’affaiblir. Elle tendrait même plutôt à s’accroître. Un tel emballement se jugulera sans doute en réaction à la dureté actuelle des marchés.
Il n’en demeure pas moins qu’il répond avant tout d’une obstination des entreprises : celle de conserver une position d’autorité ; la « prolétarisation » des consommateurs qu’auront décidé et gagné les « magnats » de la production relève, selon Bernard Stiegler, d’une sorte de mainmise sur leurs savoirs essentiels : savoir-faire, savoir-vivre, savoir concevoir et théoriser. Plus le nombre de biens, de matériels produits augmente, plus ces derniers s’uniformisent, se standardisent, n’épousant presque plus rien des besoins, envies et désirs particuliers de leurs consommateurs. Si, pour les plus récents d’entre eux, leur facture numérique leur permet d’intercepter en temps réel nos moindres faits et gestes, d’épier réactions et sautes d’humeur, reste qu’ils échouent foncièrement à saisir, à attraper quelque chose de nous qui nous ressemble vraiment : nos singularités de traits et de vie en reflet de nos milieux d’existence, de nos cultures, de nos manières indigènes ou vernaculaires de faire. Tout ceci demeure hors de portée de leurs antennes et capteurs.
C’est ainsi que, sous un aveuglement consenti, nous agréons journellement que soient retranchées des portions congrues de nos champs de propriété.
Chacun des biens, équipements et services commercialisés de nos jours ont été, pour une très large part d’entre eux, pensés, conçus et produits dans la projection et dans la prescription d’un certain usage ou emploi. Le cadre ainsi posé, s’agissant d’un objet par exemple, sa propriété trouvera alors à se négocier entre le producteur et le consommateur. Le premier disposera de l’intérieur de l’objet, au figuré comme au sens propre — sa mécanique, sa fabrique interne — le second, quant à lui, jouira des utilités et agréments que lui conférera l’extériorité de l’objet (soit sa peau ou surface fonctionnelle). Voilà le raw deal devant lequel il nous revient classiquement de céder. Si d’aventure, le consommateur de l’objet décide d’empiéter la propriété du producteur en tentant d’accéder à ses organes internes (entrailles ou viscères souvent électroniques, informatiques), en l’ouvrant, en le déboitant ou le dévissant, alors il suspend à la seconde toute « garantie constructeur ». Agissant ainsi, le consommateur se disqualifie aux yeux du producteur.
Pour ce qui est du pré carré du producteur, celui-ci se trouve être plus incertain, plus flou. L’industriel dira tantôt préserver la confidentialité des informations couvrant le périmètre d’usage de ses produits ; ce dernier de déclarer également combien il se soucie de la protection de la vie privée de ses fidèles. Que dire, pour exemple, de ce que font vraiment les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) de nos données personnelles ? Rien que nous n’ayons assumé de laisser faire, sans doute. Les clauses des contrats que nous signons à la hâte sont bien celles notifiant ce qu’il nous en coûte. C’est ainsi que, sous un aveuglement consenti, nous agréons journellement que soient retranchées des portions congrues de nos champs de propriété.
À ces arrangements que certains n’hésitent pas à juger obscènes, nul ne devrait être tenu, clament-ils. Voilà qu’une nouvelle colère gronde. Une résistance se forme, s’organise et s’avance sourdement. Quelle est-elle ? Qui en compose ses rangs ? Ce sont d’abord des communautés bigarrées, hétérogènes et dispersées de faiseurs, tous bien décidés à reprendre la main sur leurs environnements matériels et logiciels. Parmi eux, certains se disent animés d’une ambition plus haute : celle d’en découdre une fois pour toute avec cet absolutisme industriel de la production-fabrication d’objets, du développement de services ou solutions informatiques – pour une fin annoncée des produits finis : vers une démocratisation de l’accès (complexion technique interne de l’objet et code source du programme, c’est-à-dire les instructions informatiques rédigées par un programmeur dans un langage machine : notation conventionnelle destinée à formuler des algorithmes et à produire des programmes informatiques qui les appliquent), de la compétence et du savoir situés dans l’entoure plus où moins vaste de la conception créative et de la confection habile, ingénieuse des objets usuels et applications logicielles pratiques.
2001 fut une année inaugurale : celle marquant le début du mouvement fablabing.
Bien sûr, cet élan prolonge, accompagne des mouvements et actions initiés bien antérieurement. Ceux portés notamment par les clubs amateurs de modélisme (modélisme automobile, ferroviaire ; aéromodélisme, etc.), de bricolage tous domaines confondus depuis près d’un siècle. Rappelons, à toutes fins utiles, la parution dès les années 1920 de la revue française pionnière Système D (pour Débrouillards) laquelle prônait déjà le faire-soi même (Do-It-Yourself). En 1968 fut publié le premier numéro de Whole Earth Catalog créé par Stewart Brand, un périodique américain de contre-culture qui aura marqué toute une génération. Celui-ci devint le parangon de bien d’autres supports éditoriaux comme, en France, Le Catalogue des ressources édité à partir de 1975, une référence pour les mouvements écologistes et alternatifs.
Plus tard, en 1984, sorti aux États-Unis (sous l’impulsion d’Eric Corley) le magazine trimestriel 2600: The Hacker Quaterly faisant se rencontrer les communautés du Phreaking (piratage téléphonique) avec en figure de proue, John Draper alias « Captain Crunch », et celles de la sécurité informatique. En parallèle émergèrent des associations de hackers, de bidouilleurs tels que le Homebrew Computer Club aux États-Unis (1975) et le Chaos Computer Club en Allemagne (1981). 2001 fut une année inaugurale : celle marquant le début du mouvement fablabing (contraction de l’anglais fabrication laboratory, laboratoire de fabrication, lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d’outils pour la conception et la réalisation d’objets). Soutenu par les étudiants du cours que dispensait Neil Gershenfeld au Massachusetts Institute of Technology (MIT) intitulé « How To Make (Almost) Anything » (lequel se tenait au Center For Bits and Atoms), le Medialab du MIT décida d’ouvrir son tout premier laboratoire de fabrication.
Il est à noter que toutes ces initiatives fondatrices d’une culture du libre (Open Source ; Open Hardware) et du faire soi-même ont toutes promu à leur manière la mise en place de tiers-lieux : manufactures, laboratoires, ateliers, espaces, officines, boutiques, etc. La caractérisation typologique est dès lors des plus larges : FabLabs, Digital Lab, Living Lab, Makerspace, Hackerspace, Techshops, usines urbaines, etc. Il s’agit de lieux tout à la fois dédiés à la confection, au façonnage d’objets technologiques mais aussi, et singulièrement, des lieux de partage, d’échange, d’acculturation, également d’émancipation et d’expérimentation sociale. Il y revient d’œuvrer en faveur d’une « recapacitation » (Empowerment) des consommateurs citoyens autant que de participer à l’émergence d’une économie positive, c’est-à-dire intéressée au développement humain. Fondamentalement altruiste comme le soutient Jacques Attali, reposant sur le don, la gratuité des ressources et moyens, cette économie valorise la contribution individuelle, possiblement coopérative, collaborative et spontanéiste, au service d’une intelligence et d’une propriété collectives.
Rendre ou doter (de nouveau) le consommateur des pleins pouvoirs de faire, soit de prime abord de défaire, puis de refaire
Prenant très tôt part active à la mobilisation ici ascendante, certains designers virent là l’occasion rêvée de réaliser, de réussir ce à quoi ils ont, pour ainsi dire, toujours échoué : rendre ou doter (de nouveau) le consommateur des pleins pouvoirs de faire, soit de prime abord de défaire, puis de refaire — de l’objet produit comme medium, indifféremment média relationnel, matériau, matière souple, milieu matriciel, moyen intermédiaire et mouvement de la poïèse qui s’en saisit. – Le célèbre designer austro-américain Victor Papanek le confessait volontiers lors d’une conférence qu’il donna dans les bâtiments de la société Apple en 1992 : « le plus grands des défis auxquels font fassent aujourd’hui les designers, les Architectes et les Ingénieurs est de parvenir à développer un langage, une méthode qui offre à chacun la possibilité de participer aux processus de conception, de fabrication et développement technologique. Pour l’heure, nous avons échoué dans cette tâche. La faute n’en revient pas aux gens [usagers] au service desquels nous sommes mais n’incombe qu’à nous-même [designers, architectes, ingénieurs]. À cela nous devrions réfléchir plus avant. »[2].
Il serait vain, artificieux et extraordinairement injuste d’intenter un procès en moralité au design. Oui, le design a été dans son histoire et est encore un acteur, un ‘agent’ puissant, influent aux côtés et dans des entreprises dites B2C (Business to Consumer) qui n’ont parfois que trop peu d’estime pour leurs clients finaux. Certaines sont, en effet, attachés à leurs produits bien plus qu’à leurs usagers. Ce qui compte pour elles (et prévaut sur tout), c’est de contrer la concurrence en sortant, en exposant des produits de qualité – fussent-il déjà en avoir l’apparence – lesquels concentrent généralement tous les codes du luxe et se présentent ainsi parés comme désirables, séduisants, aguicheurs en somme. Le design, le vrai, celui-ci auquel on tient (pour reprendre la formule ici renversée de Pierre-Damien Huyghe) et qu’auront contribué à maintenir Max Bill, Marcel Breuer, Jean Prouvé, Ettore Sottsass et une foule d’autres encore de différentes générations, celui-ci rejoindra avec ardeur et témérité cette révolution en marche du faire-ensemble. Nous pensons qu’elle est de ces évènements dans l’histoire qui acquièrent trace et signification d’avoir modernisé, transformé ou réalisé ce qui tardait à l’être ; en l’espèce, nous pensons que celle-ci achèvera de mettre le design à l’épreuve de son objet.
Ce qui se design alors ce ne sont pas les produits, eux-mêmes, mais leurs manières combinatoires et presque infinies d’être et de servir.
Ayant tant et tant donné de sa compétence et de sa volonté pour que viennent au monde des produits finis, dignes de cet attribut, lui faudrait-il, au design, se résoudre désormais à faire qu’interviennent des produits ostensiblement non-finis, autrement dit formellement et fonctionnellement incomplets, inachevés et de ce fait ouverts. C’est précisément à quoi s’astreignent les open designers – citons notamment Samuel Javelle, Ronen Kadushin, André Knörig, Félix Lévêque, Thomas Lomée (Intrastructures), Eisuke Tachikawa (Nosigner) ou encore Mushon Zer-Aviv. Ils cherchent à ménager les conditions d’un renouvellement des biens, équipements et services procédant d’une forme de déroute, soit de reprises, de rattrapages et reconduites permanentes en (re)conception-(re)fabrication. Ce qui se design alors ce ne sont pas les produits, eux-mêmes, mais leurs manières combinatoires et presque infinies d’être et de servir : de l’introduction d’objets variants, changeant et évoluant au gré des intentions, motivations et déterminations que font peser sur eux les concepteurs-faiseurs. Aussi, paraissent-ils ad proficiscendum sans qualités – ces dernières composeront la patine des objets viellissant, passant de mains en mains.
Toutefois, nous pourrions arguer qu’elles sont toutes comme déjà, en germe, en puissance : les produits se présentant dès leur première instance réparables, modifiables, également transformables, réformables, reprogrammables. Recourant, pour ce faire, aux nouveaux outils de l’artisanat technologique – imprimantes 3D, outils de découpe laser, instruments et scanners 3D, logiciels de CAO/CFAO (Conception Assistée par Ordinateur ; Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur) et autres programmes sous licence GPL (de l’anglais GNU General Public License communément abrégé GNU GPL ou GPL : Licence publique générale ).
Chaque pièce, structure et ensemble monté, agencé, bricolé est un artefact unique. Non que les open designers condamnent la production en série, mais ils en désavouent ses principes initiaux reposant sur la réplication d’un même. Si série il y a, celle-ci répondra ici d’une évolution presque darwinienne ou mutationniste des occurrences électives d’un produit-système : d’un objet produit en série à la production d’objets sériés (comme arrangés et déployés en séries). Gageons, comme nous enjoignent à le faire les open designers, qu’au-delà d’une actualisation et adaptation des formes, d’un réajustement et réglage fonctionnels, ce qui représente déjà beaucoup, il passera ainsi au travers des mains de ceux au travail (au sens premier du mot, de l’ancien français [XIIe siècle] travail « tourment, souffrance »), quelques redoublements de traits de leur union de cœurs et d’idées.
[1] Celle première portée par l’industrie textile et la métallurgie, la deuxième axée sur l’exploitation du pétrole et de l’électricité dans les secteurs notamment de l’automobile, de la chimie, la troisième reposant sur le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication permettant notamment une certaine décentralisation des circuits de production et distribution énergétiques, la quatrième émergente semblant principalement tenir de l’essor de la robotique, de l’Intelligence Artificielle (IA) et des biotechnologies au profit du déploiement de systèmes « cyber-physique » de production.
[2] Traduction personnelle de la déclaration suivante : « The biggest challenge for Designers, Architects, and Engineers these days is to develop a language, a method of actually letting people participate in the Design and Architectural and Technological processes. We have failed in that. This is not the fault of the people we are working for or with, but this is our fault and we have to think about that. » Victor Papanek, « Microbes in the Tower ». Titre de la conférence donnée en 1992 au siège de la société Apple à l’invitation de Doris Wells-Papanek.