L’État d’Israël, 70e anniversaire
Une fête nationale est une célébration de la naissance d’un État-nation. Comme les drapeaux ou les hymnes, parfois aussi les défilés militaires, elle mobilise cet art du décorum qui se répandit uniformément à l’ère des nationalités en Europe avant de devenir un standard mondial. Il est à peine exagéré d’affirmer que ces objets, figés dans leur majesté surannée, ne séduisent plus aujourd’hui, sous nos latitudes, que les amateurs de kitsch.
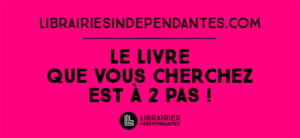
Pourtant, il est des cas où ces festivités manifestent une seconde face, réservée aux États-nation qui furent aussi des projets articulés à une certaine idée de l’universel, tels la France républicaine, la Russie soviétique, les États-Unis d’Amérique, le Reich allemand, même s’il en est d’autres quoique moins nets. La célébration s’y accompagne d’une activité particulière que l’on appelle retour sur soi ou bilan. Pour qu’il y ait bilan il faut qu’il y eut projet, projet à réaliser. L’activité y est alors une sorte de métrologie collective consistant à évaluer le parcours qui sépare un moment inaugural du présent. S’y explore et se jauge un état présent à l’aune d’une promesse.
Dès lors qu’un projet comporte une dimension universelle, cette activité métrologique déborde le collectif au sein duquel il était appelé à se réaliser. L’enquête est alors menée par un public dilaté à la mesure des attentes que le projet suscite et du périmètre de concernement qu’il impose ou qui s’impose. La France post-révolutionnaire pensa son acte de naissance comme un moment politique universel et cet événement captiva effectivement les imaginations politiques du long XIXe siècle en Europe. Cette fête concerne l’humanité dans ses aspirations à l’émancipation, se figure-t-elle depuis ; c’est pourquoi le défilé militaire du 14 juillet est ouvert à la participation de toute armée de libération. Le cas de l’Union soviétique en offre un autre exemple puisque le projet domina les espoirs, puis les déceptions, à l’échelle du monde, au point de saturer nos débats politiques depuis la révolution bolchévique. « Bilan globalement positif » est devenu l’expression comique de la persistance des espoirs dans un contexte où le communisme « réellement existant » était notoirement au bord du dépôt de bilan.
L’État d’Israël s’invite, depuis sa naissance en 1948, dans nos conversations politiques, comme s’il nous concernait tous, du moins nous européens.
L’État d’Israël en offre aussi un exemple, mais inverse, puisqu’il procède d’un projet dont la structure d’implication, du moins en première approximation, ne devait pas déborder le collectif au sein duquel il est appelé à se réaliser. L’État juif « réellement existant » est éventuellement jaugé à l’aune d’idéaux qui concernent ceux qui œuvrèrent à sa réalisation, et ses échecs n’affectent somme toute que ceux qui se pensent encore comme des légataires de cet idéal de justice dont l’emblème fut le kibboutz. Mais l’on pressent immédiatement qu’il n’en est rien, puisque cet État s’invite, depuis sa naissance en 1948, dans nos conversations politiques, comme s’il nous concernait tous, du moins nous européens.
Ce n’est pas d’abord parce que cet État est associé à un conflit sans solution à ce jour, car d’autres cas de partitions territoriales conflictuelles qui se prolongent jusqu’à aujourd’hui, aux conséquences bien plus meurtrières, ne suscitent pas d’attention publique. Et l’État d’Israël ne s’invite pas non plus dans notre actualité sous les auspices de son projet de société, mais sous celui de l’existence d’un État appelé « juif ». Ceci est de l’ordre du constat. Est-ce dire alors que le sionisme, dont l’État d’Israël est le (ou un) produit, est articulé à une certaine idée de l’universel ? Ou alors, à l’opposé, est-il articulé exclusivement à la particularité au point de figurer une négation de l’universel ?
Si l’État d’Israël avait strictement procédé de la rencontre, positive, du fait juif avec la modernité politique européenne dont les juifs s’étaient si longtemps tenus à l’écart, il serait tout simplement le produit d’un aggiornamento attendu en Europe. S’il était donc l’État d’un peuple européen désormais normalisé, coulé dans la forme politique standard, il serait une réalisation de l’État-nation parmi d’autres, une occurrence supplémentaire, dans une longue série, du principe d’autodétermination des peuples qui implique l’État. Sans être erronée, cette appréhension manque néanmoins l’essentiel.
Le sionisme fut certes une réponse moderne, une parmi d’autres, à la question juive en régime moderne, cette question que les juifs se posent lorsqu’ils se demandent ce qu’est le fait juif depuis l’ère de l’émancipation, depuis qu’ils furent nationalisés. Mais le sionisme procédait aussi et peut-être avant tout du problème juif tel qu’il se formulait en Europe à partir du dernier quart du XIXe siècle. Il ne s’agit pas ici d’un problème formulé par les juifs mais du problème que les juifs posent en Europe. Une question appelle si possible une réponse, mais un problème, pour peu qu’il soit aigu, appelle urgemment une solution.
Toutes les solutions envisagées, dès lors qu’on s’accorda sur le fait que les juifs posent problème, visaient leur disparition : assimilation jusqu’à dilution ; expulsion ; extermination. Ces solutions ont toutes été expérimentées en Europe mais dans le désordre, en se chevauchant, et avec des intensités variables, en fonction des périodes et des lieux. L’assimilation était parfois en cours jusqu’à dilution, suivant la logique générale de nationalisation des sociétés européennes. Les violences impulsaient des flux migratoires dans toutes sortes de directions, de l’Est vers l’Ouest de l’Europe, et d’Europe vers l’extérieur, dont la Palestine, suivant la logique de persécutions des minorités qu’accompagnait la nationalisation de sociétés encore insérées ou à peine affranchies d’un cadre impérial. L’extermination fut pensée, programmée et organisée en Allemagne, du cœur de l’Europe, et exécutée à l’échelle de l’Europe, idéalement du monde, avec la complicité et parfois le concours actif des autres Européens. Les trois solutions furent donc expérimentées en Europe — la dernière, qui se voulait intégrale (Gesamtlösung) et définitive (Endlösung), avec une surprenante énergie, en une séquence ramassée et intense.
Si donc le sionisme puisait son énergie dans un idéal de normalisation, dans la volonté de rassembler les juifs sur un territoire et dans un État, l’émancipation des juifs entravée par une hostilité toujours renaissante lui donna son impulsion. Puis, la nécessité, devenue urgente, d’une évacuation des juifs d’Europe en fit un mouvement populaire. C’est pourquoi le périmètre de concernement de l’État d’Israël irradie immédiatement, originellement, l’Europe. Il n’est alors de bilan de cet État qui ne soit aussi, logiquement, un bilan de la modernité politique européenne.
Cette modernité postulait qu’une Europe d’État-nations souverains et égaux était la condition d’une pacification du continent. Rompant avec les logiques dynastiques de l’Ancien régime, chaque peuple, devenu un sujet conscient et capable de se gouverner, serait assis sur son territoire et doté d’un État, de sorte que toute tentation impérialiste y serait neutralisée. Cela supposait une délimitation stricte entre intérieur et extérieur, puis l’organisation d’un équilibre coopératif entre entités égales en dignité.
Si quelque causalité va de la Shoah à l’État d’Israël, c’est sans aucun doute la gestion des populations de rescapés que seule la création d’État juif permit d’évacuer.
Si un monde d’État-nations paisibles et nettement séparés, régulé par un ordre juridique international, était réalisé, chaque collectif politique ferait le bilan pour son propre compte. Or il n’en fut rien. L’Europe communautaire, issue du double choc des guerres mondiales, a inséré ces entités dans un cadre plus consistant appelé Europe, processus pensé sur un mode fonctionnel — volonté calculée de susciter des interdépendances croissantes, de sorte qu’intérieur et extérieur se sont toujours davantage brouillées, sans qu’on ne voulu ou ne pu en tirer les conséquences politiques qui en découlent mécaniquement. Mais les empires coloniaux européens, dès lors qu’aux peuples colonisés furent aussi concédés le droit à l’autodétermination, s’effondrèrent dans le sillage du projet européen et à partir de ses propres principes. Il fallait désormais situer ces entités ultramarines à l’extérieur, s’en séparer.
L’État d’Israël offre un cas qui s’inscrit mal dans ce courant de l’histoire mondiale et pourtant sa sphère de concernement et d‘intéressement se dilate elle aussi, subvertissant ostensiblement la stricte délimitation entre intérieur et extérieur sur lequel repose le paradigme politique européen. Cet État demeure, semble-t-il, selon une modalité qu’il convient de préciser, interne à l’Europe.
Voulu et conçu à partir de l’Europe, mais projeté hors d’Europe, l’État d’Israël n’est pas un État-peuple européen ; qu’il soit aujourd’hui habité au moins pour moitié par des populations juives expulsées de l’aire arabo-musulmane brouille de surcroit le tableau. Il ne procède pas plus d’un affranchissement d’une métropole dominante à la manière dont les colonies ont acquis leur indépendance. La société juive de Palestine demeura peu nombreuse, puis allait croître progressivement à partir de 1920, sous le mandat Britannique – mandataire tenu d’y favoriser, sur une partie du territoire demeurée indéterminée, un « foyer national juif » selon les termes de la déclaration Balfour de 1917.
Que cette entité ait pu se hisser au statut d’État en 1948 est souvent perçu comme l’effet d’une réaction de la communauté internationale encore dominée par les Occidentaux et culpabilisée par l’extermination des juifs en Europe. Or, les historiens ont bien établi que si quelque causalité va de la Shoah à l’État d’Israël, c’est sans aucun doute la gestion des populations de rescapés, de « déplacées » errant en Europe après-guerre, que personne ne voulut accueillir et que seule la création d’État juif permit d’évacuer. Et du point de vue sioniste, l’éradication des juifs d’Europe avait tari le réservoir d’une immigration attendue, menaçant la viabilité du projet sioniste qui supposait une démographie en progression.
Cependant, lorsque l’extermination des juifs fut nommée Shoah, elle resurgit pour ce qu’elle fut : un crime européen impunissable et, partant, insurmontable.
Le reste des juifs qui parvint après-guerre en Palestine mandataire, puis dans l’État à peine proclamé, fut accueilli avec un mélange de compassion et de mépris pour des rescapés incapables de contrer activement leur destruction programmée. On préféra célébrer les combattants des ghettos et autres partisans, parfois communistes, souvent sionistes, parce qu’ils étaient réputés semblables à ces nouveaux juifs rédimés de Palestine, ces hébreux tenant une pèle dans une main et un fusil dans l’autre.
Cependant, plus tard, lorsque l’extermination des juifs fut nommée Shoah, elle resurgit pour ce qu’elle fut : un crime européen impunissable et, partant, insurmontable. En Europe s’ouvra un travail douloureux de distribution des responsabilités et un cycle de commémoration intense. L’État d’Israël, quant à lui, aménagea un scénario mémoriel dont la fête de l’indépendance n’est que le dernier volet d’un triptyque : jour de la Shoah, jour du Souvenir (de ceux morts au combat), jour de la proclamation de l’indépendance[1] se succèdent – dessinant une courte séquence qui va de la mort du peuple juif en Europe à la vie politique, activement assumée, d’une partie du reste des juifs dans un État situé hors d’Europe.
Ce dispositif happe irrésistiblement les Européens dans la séquence. C’est pourquoi l’État d’Israël est demeuré interne à l’Europe sous plusieurs modalités. D’abord, l’antisémitisme européen a expulsé les juifs hors d’Europe, pour partie en direction de la Palestine. Ensuite, les idéaux européens d’autodétermination des peuples et de justice sociale imprègnent de part en part le projet de territorialisation et d’autonomie d’une société juive hors de l’Europe. Enfin et surtout, l’éradication des juifs d’Europe les retint sous la forme d’un groupe visé par une entreprise criminelle, tel un spectre qui hante l’Europe. Ce que léguèrent les juifs exterminés à l’Europe est un rapport désormais embarrassé à la politique souveraine et un enrichissement de sa nomenclature criminelle : les catégories de crime de génocide et de crime contre l’humanité furent forgées pour objectiver une guerre d’extermination menée contre une population civile dispersée, hétérogène et désarmée.
Reprenons la question : le périmètre de concernement élargi à l’Europe suscité par l’État d’Israël est-il l’effet de son articulation à une certaine idée de l’universel ou à la particularité au point d’en manifester la négation ? L’État d’Israël se situe peut-être, pour les Européens, à la jointure de ces deux possibilités. Peuple dispersé, capable de se maintenir sans territoire ni État, les juifs figuraient une avant-garde cosmopolite que l’existence d’un État nommé juif, doté de surcroit d’une vitalité belligène étonnante, nie. Etat de rescapés, il figure simultanément un reste du collectif pour lequel les catégories juridico-politique de crime de génocide et de crime contre l’humanité furent forgées. Tout en niant l’universalité de l’idéal cosmopolite européen, il rappelle qu’en Europe, l’Humanité est désormais accusable de crime contre elle-même. Cet État se signale alors aux Européens comme une solution particulière, alternative au crime universel — idée de crime universel auquel il s’est articulé historiquement.
Si l’État « juif » implique l’Europe, c’est donc qu’il figure un singulier universel : singulier, en tant qu’il est négation de l’universalité de l’idéal cosmopolite européen que les juifs ont incarné, ce qui leur fut reproché avant que l’Europe d’après-guerre ne s’y convertisse elle-même, universel, en tant qu’il figure le crime illimité dont les juifs furent l’objet. L’anniversaire de l’État d’Israël coïncide, conceptuellement, avec la commémoration de la mort des juifs d’Europe. C’est pourquoi les bilans de l’Europe et de l’État d’Israël demeurent couplées. Cette comptabilité intriquée est le reflet de la crise de notre modernité politique européenne. C’est pourquoi aussi, l’Europe s’invite irrésistiblement aux festivités, mais ne peut joyeusement souhaiter à l’État d’Israël un bon anniversaire.
NDLR : L’auteur de ce texte, Danny Trom, vient de publier Persévérance du fait juif. Une théorie politique de la survie, EHESS-Gallimard-Seuil.
