Le féminisme indien face aux violences sexuelles
Parmi les nombreux clichés qui circulent sur l’Inde, celui d’un pays dangereux pour les femmes occupe une place centrale. Le récent classement de l’Inde comme pays « le plus dangereux du monde pour les femmes » par la Fondation Thomson Reuters a ainsi été largement relayé en Inde et en dehors, sur des portails féministes comme dans les journaux généralistes. New Delhi en particulier est souvent désignée comme la « capitale du viol ». La centralité de la question des violences sexuelles au sein des discussions et mouvements féministes n’est ni surprenante, ni nouvelle ; comme dans bien d’autres pays, le viol est devenu un enjeu structurant du féminisme indien dans les années 1970 et 1980 [1]. Toutefois, cette discussion s’est élargie bien au-delà des cercles féministes, comme l’atteste le mouvement populaire en réaction au viol et au meurtre d’une étudiante de Delhi en décembre 2012 (l’affaire Nirbhaya), qui a très largement dépassé les mouvements de femme et le féminisme.
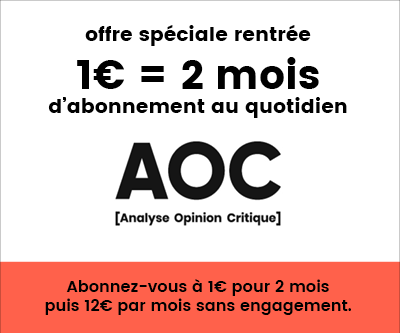
On peut bien sûr se réjouir de l’appropriation de cet enjeu par des acteurs non féministes. Toutefois, l’ouverture de la discussion autour de la violence contre les femmes indiennes au-delà des cercles féministes, et même au-delà de l’Inde, s’accompagne de formes de rétrécissements, que ce soit dans la façon dont les enjeux sont problématisés, ou dans les solutions qui sont proposées. Les débats actuels sur la violence sexuelle en Inde, que ce soit au niveau national ou global tendent à ainsi à être réducteurs, alors même que les réflexions et débats féministes ont pensé cette question de façon riche.
Il faut donc, dans un premier temp, porter un regard critique sur la façon dont la question de la violence contre les femmes indiennes est discutée, à la fois localement en Inde, et globalement. Il ne s’agit pas ici de nier la réalité de ces violences, mais de mettre en évidence leur mise en récit, et les implications de cette dernière. Cette analyse critique doit d’ailleurs être mise en perspective avec le travail effectué au sein de la mouvance féministe pour penser la violence de genre depuis les années 1970, et l’originalité de cette réflexion. En particulier, je voudrais souligner une des forces de la théorie féministe indienne, qui est d’avoir mis en évidence assez tôt la construction croisée des rapports de domination, et notamment de ceux liés à la caste, forme de stratification sociale majeure en Inde, et au genre.
Les stéréotypes sur les Indiennes réduisent la marge de manœuvre de celles qui militent pour leur droit comme l’atteste la mise à distance du terme même « féministe ».
La « question de la femme », comme elle était alors appelée, est devenue un enjeu public dès la période coloniale en Inde, notamment parce que les Britanniques ont justifié leur entreprise impérialiste par le besoin de protéger les femmes de l’Inde. De ce fait, la question du statut des femmes indiennes a également été précocement internationalisée. L’ouvrage de l’essayiste étatsunienne Katherine Mayo, Mother India [2] avait ainsi suscité un large débat dans les années 1930. L’auteure s’y opposait à l’indépendance de l’Inde, en arguant que les déviances sexuelles des hommes indiens et leur violence envers les femmes auraient pour résultat des maternités précoces et une « race faible ». L’indignation que cet ouvrage avait suscité en Inde à sa publication s’est retrouvée, avec des nuances, dans les débats qui ont suivi la sortie en 2015 du documentaire India’s Daughter, réalisé par la britannique Leslee Udwin. Ce film reposait en grande partie sur des entretiens avec les hommes condamnés dans le cadre de l’affaire Nirbhaya. Si une partie des critiques se concentrait sur l’opportunité d’offrir une tribune aux auteurs de violence, un certain nombre de voix ont questionné le choix d’une Britannique de s’emparer d’un tel sujet plutôt que de s’intéresser aux violences sexuelles dans son pays.
Ces critiques n’étaient pas majoritaires dans les rangs féministes. Mais elles mettent en évidence la persistance du cadrage colonial. En effet, si le film India’s Daughter a pu être mal reçu, c’est parce qu’il s’inscrit, indépendamment des intentions de l’auteure, dans une fabrique quasi ininterrompue de représentation des femmes indiennes, et plus largement, des femmes des pays du Sud, comme victimes de traditions séculaires. On notera d’ailleurs, la continuité entre la figure de la « mère » et celle de la « fille », qui persiste à inscrire les femmes dans le cercle familial. Outre, qu’ils simplifient et dé-historicisent des phénomènes complexes, les stéréotypes sur les Indiennes réduisent la marge de manœuvre de celles qui militent pour leur droit comme l’atteste la mise à distance du terme même « féministe » par certaines Indiennes, qui le considèrent comme trop lié à l’histoire coloniale et à l’impérialisme [3]. Les féministes, ou plus largement celles qui contestent l’ordre social et politique au nom des droits des femmes sont facilement accusées de « faire le jeu » de l’occident.
À cet égard, les grandes manifestations qui ont suivi le viol de décembre 2012 signalent la plus grande légitimité publique des débats quant aux droits des femmes. D’ailleurs, cette mobilisation a poussé le gouvernement de l’époque à s’emparer de la question, et à changer le code pénal indien pour améliorer la définition de ce crime, et donc sa répression, mais aussi pour améliorer le traitement des victimes [4]. Dans le même temps, ces manifestations étaient à bien des égards « ambivalentes » d’un point de vu féministe, comme l’a souligné la chercheure Stéphanie Tawa Lama-Rewal : beaucoup des participant-e-s se concentraient sur le châtiment à apporter aux criminels (la peine de mort) et avaient une rhétorique de protection des femmes en tant que mères, sœurs et filles.
Il y a eu un resserrement de la question de la violence autour de la question de la sécurité dans les espaces publics, en mettant de côté la multiplicité des formes de violence liée au genre.
Encore une fois, si l’on peut se réjouir de la plus grande publicisation de l’enjeu de la violence sexuelle contre les femmes, force est de constater que cette publicisation s’accompagne parfois d’une forme de réduction de cet enjeu. Tout d’abord, il y a eu un resserrement de la question de la violence autour de la question de la sécurité dans les espaces publics, en mettant de côté la multiplicité des formes de violence liée au genre. La réforme du code pénal effectuée dans la foulée de l’affaire Nirbhaya illustre bien ce problème. En effet, alors que le comité en charge de faire des propositions au gouvernement sur ce sujet avait explicitement demandé la reconnaissance du viol marital, cette demande n’a pas été prise en compte. Pourtant, les mouvements féministes se sont emparés de la question des violences conjugales dès les années 1980, en montrant notamment la continuité entre les différentes pratiques, et leur caractère systémique.
En cela, la réduction de la question de la violence sexuelle à la sécurité dans les espaces publics (urbains principalement) réduit la portée des actions entreprises, dans un contexte où la cause des femmes est aujourd’hui en grande partie défendue au sein d’organisations non gouvernementales dépendantes des financements gouvernementaux et internationaux. Ainsi, le cadrage en termes de sécurité publique met l’accent sur des dispositifs tels que les caméras de surveillance, ou la mise en place d’espaces réservés aux femmes dans les transports (comme c’est le cas à Delhi), alors que plusieurs mouvements et initiatives récentes mettent plutôt l’accent sur le droit des femmes et des filles à profiter des espaces publics, en tant que flâneuses. C’est notamment le cas du blog Why Loiter ? qui invite les femmes à partager leurs expériences dans l’espace public, ou des actions du collectif étudiant Pinrja Tod (littéralement casser les verrous) qui lutte entre autres pour la fin du couvre-feu dans les résidences pour les étudiantes.
Par ailleurs, si la violence contre les femmes suscite aujourd’hui une indignation nationale (et globale), on peut noter une certaine sélectivité des causes. Il est des viols qui suscitent plus d’outrages. Ainsi, les viols concernant les femmes de basses castes, et surtout les femmes dalits [5], en milieu rural, génèrent souvent moins d’indignation populaire. En cela, les généralisations quant à la condition des femmes en Inde (quand ce n’est pas de « la femme ») tendent à invisibiliser la situation de certaines femmes, en particulier celles qui se trouvent à l’intersection de différentes formes de domination et de discrimination (ici la caste et le genre).
Du fait de son émergence dans un contexte colonial, le mouvement indien des femmes s’est rapidement trouvé confronté au besoin de se défaire de « la femme » comme sujet universel abstrait.
Or, c’est l’un des points sur lequel la pensée féministe indienne est particulièrement stimulante. En effet, du fait de son émergence dans un contexte colonial, le mouvement indien des femmes s’est rapidement trouvé confronté au besoin de se défaire de « la femme » comme sujet universel abstrait. La façon dont la question de la violence sexuelle a pu être débattue et problématisée illustre bien ces tensions autour du sujet du féminisme. Comme ailleurs, la lutte contre les violences faites aux femmes s’est souvent cristallisée autour d’affaires emblématiques. La première de ces affaires est connue comme le viol de Mathura. Elle concernait une jeune fille tribale [6], violée alors qu’elle était interrogée par la police. L’affaire a connu de nombreux développements juridiques, les accusés étant alternativement condamnés pour le viol, puis relaxés au titre que la jeune fille n’aurait pas exprimé son refus clairement.
Si elle est emblématique et structurante pour l’ensemble des mouvements féministes, cette affaire a mis en lumière la marginalité spécifique de certaines femmes, notamment celles de basses castes, tribales et pauvres. Premièrement, les conditions de vie de ces dernières les rendent plus vulnérables à la violence, notamment à l’extérieur du foyer ; elles doivent souvent marcher de longues distances pour avoir accès à l’emploi, l’éducation ou tout simplement aller aux toilettes. Par ailleurs, si elles sont victimes de violence, elles ont moins de chance d’avoir une écoute respectueuse des forces de l’ordre. Enfin, la violence sexuelle envers les femmes de basse caste est un élément structurel du système des castes, et une façon routinière de maintenir ces groupes « à leur place ». Ceci a pour corollaire une forte dépendance des femmes de basse caste à leur communauté (puisqu’elles ne peuvent espérer un soutien en dehors) qui rend particulièrement difficile la dénonciation des violences domestiques [7].
C’est dans ce contexte que le féminisme dalit a émergé dans les années 1980, et s’est structuré dans les années 1990. Il s’agissait pour ces militantes de remettre en cause à la fois la fiction de la « femme indienne » comme sujet d’une politique féministe indifférente à la caste, mais aussi de questionner l’unité de la condition dalit, en soulignant le caractère genré de l’expérience de la caste. Cette réflexion que l’on qualifie aujourd’hui d’intersectionnelle est apparue précocement en Inde, tout en se nourrissant d’échanges, notamment avec les afro-féministes étatsuniennes [8]. Ces questions apparaissent aujourd’hui comme des enjeux légitimes au sein du féminisme indien. Il ne s’agit pas pour autant d’un problème « réglé », et la question des préjugés de caste ou de l’attitude condescendante des féministes de haute caste reviennent régulièrement dans les débats.
Toutefois, vue de France, la banalisation d’une pratique et d’une analyse féministe intersectionnelle est frappante. En France, la légitimité des afro-féminismes et féminismes postcoloniaux est bien plus souvent remise en cause, que ce soit au nom de la laïcité ou de l’universalisme républicain. En cela, dans un contexte de multiplication des actes de violence (verbale et physique) contre les minorités (notamment les musulmans) mais aussi contre les basses castes dans l’Inde contemporaine, le mouvement des femmes apparaît comme un espace de résistance, certes imparfait, pour refuser la vision de la droite nationaliste d’une nation hindoue homogène. En cela, plutôt que de reprendre des représentations sensationnalistes des femmes indiennes comme victimes, une pratique de solidarité internationale pourrait être de s’intéresser à la pensée féministe indienne et à sa richesse, y compris pour penser et agir dans le contexte français.
