Oraison galloise – sur le dernier Jean-Christophe Bailly
Ils sont peu, et précieux, les écrivains qui parviennent à réunir les genres (journal, essai, méditation, oraison, étude, inventaire toponymique) en glissant une voix aussi distincte, reconnaissable entre toutes, invariable malgré la variété des sujets abordés, déployant une façon artisanale unique de saisir et stupéfier le lecteur. Jean-Christophe Bailly est de ceux-là. Car il ne suffit pas de s’affranchir des barrières, encore moins de le clamer comme un signe de liberté ou d’intelligence (souvent comme un signe d’orgueil et de suivisme, en vérité). Non il faut le faire, le réaliser, s’y frotter, en homme de lettres, d’arts, de sciences, d’une culture entretenue et sans cesse renouvelée.
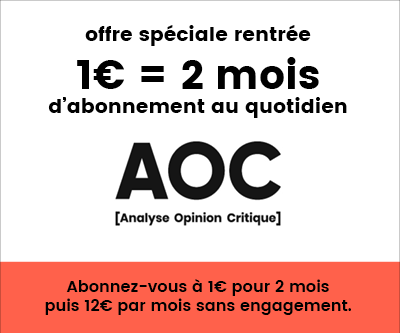
Nous avons connu, lu, admiré Jean-Christophe Bailly sur le romantisme allemand, sur le « versant animal », sur le dépaysement (grande et si précise analyse de la lente métamorphose du paysage français), sur mai 68 (texte court, qui s’achève par un dénouement inopiné dans un couvent de religieuses, au petit matin d’une nuit de barricades et au son de Ora pro nobis). Un jour il faudra rassembler ces analyses infiniment subtiles, ces rêveries enracinées pour mettre en valeur la cohérence de l’œuvre d’un observateur rare, parallèle à son temps.
Nous étions impatient de plonger dans son nouvel ouvrage, Saisir. Quatre aventures galloises, et nous avions raison de trépigner, car le point de convergence de cet essai a tout d’un inédit dans la littérature française : le pays de Galles. Au lecteur de ces lignes, je lance un défi : dresser la liste des écrivains de notre hexagone qui auraient eu la curiosité de plonger dans, ou d’aborder de côté ce pays rude et noir (une couleur sur laquelle revient plusieurs fois Jean-Christophe Bailly, il nous faudra y revenir nous aussi). Choisir un lieu méconnu ne suffit pas ; il ne nous intéresse ici qu’en vertu du regard et du travail d’annotation et de réflexion de l’écrivain-historien de l’art.
Les quatre chapitres centraux de Saisir sont parfaitement distincts. S’il relie, Jean-Christophe Bailly ne confond pas.
Comme souvent dans ses essais, celui-ci justifie le choix du pays de Galles en remontant les fils de ses activités intellectuelles et voyageuses qui ont fini par se rejoindre pour accoucher d’un livre – suivant une maïeutique déambulatoire intime mais partagée. L’avant-propos de Saisir et son premier chapitre sont explicites : Jean-Christophe Bailly annonce le rapprochement qui va suivre entre un peintre, Thomas Jones ; un poète, Dylan Thomas ; un écrivain, W. G. Sebald ; un photographe, Robert Frank. Tous quatre sont enfants d’un pays de Galles natal ou adoptif ; ici la différence entre filiation biologique et filiation choisie s’efface. Chacun fait l’objet d’un chapitre. Tous sont reliés par la terre et par la grâce d’un homme qui voit la surface en même temps qu’il en scrute la sédimentation, d’abord tangible et matérielle. La façon, la méthode de Jean-Christophe Bailly est sœur de celle des « mineurs du pays de Galles [qui] aiment à raconter que les veines de charbon qui les faisaient vivre – ou mourir – suivaient sous la terre un très long chemin conduisant des Asturies à leurs vallées, puis de là, en passant sous l’Atlantique, jusqu’en Pennsylvanie. » La géologie n’est plus synonyme de fixité, mais de mouvements souterrains que le récit révèle.
Les quatre chapitres centraux de Saisir sont parfaitement distincts. S’il relie, Jean-Christophe Bailly ne confond pas. Il dit avoir voulu « suivre un chemin plus empirique, ou intuitif », mais il demeure un savant rigoureux, lointain hériter d’un Bachelard et d’un temps où il était possible d’embrasser des disciplines jugées séparées et irréconciliables, sciences et sensibilité conjuguées. Pour le confort du lecteur, résumons. Le chapitre consacré au peintre Thomas Jones, né dans la région de Pencerrig et mort en 1803, est une réflexion sur l’énigme de la naissance d’un peintre. Le chapitre consacré à Dylan Thomas, poète dur, furieux, à la langue éclatante, est davantage une réflexion sur celle-ci, sur le pouvoir des mots. Le chapitre consacré à W. G. Sebald isole quatre-vingt pages de son ultime roman, Austerlitz, ce que Bailly appelle son « moment gallois », pour donner une somptueuse analyse de la narration si fluide, si démultipliée, de Sebald. Le chapitre consacré à Robert Frank, qui a laissé une série de photos sur la vie des mineurs, met en avant le versant social et économique d’un pays métamorphosé par l’exploitation du charbon dès la Révolution industrielle, superbe ode à une aristocratie ouvrière à la gueule noire, aujourd’hui disparue et enfouie comme le fossile qui l’a faite vivre.
Saisir n’est pas une méditation vague, ni au sens de flou, ni au sens de vague à l’âme. Pas non plus nostalgique. Pas tout-à-fait mélancolique (l’ennui est absent, l’intérêt pour l’alentour l’interdit).
Chaque partie est un foyer de pistes centrifuges qui stimulent la curiosité du lecteur qui souhaite voir, lire, relire, se rendre sur place, « emboîter le pas » de Bailly qui emboîte celui de quelques-uns. Et de pistes centripètes qui touchent une fibre plus intérieure, faite des associations offertes par Bailly, que chaque lecteur alimente des siennes. Il faut insister sur la richesse du matériau de cet écrivain, mais surtout sur son aspect organique : vivant, vécu, déplacé, éprouvé, jamais sec, purement livresque ni menacé de mort. Le lit du texte, dûment annoté et référencé, emporte. On est à la fois enraciné et déporté de côté.
Saisir n’est pas une méditation vague, ni au sens de flou, ni au sens de vague à l’âme. Pas non plus nostalgique. Pas tout à fait mélancolique (l’ennui est absent, l’intérêt pour l’alentour l’interdit). Un mot, une atmosphère reviennent sous la plume de l’écrivain, la tristesse. Tristesse de Thomas Jones qui abandonne Rome et Naples sans avoir été reconnu comme peintre, rentre au pays de Galles, résigné, et confesse dans ses mémoires, « le cœur lourd, je contemplai le grandiose paysage qui s’éloignait et disparaissait à la vue […] je me retirai en soupirant sous le pont. » Tristesse synonyme de « sombre, de noir : la couleur du charbon, bien sûr, mais aussi celle de l’ardoise, puis celle de la terre que nul n’enlève des grosses pommes de terre sur les étals des marchés […] – le noir du laverbread, ce pâté d’algues d’aspect et de goût si étranges ». Aveu de Bailly, « écroulé de tristesse » sur le front de mer de Swansea, promenade de machines à sous où il imagine Dylan Thomas enfant, écho de cette « tristesse gigantesque dans l’âme » évoquée par le poète dans Portrait de l’artiste en jeune chien.
On s’en voudrait pourtant de s’en tenir à ce sentiment. Ce serait oublier la joie que l’on éprouve à lire et voir cet arpenteur relier des indices, revenir sur des traces effacées et à peine visibles, nourrir des souvenirs, décrire d’étranges engins (voyez la minutieuse description de la camera obscura d’Aberyswyth et le « mirage silencieux » qu’elle crée) – la joie d’un écrivain que le monde saisit au point qu’il semble effacer la différence entre la main de l’homme et celle de la nature, relevant les signes les plus infimes.
Ce serait oublier l’œil et l’oreille amusés d’un écrivain de langue romane confronté aux sonorités et à l’orthographe cocasses des noms gallois, dont certains atteignent des « records d’imprononçabilité. » « Caerau, Maesteg, Aberdare, Pontypridd, Pontrhydyfen, Tonypandy, Mountain Ash, Aberfan, Tredegar, Blaenavon, Cymer, Rhondda (oh la litanie de noms qui défilaient sur les routes sinueuses…) » Merveille d’une langue où les consonnes et les voyelles semblent battues au hasard et échouées à la mauvaise place. Comme si les fusibles avaient sauté, le regard français butte et se réjouit de tant d’étrangeté. Il y a de l’Irlandais Swift dans la langue celte : rappelez-vous Gulliver débarquant à Brobdingnag.
Enfin, ce serait oublier la présence de l’enfance, jauge de sensibilité, quand Bailly glisse la sienne pour rappeler qu’il a connu les « ultimes vestiges » de la civilisation du charbon. Ou quand il évoque le Kindertransport, opération de sauvetage de mille enfants juifs au début de la guerre, point de fuite du roman de Sebald. Ou encore les gamins des mines d’ardoise dont on entaillait le nez pour savoir s’ils résistaient à la douleur, mais aussi l’image furtive et rieuse d’une fillette habillée en majorette. Sous-jacente à ces retours d’enfants, une double impression marque le lecteur, d’innocence et d’exil, de perte.
Et le cœur du projet de Bailly est là, relever tel un géomètre des lettres, des signes, des indices qui inscrivent une permanence, un temps « augmenté », une « endurance », dit-il.
La langue, la terre, l’enfance, les couleurs (locales) : une des grandes qualités de Bailly est de ne jamais déborder ni verser des larmes « terroiristes. » Digne, il acquitte au détour d’une phrase la dette du folklore nationaliste dont les effets, reconnaît-il, « ont des aspects pénibles, indexés à une fierté machiste et à un sentimentalisme équivoque. » C’est tout, c’est sobre, on ne saurait imaginer meilleur rempart contre le détournement. S’il faut mentionner la corde politique, notons plutôt que l’intéresse et le touche une autre fierté, celle d’une « classe ouvrière encore soulevée par le rêve d’un monde meilleur, » portée par le jeune Marx et les mineurs, hérauts de la « légitimité » de ce rêve.
Ces hommes ont-ils disparu ? Pas entièrement. Et le cœur du projet de Bailly est là, relever tel un géomètre des lettres, des signes, des indices qui inscrivent une permanence, un temps « augmenté », une « endurance », dit-il. Son intime compréhension de l’univers et de la manière de Sebald n’est pas fortuite. Il propose une parfaite interprétation de la narration enchâssée, si particulière à cet écrivain, allant jusqu’à reconnaître que son pouvoir a quelque chose de « contagieux ». Le terme est pour nous l’occasion de distinguer l’imitation, pratiquée par de nombreux romanciers contemporains qui plagient l’usage de la photographie de Sebald, aplatissant celle-ci alors que chez l’écrivain allemand elle agrandit et prolonge la fiction plus qu’elle ne la rabat sur le documentaire, et l’occasion pour Bailly d’avouer une affinité si profonde qu’elle semble jeter un léger trouble en lui, qui se tient à l’écart de la fiction.
Il y a chez lui une approche raréfiée de ce qu’on nomme vaguement le « style » d’un écrivain. Bailly est un lecteur doué d’un diapason travaillé et la comparaison qu’il établit à tâtons, prudemment, de Dylan Thomas et W. G. Sebald, deux hommes que rien ne rapproche sinon le hasard de la géographie et la ressemblance apparente des métiers, est inédite. Il commence par opposer le premier, grand buveur d’alcool, au second, allergique à l’alcool, déplaçant délicatement le régime de l’anecdote en l’élargissant à la « sphère de connotations » de chacun, pour arriver à l’affirmation d’une double polarité. Dans un langage plus ancien, on parlerait de tempérament, voire d’humeur, celle-ci étant d’abord une affaire de liquide qui circule dans le corps. Mais les mots vieillissent, l’usage et l’analyse les usent, Bailly est un homme du XXe siècle, il emprunte des voies autres, mélange les vocabulaires, abstraction et description, regard objectif, analytique, et « je » de l’émotion, longues phrases qui osent les répétitions et les chevilles ouvrières du type « tout se passe comme si ». C’est ainsi que sa pensée se déroule sur la page, empreinte de la génération d’un français né après la guerre.
Saisir. Quatre aventures galloises est un « buissonnement », terme emprunté à son auteur, dont il faut pourtant arrêter la critique, la chronique des échos provoqués en soi. On finira par le début, soit L’Aventure de Thomas Jones, parce qu’il y a là des pages qui parviennent à dire « la part la plus secrète de la formation » d’un artisan-artiste, une appréhension très rare de ce faisceau de hasards qui font éclore un talent : destin tout tracé abandonné, rencontres décisives, sortie de route, reconnaissance fragile, écharde de modernité apparaissant en un XVIIIe siècle finissant. La magie de la reproduction permet d’entrevoir les huiles de Jones peintes à Naples et de prendre la mesure de l’exquise portée du regard de Bailly. « Si le mouvement est bien de se demander qui se trouvait sur cette terrasse où l’art moderne a été inventé… » écrit-il en sourdine, comme pour masquer la force de l’hypothèse. Là, à Naples, en 1782, l’art moderne aurait été inventé par Thomas Jones, qui vécut à l’ombre de la lumière et « aurait soudain eu l’idée de raboter le ciel. »
« Saisir. Quatre aventures galloises », Jean-Christophe Bailly, Éditions du Seuil, 242 pages. (Du même auteur, paraît également « Tuiles détachées », Éditions Christian Bourgois, en librairie le 27 septembre.)
