Jupiter aux pieds d’argile (ou la Ve République sexagénaire)
La Ve République, à son avènement, n’est pas seulement un changement constitutionnel ; elle est aussi l’occasion d’un relais d’élites qui profitent du changement de régime pour coloniser profondément l’appareil d’Etat et la fabrique des politiques publiques. De ce point de vue, le changement constitutionnel de 1958 peut être aussi décrit comme un coup d’Etat symbolique, c’est-à-dire une redéfinition des images et des missions de l’Etat, des acteurs chargés de le servir et des modes de légitimation de leurs actions. On aurait tort dès lors de réduire le nouveau régime à son design institutionnel et aux circonstances politiques qui vont permettre, très vite, que s’impose une lecture présidentialiste des institutions. Si la geste gaullienne écrase la perspective, la Ve République tire d’abord sa force du soutien qu’elle reçoit de la part de ces nouvelles élites, de l’image de « modernité » qu’elles incarnent et dont elles font profiter le nouveau régime[1].
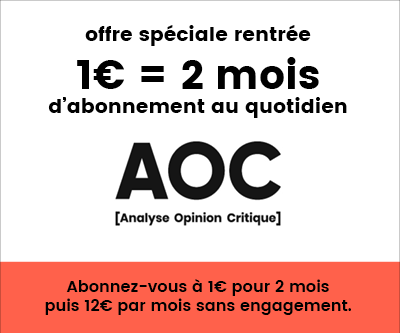
Qui sont ces nouvelles élites ? On y retrouve des hauts fonctionnaires, au profil généralement atypique (jeunes et, pour beaucoup, issus de la Résistance) mais qui occupent des positions clefs dans l’administration ou à sa périphérie – on parlera à leur propos de « marginaux-sécants » – qui visent à transformer en profondeur le fonctionnement de l’Etat. Ils rêvent d’une administration « scientifique » de l’Etat, débarrassée des « calculs » politiques, privilégiant les instruments de la prospective macro-économique au détriment du langage de la régularité juridique, jugé archaïque et conservateur.
A leurs côtés, et privilégiant le même idéal, on trouve des syndicalistes ouvriers, paysans ou patronaux : les fractions « modernisatrices » du syndicalisme ouvrier chrétien, regroupés dans le courant « Reconstruction » de la CFTC, ainsi que quelques responsables de la CGT, qui cherchent à promouvoir un syndicalisme « responsable », gestionnaire et non plus seulement contestataire ; des dirigeants du syndicalisme agricole, généralement issus du Centre national des jeunes agriculteurs et formés à la JAC, qui espèrent transformer le paysan en entrepreneur agricole ; des chefs d’entreprise, souvent issus du Centre des jeunes patrons, qui ambitionnent d’imposer l’image d’un patron compétent (c’est-à-dire, notamment, diplômé), animateur d’une entreprise au service du bien commun, en opposition à l’image du patron propriétaire incarnée, selon eux, par les caciques du CNPF.
De nombreux universitaires leur apportent la caution des sciences sociales, alors en plein essor : des sociologues qui cherchent à se libérer d’une tradition philosophique en imposant une conception résolument empirique et scientifique de leur travail ; des économistes qui tentent d’échapper à l’emprise des juristes sur leur discipline et qui reçoivent, sur ce point, l’appui des politologues.
Tous ensemble, ils s’inscrivent, après-guerre, dans un puissant courant de pensée importé des États-Unis, impulsé de tous horizons en France, qui proclame la « fin des idéologies », privilégient l’économie au détriment du droit, l’exécutif au détriment du législatif et, plus encore, la compétence technique au détriment de la représentativité politique, tout en appelant l’émergence d’un leadership renouvelé, d’une figure du chef au-dessus des contingences immédiates, capable d’indiquer le cap et d’arbitrer entre les intérêts contradictoires ; ils s’appuient sur des nouvelles représentations de la société (par exemple, dans les années 1950, l’apparition du groupe des « cadres » dans la nomenclature des CSP), sont portés par des médias (L’Express, Le Monde), enseignent dans les écoles du pouvoir (Sciences Po, ENA) et sont réunis bien souvent sous la houlette des commissions de modernisation du Commissariat général au Plan.
Ces « modernisateurs » de la haute fonction publique et ces acteurs sociaux mobilisés à travers la planification vont trouver dans le changement constitutionnel l’occasion inespérée de chercher à transformer à leur profit les règles du jeu politique pour réaliser le programme de modernisation de la société française dont ils se veulent les principaux maîtres d’œuvre. Et le soutien intéressé de ces élites va permettre au nouveau régime de s’inscrire dans une certaine « modernité », d’accréditer des transformations dans la pratique du pouvoir et, en premier lieu, la prépondérance du pouvoir exécutif sur le législatif. Toutes les premières politiques publiques de la Ve République – dont l’origine est le plus souvent antérieure à 1958 – vont consacrer ces élites « modernisatrices » et dessiner un nouveau mode de régulation politico-administratif – caractérisé par l’alliance des hauts fonctionnaires et des représentants socio-professionnels dans une forme de « corporatisme sectoriel » contrôlé par l’Etat – qui perdurera jusqu’à la crise de l’Etat-providence dans les années 1970.
Sous la Ve République, la domination présidentielle n’est pas en réalité que la domination du président de la République.
Ce ralliement à la Ve République des « modernisateurs » (qui n’exclut pas, souvent, une opposition au gaullisme) fournit un véritable socle social au nouveau régime, quand il ne lui fournit pas aussi des points d’appuis directement politiques. Ce sont eux qui défendent par exemple, depuis le milieu des années 1950, l’élection directe du président de la République, et l’opération « Monsieur X » où ils se retrouvent tous avec le club Jean-Moulin pour essayer de faire élire Gaston Deferre à la présidence de la République en 1965, si elle est un échec, est aussi une forme très puissante d’accréditation du leadership présidentiel assis sur le suffrage universel.
Ces élites ne défendent pas nécessairement une toute-puissance présidentielle. Mais la domination présidentielle sous la Ve République n’est pas que la domination du président de la République en réalité. Elle suppose l’existence d’une instance de coordination et d’arbitrages interministériels très puissante – Matignon – et une organisation du gouvernement en silos de compétences exclusives, dans lequel ce « corporatisme sectoriel » peut se développer à l’abri du Parlement. C’est cette conception du pouvoir que défendent les « modernisateurs » : une légitimité politique forte au sommet, indépendante des soubresauts parlementaires car fondée sur le suffrage universel direct, et une structure gouvernementale en quelque sorte « technicisée » car divisée strictement en secteurs de compétence.
En donnant de la puissance et du crédit à ce schéma de pouvoir, en le faisant vivre au jour le jour, de politique publique en politique publique, ces élites – et leur univers écologique : médias, écoles, instances d’échanges et de négociation collective, instruments d’action publique – vont naturaliser cette lecture de la Ve République, qui est bien sûr, de fait, celle de la domination présidentielle mais qui est surtout, pour parler comme Nicolas Rousselier, celle d’une nouvelle force de gouverner[2]. Car l’une ne va pas sans l’autre dans la Ve République telle qu’elle se met en place. Et lorsque ce « référentiel modernisateur »[3] finira par se déliter dans les années 1970, le pli aura été pris, nos représentations des institutions en auront été profondément bouleversées, et grâce à la stabilité parlementaire offerte par le « fait majoritaire » – constat se muant en théorie – cette interprétation des institutions ne sera plus véritablement interrogée. La Ve République présidentialiste sera devenue comme une second nature du bon gouvernement de la France.
Pourtant, depuis quelques temps, des doutes apparaissent sur la viabilité ou l’efficacité de ce schéma de gouvernement. Les tentatives maladroites des trois derniers présidents de la République de redéfinir le rôle présidentiel (l’hyper président, le président normal, puis récemment le président jupitérien), comme si ce dernier n’allait plus de soi, sont sans doute le signe d’un dérèglement profond du schéma de gouvernement qui semblait acquis à droite comme à gauche après l’alternance de 1981.
Si le président bénéficie d’une sorte de charisme d’institution, pourquoi la Ve République est-elle aujourd’hui réduite à sa caricature, l’autoritarisme solitaire et sans contre-pouvoirs ?
Pourquoi ? Si l’on s’accorde à penser que la consolidation d’une nouvelle conception de l’exercice du pouvoir sous la Ve République est pour partie liée à ce relais d’élites initial, c’est-à-dire que la force de la Ve République est aussi dans la nature des soutiens qui la font exister, alors il est sans doute possible de penser, de la même manière, son affaiblissement.
Nicolas Rousselier, lors d’un récent colloque à Sciences Po, parlait d’un président de la République « de plus en plus encombré de sa force »[4]. L’expression est très juste. Mais à quoi tient le fait que cette puissance présidentielle ne peut plus s’exercer aussi facilement qu’avant, qu’elle devient très difficile à canaliser, qu’elle apparaît à bien des égards comme arbitraire ? Pourquoi, si le président bénéficie par fonction d’une sorte de charisme d’institution, la Ve République est-elle aujourd’hui le plus souvent réduite à sa caricature, l’autoritarisme solitaire et sans contre-pouvoirs ?
La réponse est sans doute assez simple : les fondements sociologiques de l’exercice du pouvoir ne sont plus les mêmes que naguère, il n’y a plus de forces sociales puissantes qui en rejouent l’évidence tous les jours. Plus encore, la distance est devenue gigantesque entre l’architecture institutionnelle, les conceptions de l’exercice du pouvoir qu’elle porte, et la société. La concentration, la centralisation et la verticalité du pouvoir, l’arbitrage opaque des décisions au sein d’étroits cénacles peuplés par une « noblesse d’Etat » inextricablement liée à celle des affaires par le creuset endogame des « grandes écoles », la caporalisation des débats politiques, l’idée même d’un chef au-dessus de la mêlée ayant seul raison avant tout le monde, sont-elles des conceptions en phase avec la société actuelle ?
Une société qui a connu des transformations considérables depuis 60 ans…Une seule illustration : il y avait 180 000 étudiants en 1958 – qui vivaient d’ailleurs dans un certain entre-soi social –, il y en a aujourd’hui plus de 2,5 millions. Peut-on penser que cela n’a aucun effet sur la conception de l’exercice du pouvoir et les conditions de sa légitimation ? Là où il faudrait une démocratie plus vivante, pluraliste, inclusive, sociale, mieux inscrite sur les territoires de la vie quotidienne, favorisant le débat et la co-élaboration citoyenne des politiques publiques, la Ve République ne sait répondre que par la vision surannée de l’homme providentiel, à qui tout est délégué pendant cinq ans, sans aucun véritable contre-pouvoir.
Il faut alors, pour penser les limites et les faiblesses actuelles de la domination présidentielle – et de la Ve République plus généralement –, oublier un instant le design institutionnel et les rapports de force politiques, ne pas focaliser outre mesure sur le cas Macron (qui n’est qu’un symptôme, même si son mépris des corps intermédiaires ne peut qu’aggraver la situation), et s’interroger sur les mécanismes sociaux de la légitimation de l’exercice du pouvoir. Car la « modernité » de la Ve République, pensée dans les années 1930 puis dans l’après-guerre, et réalisée à travers un aggiornamento des élites gouvernantes dans les années 1960, reposait sur un modèle du « bon gouvernement » qui est sans doute, en réalité, devenu obsolète aujourd’hui. Sociologiquement la Ve République est mourante, et rien ne pourra la sauver.
