Pourquoi les programmes d’histoire déchaînent-ils tant de passions ?
Il est très rare que la publication d’un nouveau programme d’histoire, même lorsqu’il ne s’agit que de menus changements à la marge, ne suscite pas une controverse désormais largement relayée par les médias. L’histoire passionne nous dit-on, et sans doute devrait-on s’en réjouir, nous qui l’écrivons et l’enseignons ; mais voilà, la teneur des débats n’est pas toujours – loin s’en faut – à la hauteur de nos attentes. Surtout, depuis quelques dizaines d’années, et comme une ironie du sort, les praticiens sont peut-être ceux que l’on entend le moins sur le sujet. Quel autre métier est à ce point confisqué par le spectacle médiatique que celui d’enseignant ? Quelle autre matière que l’histoire fait l’objet d’une telle surveillance politique et sociale ? A l’aube de la publication des nouveaux programmes de lycée, l’affaire mérite qu’on s’y arrête quelque peu.
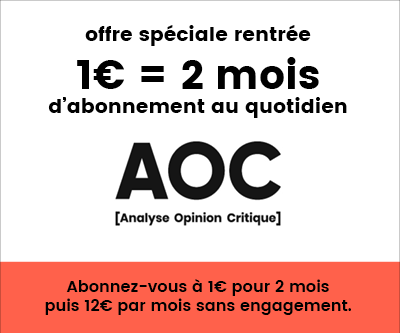
On s’interroge souvent sur les raisons de cette charge émotionnelle et politique de l’histoire et de sa transmission. Concernant l’histoire scolaire, les raisons sont à chercher dans la mise en place du projet d’une école publique aux programmes scolaires nationaux à la fin du XIXème siècle. L’heure est à la construction nationale ; l’école publique doit servir à la fois la cause de l’instruction des masses et l’institutionnalisation d’un sentiment national français commun susceptible de dépasser les appartenances locales. La France de la fin du XIXème siècle est une mosaïque culturelle ; du Nord au Sud, certains enfants ne se comprennent pas. L’école est chargée d’agir comme un creuset, particulièrement l’école primaire, et ce bien avant les lois Ferry de 1881-1882 qui viendront souvent sanctionner l’existant.
Dans ce cadre-là, quelques disciplines sont profilées pour servir cette grande cause, politique s’il en est. Parmi elles la géographie et son acolyte l’histoire. C’est à ce moment, et pour le même dessein, que les deux disciplines se nouent. Le sentiment national français devait passer par l’apprentissage d
