Aude : apprendre d’une crue
Les inondations meurtrières de l’Aude de ce début octobre nous ont fait revivre une dramaturgie habituelle : après la catastrophe, les médias multiplient les reportages chocs, les digressions sur la brutalité de la « nature », les responsables politiques affichent précipitamment leur émotion, mettent en scène leur compassion envers les victimes, quelques hommes/femmes d’État organisent un voyage sur place pour assurer la présence et la sollicitude des pouvoirs publics ; on en profite en général pour garantir l’indemnisation rapide des victimes, ce qui ne sera pas toujours le cas, que l’on restaurera sans délais les infrastructures et les équipements, ce qui ne sera pas non plus toujours le cas, qu’on mènera une politique vigoureuse de renforcement de la protection des populations et des biens et de la prévention des risques.
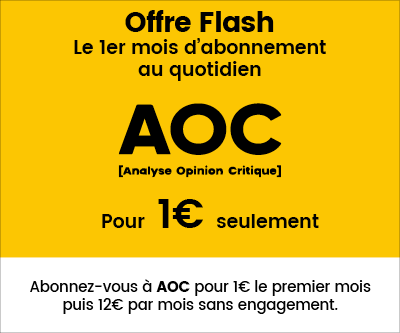
Cette dernière annonce est condamnée à échouer compte tenu de la manière erronée dont on approche le problème. En effet, ce nouvel épisode de crues dévastatrices procède moins de l’aléa naturel que des choix de développement territorial réalisés depuis les années 1960 par les élus locaux et nationaux – avec le consentement, il faut le rappeler, d’une majorité des citoyens qui n’ont que rarement remis en question la logique de ces choix car il servaient les leurs, et avec le plein accord des acteurs économiques – qui nous ont engagés, nous les co-habitants de ce pays, dans une impasse. Piégés dans cette impasse, nous assistons, groggys et impuissants, à la déclinaison française d’une menace globale, celle qui pèse sur l’habitabilité des territoires en raison de l’entrée dans l’anthropocène.
On dit souvent que « l’urbanisation » serait responsable de ce genre de drame – et la présente crise n’échappe pas à cette règle. On explique que bien des quartiers emportés par les crues sont relativement nouveaux et souvent édifiés en zone inondable ou encore que l’imperméabilisation des sols renforce la puissance érosive des écoulements brutaux (elle accentue le débit et la vitesse des flux). Tout cela est connu et parfaitement exact, mais on doit approfondir l’analyse et la généraliser.
Le présent débordement de l’Aude est la conséquence prévisible et banale de plus d’un demi-siècle de décisions publiques et de choix rationnels des habitants.
Car nous ne venons pas d’assister à une catastrophe isolée, mais à un épisode presque ordinaire, quoique de forte intensité, qui succède à tant d’autres ; les évènements pluviométriques de ce type et les inondations destructrices, tout comme les tempêtes d’ouest, sont et resteront monnaie courante – le changement global pourrait même renforcer l’occurrence et la force de tels phénomènes. Bref, nous serons toujours exposés à l’endommagement des habitats par les crues et les vents, presque partout en France.
Ainsi, il faut saisir que le présent débordement de l’Aude, comme tous les épisodes comparables qui ont précédé ici ou ailleurs, ou les futurs qui ne manqueront pas d’advenir, s’avère moins le résultat de la seule abondance « exceptionnelle » des précipitations que la conséquence prévisible et banale de plus d’un demi-siècle de décisions publiques et de choix rationnels des habitants. Pour bien le comprendre, il faut d’abord abandonner l’idée que la « nature » serait une extériorité de la société. Renonçons donc à une vision qui sépare deux « mondes » irréductiblement distincts : l’humain et le social, d’un côté et le bio-physique, de l’autre, car l’un et l’autre font système ! Pour le dire autrement, l’humain et le social, le biologique et le physique trament conjointement et indissociablement le moindre espace géographique.
La crue de l’Aude ne nous a pas touchés comme un aléa venu de l’extérieur, car elle est la manifestation d’une caractéristique interne de notre système spatial : une émergence catastrophique s’exprimant de l’intérieur de celui-ci et révélant son état. Admettre cette position conduit à considérer qu’on ne peut se protéger des évènements extrêmes et de leurs effets comme on se protègerait d’une menace externe. De ce fait même, il importe, à partir de cette reconnaissance du système que forme notre espace de vie collectif et de celle de l’imparabilité du changement global, d’inventer une nouvelle « diplomatie spatiale » et des relations « géopolitiques » inédites entre le social, l’humain, le biologique et le physique, qui nous permettraient de mieux habiter une planète-terre qui est notre seule demeure.
Cette crue dévastatrice est donc une expression banale et élémentaire (hélas !) des effets systémiques des principes de territorialisation auxquels la société française dans son ensemble a adhéré depuis les années 1960 ; ce sont eux qu’il faut mettre au jour.
Premier de ces principes : le développement sans contrôle de la péri-urbanisation, concernant toutes les communes françaises, même les plus petites et faisant de notre pays un des cas les plus spectaculaires qui soit d’un étalement diffus – que les géographes appellent depuis longtemps, par une métaphore expressive, le mitage – qui installe une organisation spatiale constituant une véritable prégnance géographique, dominée par le pavillonnaire et la discontinuité. Plébiscitée, elle possède pourtant de nombreux désavantages objectifs :
Elle coûte cher au plan de l’infrastructure, des bâtiments, de l’aménagement et de l’équipement. D’ailleurs son déploiement n’aurait jamais été possible sans l’investissement massif de la puissance publique qui a solvabilisé un modèle sans cela insoutenable et qui a autorisé le développement d’une petite industrie florissante du pavillonnaire, alimentée sans cesse par les aides à la construction.
Elle exige des logistiques automobiles très énergivores et consommatrices de temps.
Elle tend à isoler les ménages au sein de leur citadelle domestique et à renforcer les choix utilitaristes de ceux-ci.
Elle exige le développement d’équipements de commerce et de service groupés en périphérie pour maximiser l’accessibilité – et aujourd’hui elle semble faciliter le développement du e-commerce.
Elle consomme beaucoup de foncier au regard du nombre de personnes et d’activités accueillies.
Nous ne sommes pas prêts à pouvoir assumer encore toutes les conséquences de cette volonté de construire une société de familles propriétaires, goûtant l’apparence d’une vie authentique « à la campagne ».
Le pavillon individuel péri-urbain avec jardin, isolé ou en lotissement, et son « environnement » (routes, centres commerciaux et de loisirs, accueillant de nombreux magasins spécialisés dans l’équipement du logis comme les jardineries ou les enseignes de bricolage) fut et reste offert, à grands coups de publicités, de facilitations économiques et fiscales et de relais idéologiques de la puissance publique, comme le véritable idéal résidentiel pour les français. On peut même parler de la promotion officielle d’un modèle d’habitation périphérique pavillonnaire, qui imposait une condition nécessaire : la désinvolture des autorités en matière d’attribution sans entraves, ou peu s’en faut, des permis de construire, notamment dans des zones exposées aux aléas les plus courants (tempêtes, orages torrentiels, inondations) où se trouvaient des surfaces disponibles en grande quantité (et pour cause !). Nous ne sommes pas prêts à pouvoir assumer encore toutes les conséquences de cette volonté de construire une société de familles propriétaires, goûtant l’apparence d’une vie authentique « à la campagne ».
Ceci s’est accompagné d’un autre choix délibéré : celui de la médiocrité des aménagements architecturaux et paysagers ordinaires, notamment en périphérie des « entrées de villes », par souci de rentabilité et d’efficacité fonctionnelle immédiates. Il n’y a qu’à lire les codes de la construction et de l’urbanisme pour s’apercevoir que la question de la qualité du bâti et des paysages n’est pas la préoccupation principale.
Ajoutons que les promoteurs de cette France périphérique ont longtemps négligé les questions d’artificialisation de très vastes périmètres péri-urbanisés (qui couvrent beaucoup plus d’étendue que les secteurs denses centraux et péricentraux). Par facilité technique et gestionnaire, on a mis en place, par exemple, des systèmes d’écoulement des eaux dysfonctionnels, on a imperméabilisé les surfaces au-delà du nécessaire, on a multiplié les voies et les parkings surdimensionnés par rapport au nombre de personnes et de marchandises acheminées.
Il faut aussi insister sur la politique qui a conduit à privilégier constamment une agro-industrie globalement indifférente aux caractéristiques des territoires, puissant vecteur d’appauvrissement des milieux biotiques et des écosystèmes, constituée en groupe d’intérêt surpuissant, paralysant par anticipation la moindre remise en question officielle de ce modèle, et compromettant ainsi la mise en place d’un autre système productif, varié et créatif, dont on sait pourtant qu’il est viable.
Enfin, on terminera cette liste non exhaustive par le rappel de l’impact de la décision de faire, dans ces mêmes années 1960, du tourisme de masse un nouvel horizon pour des espaces littoraux et montagnards alors en pleine déprise en raison de l’achèvement de l’exode rural. Certes, il y eut reconquête, mais à quel prix ! Aujourd’hui ces espaces sont durablement déséquilibrés et fragilisés par cette politique d’équipement massif, qui continue d’être soutenue par les autorités.
Les acteurs politiques qui auraient pu, après les lois de décentralisation, inventer une nouvelle manière de faire-territoire, y ont renoncé en privilégiant une relation de clientèle avec L’État central.
Cette série de choix manifeste une orientation politique cohérente et durable, qui s’explique par une convergence des intérêts de tous ceux qui ont porté le pacte territorial et social de la Ve république : l’alliance des acteurs politiques, ceux de l’État, mais aussi ceux des collectivités locales – qui auraient pu, après les lois de décentralisation, inventer une nouvelle manière de faire-territoire, ce à quoi ils ont renoncé en privilégiant une relation de clientèle avec L’État central, qui est d’ailleurs en train de se rompre, à leur grand dam, en raison de la crise budgétaire – de la classe moyenne salariée et des opérateurs économiques longtemps protégés des concurrences de la mondialisation par l’écran qu’à constitué ce pacte.
La catastrophe de l’Aude est donc un rappel de plus de l’impact de la préférence nationale pour la péri-urbanisation pavillonnaire peu dense et peu intense, accompagnée de son double nécessaire : la défense de la ruralité. Une ruralité fantasmée, en vérité, et dont la manifestation géographique est celle d’une agriculture industrielle occupant en continu de vastes espaces dépeuplés, dépensière en énergie et en intrants phytosanitaires et qui accentue par effet de système l’exposition de vastes territoires aux endommagements climatiques et hydrologiques. Au sein de ces espaces agricoles monotones et déserts, sillonnés par des routes bordées de fossés de drainage et jalonnées de ronds-points, on trouve partout des grappes pavillonnaires, d’improbables centres commerciaux surgis de nulle part, des communes anciennes qui dépérissent. Bref une géographie extensive, de médiocre facture et aux fragilités environnementales, économiques et sociales évidentes.
L’empire de cette trame péri-urbaine et rurale ne doit rien au hasard : nous l’avons plébiscité collectivement depuis des lustres et nous continuons de vouloir le faire. D’ailleurs le nouveau ministre de l’agriculture, dès la cérémonie de passation de pouvoir, le 16 octobre, a voulu se poser en défenseur de la ruralité alors que la ministre de la cohésion territoriale a insisté quant à elle sur le soutien aux départements qui, historiquement, sont les parangons de l’apologie des territoires de faible densité et les hérauts de la lutte contre la métropolisation.
Nous ne sommes donc pas prêts, officiellement, à changer de paradigme, ni à modifier le référentiel qui consiste à vouloir se prémunir de la catastrophe par un renforcement des protections, sans modification réelle des principes de territorialisation précités. Pourtant, la succession des événements, dont cette dernière inondation, souligne qu’il faudrait délaisser la pensée dominante de la prévention du risque comme danger extérieur.
Cette obsession du risque conduit à une dramatisation des enjeux des politiques publiques et à une surenchère technique et normative permanente – source de déception, puisque jamais on ne parvient ni au risque zéro, pur fantasme d’abstraction, ni même à une maîtrise parfaite des conséquences d’aléas ordinaires et fréquents.
Il n’existe pas d’exemple dans l’histoire de l’anthropisation de la planète d’habitation humaine qui n’aurait pas été frappé du sceau de la fragilité.
À rebours de cette position, on serait bien inspiré d’admettre que les espaces humains, parce qu’ils sont des systèmes spatiaux complexes, des composés impurs et bricolés d’humanité, de société, de nature, dont l’organisation par les groupes sociaux requiert une énergie et des moyens colossaux, s’avèrent intrinsèquement « toujours-déjà » vulnérables. Il n’existe pas d’exemple dans l’histoire de l’anthropisation de la planète d’habitation humaine qui n’aurait pas été frappé du sceau de la fragilité.
La chose n’est donc pas nouvelle mais, durant des décennies, les enthousiasmes liés à la croissance économique et les certitudes prométhéennes qui accompagnaient le développement des nouvelles ingénieries ont occulté cette réalité élémentaire. Nouveau, en revanche, le fait que la vulnérabilité devienne, via la médiation d’un nouvel imaginaire contemporain, un enjeu cognitif, culturel, politique à toutes les échelles d’espaces et de temps : n’est-ce pas ce que signifie l’entrée dans l’anthropocène, marquée par la redécouverte du principe de vulnérabilité généralisée ?
Bien sûr, certaines formes spatiales, notamment celles que nous avons privilégiées en France, semblent plus sujettes à la catastrophe que d’autres. Mais de plus pauvres et rudimentaires seraient tout aussi fragiles. De même que l’ingénierie de la prévention des risques se trompe en pensant surpasser le désastre possible par la puissance, de même les décroissants se fourvoient en présentant les habitats qui découleraient de l’application de leurs principes comme moins vulnérables. Ils le seraient autant, mais différemment.
Or, la vulnérabilité des systèmes spatiaux, si elle les met en danger, comme on l’a vu dans L’Aude, constituerait un possible vecteur de dynamiques sociales, économiques, géographiques et de créativité. En clair, elle est potentiellement aussi constructrice que destructrice. L’espace soutenable serait alors celui dont l’organisation permettrait non seulement d’affronter sa vulnérabilité, mais mieux encore d’en faire un principe d’évolution et même de relancer la réflexion sur la justice spatiale.
Et si la reconnaissance politique et culturelle de la vulnérabilité permettait d’inventer des perspectives nouvelles d’évolutions des territoires français, notamment là où les expositions à l’endommagement sont fortes ? Le pari serait alors d’insérer la vulnérabilité dans de nouveaux pactes sociaux et territoriaux et d’en faire une chose commune et publique, source de politiques différentes, afin de faire évoluer le système spatial de manière à ce qu’il soit plus apte à soutenir les manifestations du bouleversement écosystémique que nous avons enclenché et qui constitue désormais une dimension de nos cadres de vie.
