La police bientôt dotée d’une nouvelle arme dangereuse : l’amende forfaitaire délictuelle
Ce lundi 19 novembre, les députés s’apprêtent à examiner en procédure accélérée un texte de loi portant « programmation 2018-22 et réforme » de la justice. Ce texte vise dans un contexte budgétaire étique à accélérer et simplifier les procédures, comme tant d’autres avant lui. Dans un texte qui lui vaut aujourd’hui une poursuite en diffamation, Laurent Mucchielli rappelait à ce titre l’indigence budgétaire de l’appareil judiciaire français. La Commission des lois du Sénat s’était montrée particulièrement inquiète de voir les impératifs de rationalisation budgétaire primer l’efficacité de la justice et du droit. La loi en effet étend à une majorité de délits et sans autorisation judiciaire les moyens intrusifs d’enquête (géolocalisation, enquête sous pseudonyme, écoute téléphonique, sonorisations…), autrefois réservés au terrorisme et à la criminalité organisée, elle confie aux enquêteurs des pouvoirs accrus (extension des délais de flagrance et des possibilités de perquisition, présentation facultative du gardé à vue au procureur, modes de comparution encore accélérés, marginalisation accrue du juge du siège et du juge d’instruction, etc.).
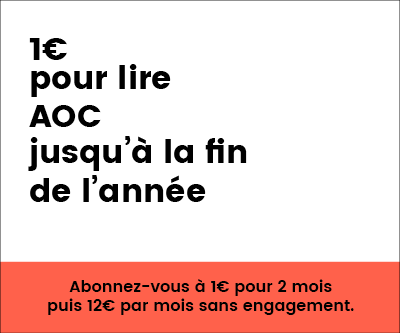
Le texte prévoit également, « pour assurer une meilleure réponse pénale » et alléger « significativement » les tribunaux, une procédure d’amende forfaitaire délictuelle en cas d’usage de stupéfiants (article 37).
Cette dernière innovation mérite que l’on s’y attarde tant elle incarne deux aspects récurrents de la sociologie du droit. Le législateur a montré une indifférence notoire à la pratique de celles et ceux appelés à mettre en œuvre l’innovation de l’article 37, et à la sociologie des publics concernés. Une simple lecture du rapport de la Commission des lois, de l’étude d’impact ou de l’avis du Conseil d’Etat suffit à en convaincre : ce sont les préoccupations internalistes (cohérence du texte, architecture pénale générale, etc.) et budgétaire qui monopolisent l’attention.Ce sont les policiers et les gendarmes qui mettront en œuvre l’amende forfaitaire et qui se verront ainsi en position de constater l’infraction (leur fonction essentielle d’officier de police judiciaire), mais aussi de la sanctionner. Et la portée réelle de l’amende nouvelle sera de nature bien différente selon les publics visés. Car sa particularité est qu’elle touchera tant le bourgeois que le prolétaire (l’écriture bisexuée est inutile ici : cet art. 37 ne touchera que les hommes ou peu s’en faut), la thèse récente de Kathia Barbier permet peu d’en douter (Accessoires. L’invisibilisation des femmes dans les procédures pénales en matière de stupéfiants, doctorat de sociologie, Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 2016). D’un côté, donc, l’amende forfaitaire affecte l’exercice même de la force publique. De l’autre, elle raffine l’art de punir, en touchant aux modalités de conduite des existences individuelles, et ce de manière différente selon les groupes sociaux.
La loi ne change pas la nature de la consommation de stupéfiants : contre les promesses de campagne, certes d’un flou bien savant, d’Emmanuel Macron, contre ce que recommandait le rapport de la mission d’information parlementaire Poulliat-Réda (pages 63-75), le geste reste un délit. L’amende est par conséquent « délictuelle » et son règlement par timbre-amende s’accompagne d’une inscription au casier judiciaire. La possibilité de faire de l’usage de cannabis une infraction contraventionnelle a été écartée, qui aurait privé les policiers du pouvoir de garde à vue et d’interrogatoire [1], confirmant ainsi ce que la recherche avait il y a longtemps déjà mis en évidence : le délit de consommation doit essentiellement sa pérennité aux revendications de la police judiciaire.
En sa rédaction actuelle, la loi permet aux policiers et aux gendarmes de sanctionner le délit qu’ils constatent en flagrance et cette sanction est une condamnation, avec tout ce que cela implique : premier terme de la récidive, inscription au casier judiciaire. L’auteur de l’infraction se voit ainsi infliger une amende forfaitaire de 300 €, minorée à 250 € s’il s’en acquitte sur le champ ou dans les 15 jours, majorée à 600 € s’il omet de s’en acquitter. L’effet d’opportunité n’est pas négligeable. En 2016, ce ne sont pas moins de 140.000 personnes qui ont été interpellées pour consommation, environ 30.000 portées devant un tribunal correctionnel. Gain de temps, de ressources humaines, d’argent : l’article 37 résume bien la loi nouvelle. Il résume également bien la précipitation de la procédure législative : l’urgence demandée par le gouvernement permet d’écarter une évaluation prévisionnelle saine du dispositif, passant outre les mises en garde du rapport Poulliat-Réda, dans les pages 44 à 53. Au passage, il entérine la conviction partagée selon laquelle les alternatives à la peine (l’injonction thérapeutique ou les stages de sensibilisation) sont de peu d’effet. Fi désormais de l’apparent souci de santé publique : l’usage de cannabis entraîne peine, et voilà tout.
Personne n’a toutefois envisagé la pratique de l’amende : en quoi consiste, pour un policier ou un gendarme, dresser une amende pour un fait de voie publique ? Sur ce point, la thèse de doctorat de sociologie que l’un d’entre nous (Kamel Boukir) vient de soutenir, une ethnographie au long cours de jeunes hommes d’une cité de la banlieue parisienne, fournit une observation précise des pratiques policières en la matière [2].
Au cours de ce travail, j’ai pu observer une mutation du pouvoir de punir, peut-être aussi une transformation de la force publique. Trois des jeunes hommes dont les parcours sont relatés dans la thèse reçoivent un beau matin une convocation pour comparution au tribunal de police. A la barre, ils doivent répondre de faits survenus un peu moins d’un an plus tôt, très précisément un 23 juillet à 23h20 au 12 rue du Maréchal-Ferrant. Interloqués, les trois comparants expliquent qu’ils n’ont aucune idée de ce qu’ils pouvaient bien avoir fait cette nuit-là. C’est qu’une convocation au tribunal pour « tapage nocturne » (contravention de 3eclasse, alors passible du tribunal de police) leur a été dressée. Rien n’oblige en effet de signaler au contrevenant le constat de l’infraction et, dans un contexte d’interconnaissance forte entre policiers et jeunes, s’arrêter pour relever les identités devient même superflu. Le dernier prévenu aura bien tenté d’expliquer qu’ils fêtaient l’obtention de leur baccalauréat, espérant susciter l’empathie des juges à l’égard de ces justes célébrations, mais la sanction frappait les trois à parts égales : 392 € d’amende chacun.
Dans la cité, la stupéfaction des jeunes est accueillie avec lassitude et résignation. On leur apprend en effet que, pour reprendre les termes d’un de leurs camarades, « Les condés, maintenant, ils s’arrêtent même plus quand ils passent : ils voient qu’on est posé là et, v’là, tu reçois une convocation. Qu’est-ce que tu veux faire ? ». Ainsi, tout un ensemble de jeunes adultes, pour des raisons qui tiennent à leurs modes de vie et à leur qualité de « connus des services de police », paient la transparence de leur identité au regard policier par une dette de plusieurs centaines, plusieurs milliers d’Euros auprès du Trésor public. S’il est une police de proximité, c’est bien celle des officiers de police judiciaire à leur clientèle, qui a toutes les chances désormais de se régler à coups de timbres-amendes.
Certes, l’usage de stupéfiants n’est pas le tapage nocturne : le premier est un délit, le second une contravention. En matière contraventionnelle, la parole de l’agent est quasi irréfragable. En matière délictuelle, la charge de la preuve reste à l’autorité poursuivante : la personne concernée peut demander au tribunal de démontrer la matérialité des faits. Cette éventualité est tout à fait à exclure concernant ces jeunes de cité. Car la loi pénale ne se déploie pas à l’identique selon que l’on est pauvre ou que l’on est riche, selon que l’on est un citoyen ordinaire ou une personne connue des services de police. Pour celles-ci, préférer à un timbre-amende de quelques centaines d’Euros une coûteuse et risquée procédure judiciaire où leur parole se mesurera à celles des policiers défie toute rationalité. Les plus optimistes imagineront sans doute que le prévenu contestera que le joint fourni par les policiers comme preuve de la matérialité des faits n’est pas le sien et demandera une analyse génétique du matériel… mais le budget de la justice étant ce qu’il est (on y revient), on imagine mal une telle demande prospérer, aussi improbable qu’une recherche ADN sur un scooter endommagé.
Pour les publics qui ne disposent pas d’une respectabilité sociale à toute épreuve, la « forfaitisation » de l’usage de stupéfiants est ainsi une arme supplémentaire dans les mains de celles et ceux des forces de l’ordre qui vivent leur travail dans les cités comme une guerre d’usure avec leurs clientèles. Elle permet d’arguer de la consommation de cannabis sur la voie publique pour, aux fins de disciplinarisation des concernés, épuiser l’adversaire. A défaut de « faire des bâtons » (i.e. constater des délits), la forfaitisation permet de « faire du TA » (du timbre-amende) et montrer à la hiérarchie, si nécessaire, ou lorsqu’elle le demande, qu’on travaille, comme Fabien Jobard a pu l’observer lors de ses observations de brigades anti-criminalité en grande banlieue parisienne. Le TA a un rendement immédiat. Autrefois, le procureur était souvent tenté de ne pas sanctionner le mis en cause que lui présentait le policier ou ne le faire que par « rappel à la loi », ce que les policiers tiennent pour mépris de leur travail. En 2016, ce ne sont pas moins de 45.000 rappels à la loi qui ont été ainsi prononcés. Ils donnent une idée du volume des amendes à venir. Au forfait, le temps investi est minimal et le gain est sûr. C’est bien d’ailleurs le sens de la loi : que tout le monde y trouve son compte, en économisant le temps de tous. Ou, comme le résume un policier entendu par Kamel Boukir sur son terrain, lors d’une confrontation avec un jeune homme qu’il connaissait de visu et (plus important !) de nom et prénom : « Tu veux manger un tapage ? ».
L’actuelle pratique policière suggère que l’effet premier de la forfaitisation consistera en un resserrement des mailles du filet répressif autour des jeunes hommes de cité, entraînant alors une augmentation des constations de consommation illicite, toujours susceptible d’inviter le législateur à la mémoire courte un alourdissement des peines encourues ; phénomène d’auto-alimentation bien connu de la machine pénale. Pour eux, la forfaitisation pèse comme une épée de Damoclès permettant d’aisément sanctionner le simple fait de se trouver sur la voie publique, le fait d’avoir un contentieux en cours avec tel ou tel policier, tel ou tel gendarme, le fait de ne pas être au bon endroit au bon moment. Les conséquences peuvent être lourdes, car à un accès déjà bien tendu au marché du travail légal, il faudra ajouter le poids d’amendes dues au Trésor public (ce qui d’ailleurs sera susceptible de peser sur la décision de s’engager sur le marché du travail légal). Et l’allongement des délais de prescription récemment adoptée [3] fait planer la menace toujours plus durable d’une condamnation en récidive, donc d’une condamnation plus lourde. Pour eux, la procédure participe d’une emprise policière supplémentaire sur la conduite de leurs existences. Là où les dynamiques d’entrée dans la vie adulte étaient déjà obérées par le passé pénal et le casier judiciaire, les amendes impayées viennent retarder l’avenir.
On insiste souvent sur le fait que, dans ces espaces urbains, le rapport à la police est souvent empreint de violence. On pourrait se réjouir qu’à la matraque se substitue le timbre-amende, à la brutalité de la relation l’injonction de payer, dernière manifestation en date de la civilisation des moeurs. La bureaucratisation de l’existence se substituerait à la violence erratique, la violence pécuniaire à la violence physique. On ne saurait toutefois prédire s’il y aura bien substitution, et non simple ajout de l’un à l’autre, si aux violences toujours plus probables qu’ailleurs s’ajoutera simplement le fardeau du Trésor public. Surtout, cette forfaitisation (suprême ironie au moment où l’on tente de rapprocher police et population) accroît le pouvoir discrétionnaire des agents à l’encontre de ceux-là mêmes qui partagent la conviction qu’ils sont surexposés à l’iniquité de la police et de la justice et qui nourrissent à l’égard des institutions publiques rejet, ressentiment, violence. Pour cette jeunesse-là, la forfaitisation de l’usage de cannabis est bien une transformation de l’économie des pratiques répressives, qui ne change pas l’horizon de ce qui leur est permis d’espérer, mais l’obscurcit un peu plus.
Mais ce public électif n’est pas le seul qui doit craindre l’innovation législative. Les policiers pourront désormais sanctionner les acheteurs qui, venant des centres-villes ou des quartiers favorisés, s’approvisionnent dans les proches banlieues. Sauf politique locale arrêtée entre le commissaire et le procureur, ces consommateurs aisés n’étaient jusqu’à présent pas poursuivis, ils nourrissaient le gros des 45.000 rappels à la loi. Pour ces jeunes et moins jeunes bourgeois, la forfaitisation modifie les termes du jeu du chat et de la souris : un coup de sifflet, et c’est 300 €. Au resserrement des mailles du filet pénal pour les uns s’ajoute l’extension de ce même filet pour les autres, susceptible à son tour d’augmenter la statistique de la consommation de stupéfiants constatée par les services de police et de gendarmerie, avec les effets évoqués ci-dessus…
La peine en elle-même est indolore pour ce public. Mais l’inscription au casier judiciaire, elle, ne l’est pas, car elle obère des chances de concourir à des postes de la fonction publique et à tout un ensemble de professionnelles réglementées comme architecte, pharmacien, médecin, avocat, ou d’emplois chez EDF, SNCF, Banque de France, ou encore aux métiers de la sécurité, etc. Chez les uns, c’est la condamnation qui frappe, chez les autres l’inscription. Dans les deux cas, il s’agit d’une peine-créance : l’amende délictuelle pèse sur la conduite des existences individuelles, soit en corrompant le travail par la menace de saisie sur salaire, soit en privant des jeunes hommes des voies professionnelles auxquelles ils aspirent. La loi pénale exerce ses effets de manière ainsi nettement différenciée selon les groupes sociaux. Elle frappe chaque fois le capital dont on dispose ou celui auquel on peut aspirer : le capital économique (l’espoir d’un salaire qui permet de démarrer dans la vie) ou le capital scolaire (la possession des titres qui permettent l’accession à la fonction publique ou à des professions réglementées). Dans les deux cas, la forfaitisation qui confie aux policiers et aux gendarmes le droit de punir accroît bel et bien l’emprise des forces de l’ordre sur la Lebensführung des jeunes hommes français, sur la conduite de leurs existences individuelles ce qui, dans un contexte international contraire de dépénalisation ou de légalisation du cannabis, fait de la France un pays aux dispositifs disciplinaires bien singuliers.
