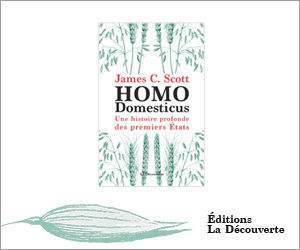Repenser le droit à l’heure de l’Anthropocène
L’Anthropocène est une nouvelle phase de l’histoire où l’espèce humaine deviendrait une force tellurique capable d’interagir avec les autres forces géophysiques et d’entraîner des conséquences durables pour notre écosystème. [1] Ces interactions ont été mises en lumière dans diverses perspectives scientifiques (géologie, sciences de la terre, géographie, climatologie) mais la prise de conscience est plus tardive dans les sciences humaines et sociales. Elle a commencé à atteindre le droit et la philosophie du droit à travers le droit dit « de l’environnement » et se cristallise plus particulièrement autour du dérèglement climatique, mais elle remonte plus loin.
Les sociétés sont désormais prises dans un mouvement de « collectivisation humaine » (P. Teilhard de Chardin) dit mondialisation, ou globalisation si l’on se réfère à la forme sphérique de la Terre. Dès la fin du 18ème siècle Kant fonde sur cette forme sphérique le droit à ne pas être traité en ennemi dans le pays où l’on arrive. Le principe « d’hospitalité universelle » s’impose selon lui parce que la dispersion à l’infini est impossible et que les relations de plus en plus étroites entre les peuples sont portées au point « qu’une violation de droits dans un lieu est ressentie partout». À son époque la planète abritait à peine un milliard d’êtres humains. Deux cents ans plus tard, la population mondiale avait triplé (1 milliard tous les 100 ans). Entre 1950 et 2010, s’ajouteront en soixante ans 4 autres milliards d’êtres humains (1 milliard tous les 15 ans !). Nous avons dépassé les 7 milliards et atteindrons bientôt 8 milliards. Autant dire que nous entrons dans une phase de compression, où le « serrage de la masse humaine » (P. Teilhard de Chardin), renforcé par la révolution numérique, accroît les interdépendances entre groupes humains (tribus, États, groupes d’États, entreprises) et plus largement entre les habitants, présents et futurs, humains et non humains, autrement dit entre les divers « collectifs » qui composent l’écosystème Terre.
Ce constat heurte de front un droit international traditionnellement construit sur la souveraineté des États, indépendants sur leur territoire. Si les interdépendances traversent les frontières, la raison d’État n’a pas disparu et continue à imposer des limites aux droits de l’homme au nom de la sécurité de la nation. Elle est cependant concurrencée par la raison économique et le dogme de la croissance qui ouvre les frontières aux marchés et à l’exploitation des ressources naturelles. Tandis que la crainte d’une catastrophe planétaire par épuisement des ressources et/ou dérèglement climatique éveille une raison écologique appelée à limiter la raison d’État pour sauvegarder la sûreté de la planète. Enfin la raison technoscientifique aurait tendance à rejeter toute limite au nom d’une libre recherche qui cultive le dogme de la performance.
Raison d’État, raison économique, raison écologique, raison scientifique, autant de rationalités légitimées chacune par sa dogmatique propre ; autant de « grands récits » (l’État-nation, le Marché, l’Écosystème, voire l’Homme augmenté), dont les conflits risquent d’empêcher politiquement toute gouvernance mondiale et d’exclure juridiquement la possibilité d’un droit commun.
On en arrive à ce « paradoxe de l’anthropocène » qu’au moment où l’Humanité devient une force tellurique capable d’influencer l’avenir de la planète, elle semble impuissante à influencer son propre avenir. À l’heure de la « grande accélération », il resterait peu de temps pour éviter ce que certains appellent déjà « le grand effondrement » de la planète. Or rien (ou presque rien) ne semble changer dans la vision nationaliste et souverainiste qui sous-tend les systèmes de droit conçus et pensés à partir des États.
C’est aux humains, aux milliards d’humains qui habitent désormais la planète et seraient « doués de raison et de conscience » si l’on en croit la déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), qu’il reviendrait d’opérer la métamorphose des interdépendances subies en un destin commun, voulu comme tel pour préserver un monde habitable. La tâche est titanesque car tout l’assemblage des sociétés est à recomposer, y compris l’assemblage juridique dont il sera plus particulièrement question ici.
On voit apparaître de nouveaux concepts (patrimoine commun de l’humanité, biens publics mondiaux), de nouveaux principes (principe de précaution), de nouvelles catégories (générations futures), de nouveaux crimes à interdire (écocide) ou préjudices à réparer (préjudice écologique). Il faudrait plus systématiquement « repenser en profondeur les processus anthropologiques [d’adaptation, d’appropriation et de représentation] qui jouent un rôle central dans les relations entre humains et non humains ».[2] Mais nous ne sommes pas préparés (du moins en Occident) à une telle métamorphose. Tout le vocabulaire (fondations, fondements, droits fondamentaux), toutes les métaphores (pyramide, socle, pilier, même les sources du droit, travesties en « sources fondamentales ») incitent à se représenter l’ordre juridique comme un équilibre statique.
Certes la métaphore des réseaux a permis d’introduire un peu de complexité en remplaçant les relations hiérarchiques par des interactions, horizontales et pas seulement verticales. Mais pour réussir à déloger les anciennes représentations, enracinées dans la culture juridique dominante, il faut une rupture plus radicale, du concept au processus, du statique au dynamique, du modèle au mouvement.
Dans le prolongement des « nuages ordonnés » qui symbolisent l’instabilité des systèmes de droit, s’est ainsi imposée l’étude des souffles (au sens de pneuma en grec qui désigne le souffle et l’esprit) qui forment, déforment ou transforment les nuages.
D’où le livre Aux quatre vents du monde qui commence par repérer (sur une rose des vents imaginaire) les vents qui animent les ensembles juridiques en formation. Il est ensuite proposé de chercher comment le droit pourrait réguler ces contradictions dans l’équilibre dynamique d’une sorte de ronde des vents ; enfin une dernière partie est consacrée aux acteurs et aux dispositifs juridiques qui permettraient de les responsabiliser (notamment à travers l’expérience de la 21ème conférence des États parties, « COP 21 » 2015).
Repérer la direction des vents : une rose des vents
A la recherche de ce qu’il appelait le nouvel esprit scientifique, Bachelard faisait appel aux « forces imaginantes de l’esprit » pour opposer à la fausse objectivité scientifique une épistémologie « non cartésienne ». A l’heure de l’anthropocène, nous avons aussi besoin des « forces imaginantes du droit » pour concevoir un nouvel esprit juridique et opposer une épistémologie « non kelsenienne » à la fausse évidence d’un droit identifié aux États. Mais comment échapper « à la raideur des convictions non discutées » ? Le philosophe écrivait que « si l’on ne peut atteindre tout de suite à la multiplicité ordonnée, on peut se servir de la dialectique comme d’un fracas qui réveille les résonances endormies ».
Pour se servir de la dialectique comme d’un fracas, il faut d’abord la repérer par un constat. Tel est précisément notre point de départ : repérer les principaux vents de la mondialisation et montrer les contradictions, voire les tourbillons, qu’ils génèrent. D’abord entre les vents dominants (liberté contre sécurité, compétition contre coopération). Puis entre les « vents d’entre les vents » (innovation contre préservation, exclusion contre intégration).
La rose des vents permet de faire le point, de savoir où l’on se trouve. Elle n’indique pas le cap à suivre, mais pendant longtemps, chaque « collectif humain » suivait son cap et orientait son système de droit en fonction de ses représentations du monde. Cela fonctionnait, à condition que chacun reste sur son territoire.
Or la globalisation implique une déterritorialisation : qu’il s’agisse des flux immatériels (flux financiers, flux d’informations), des risques globaux (climatiques ou sanitaires) ou des crimes globalisés (trafics, corruption, terrorisme), les frontières qui délimitaient les territoires deviennent poreuses. Au principe de territorialité s’ajoutent non seulement l’extraterritorialité pour les États les plus puissants qui imposent leur système de droit, mais la multi territorialité qui correspond à la pluri appartenance à différents ensembles (par exemple droit national, européen, mondial), voire l’ubiquité (a territorialité) pour les objets virtuels comme les informations.
Pris dans les contradictions que révèle la déterritorialisation, les collectifs humains se rapprochent du « pot au noir », ce lieu au milieu des océans où la rencontre des alizés du nord et du sud provoque au mieux le calme plat (en se neutralisant, les vents paralysent le navire « encalminé »), au pire le naufrage dans les tourbillons de vents contraires car toute organisation sociale suppose un minimum de cohérence.
La réponse ne doit pas être d’empêcher tout mouvement, surtout en ce moment de la « grande accélération » où les sociétés doivent constamment s’adapter, mais de stabiliser les sociétés sans les immobiliser, donc de donner un cap à la future gouvernance mondiale. Or privilégier la direction de l’un des vents au détriment des autres semble détruire tout équilibre. La sécurité sans liberté conduit au totalitarisme, mais la liberté sans sécurité mène au chaos ; la compétition sans coopération conduit au règne de la force (militaire ou économique), mais la coopération sans compétition mène au collectivisme ; l’innovation sans conservation peut conduire à l’effondrement de la planète, mais la conservation sans innovation paralyse ; l’exclusion sans l’intégration, c’est l’enfermement ou la guerre, mais l’intégration sans exclusion peut aboutir à une fusion mortifère. Autrement dit, le triomphe d’un seul vent, quel qu’il soit, conduirait la gouvernance mondiale dans le pot au noir : soit la paralysie dans un système totalitaire, soit le naufrage dans le grand désordre d’un monde où régnerait une compétition féroce.
En revanche, par un mouvement circulaire qui ressemble à une sorte de « ronde des vents » l’énergie produite par les tensions politiques pourrait revitaliser le droit et engendrer des principes juridiques permettant non pas de supprimer les contradictions mais de les réguler en un équilibre dynamique.
Réguler les vents contraires : la ronde des vents
Un équilibre dynamique, c’est un peu comme les temps alternés d’une respiration du monde. Si l’alternance s’arrête, par exemple si la sécurité devient le premier des droits, ou si la compétition étouffe l’esprit de coopération, la mondialisation sera vite asphyxiée. Pour éviter l’asphyxie, chaque couple de vents contraires devra s’ordonner autour d’un principe régulateur qui permettrait de remplacer le « ou » qui oppose par le « et » qui compose. C’est une invitation au renouvellement des logiques juridiques en ajoutant à la logique binaire traditionnelle d’obligation et d’interdiction (obligation de stricte identité / interdiction de toute différence si faible soit-elle, décision de conformité/non conformité) une logique « non standard » de gradation (obligation souple de proximité / décision selon un seuil de compatibilité).
La logique de gradation (fuzzy logic, logique floue) privilégie la fonction de « mesurage », la régulation se faisant par une pesée des intérêts. Ainsi le principe de précaution/anticipation tend à concilier, en comparant le degré de probabilité et de gravité du risque et celui d’acceptabilité, le couple innovation/ conservation qu’il stabilise sans le fixer. De même, avec le principe émergent du « pluralisme ordonné » (universel pluralisé, diversité harmonisée) qui rééquilibre le couple exclusion / intégration : il n’exclut pas toutes les différences mais permet une intégration à contenu variable et à plusieurs vitesses. C’est ainsi que fonctionnent en Europe la « marge nationale d’appréciation » (CEDH) et les « coopérations renforcées » (UE) et au niveau mondial la notion de « responsabilités communes mais différenciées » inscrite dans la jurisprudence de l’OMC et les dispositifs sur le climat (convention Onu, protocole de Kyoto, accord de Paris).
Une telle logique est politiquement plus acceptable car elle ménage les États sans pour autant renoncer à une vision mondiale, mais elle est juridiquement complexe, et supposerait un apprentissage de la complexité, pour éviter d’affaiblir la sécurité juridique. Paradoxalement le flou appelle un surcroît de transparence dans la motivation (pour expliciter les critères de pondération) et de rigueur dans la mise en œuvre (dans l’application des critères et la détermination du seuil de compatibilité).
Toutefois la pondération n’est pas toujours possible : comment pondérer les libertés par rapport à la sécurité ? Il faut revenir à la fonction de « bornage » du droit et poser des limites, selon une logique d’interdiction qui est juridiquement plus simple mais politiquement plus intrusive donc plus difficile à transposer du niveau national au niveau supranational.
Or poser des limites implique un accord sur les finalités du droit, un accord sur une vision commune du bien (les valeurs à promouvoir en termes de droits ou de biens à protéger) et du mal (les comportements à interdire en termes de crimes à sanctionner). La difficulté est qu’à l’échelle de la planète l’accord semble impossible entre un humanisme de séparation et de domination qui sépare l’homme de la nature, et un humanisme d’interdépendance et de partage selon lequel les humains font partie de l’écosystème (les humains appartiennent à la nature, et non l’inverse).
En 1945, l’humanisme de séparation semblait triompher en droit international. De la philosophie des Lumières à la DUDH, la montée en puissance des droits « de l’homme» par un processus anthropocentré semblait devoir imposer comme valeur suprême l’égale dignité humaine et comme corollaire l’interdit absolu de la déshumanisation (crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide).
L’humanisme d’interdépendance apparaît cependant en droit international depuis Stockholm (1972) et surtout depuis le « sommet de la Terre » à Rio (1992). En affirmant que « la terre forme un tout marqué par les interdépendances », le droit international reconnaît les interdépendances entre les humains et les autres composantes de l’écosystème. Il en tire les conséquences en 2015 en termes d’objectifs communs, comme les 17 objectifs du développement durable (ODD, 25 sept 2015 ou les 3 objectifs de l’accord climat, (15 déc. 2015). S‘ajoutent divers projets (déclaration des droits de la Terre Mère, déclaration des droits de l’humanité, pacte sur l’environnement) dont le point commun est de reconnaître les interdépendances et d’en déduire des devoirs humains envers l’écosystème.
Dans le prolongement d’une sorte de fraternité universelle (art. 1 DUDH), élargie par la notion de « Terre Mère » aux autres vivants, la valeur ainsi esquissée serait le respect des biens communs planétaires, inappropriables et inaliénables (selon les économistes « non exclusifs » et « non rivaux ») et son corollaire l’interdiction de dénaturer l’écosystème planétaire et de porter ainsi atteinte à la sûreté de la planète (cf le crime d’écocide, encore en projet, en écho du génocide).
Faut-il vraiment choisir ? Le fait même que nous posions la question montre que, si l’humain fait bien partie de la nature, il ne se confond pas pour autant avec les autres vivants. Il faut sans doute accepter l’idée d’un droit inscrit dans un « humanisme d’interdépendance » (ou un « naturalisme critique »), qui interdirait à la fois la déshumanisation des êtres humains et la dénaturation de l’écosystème. Ainsi la cour interaméricaine des droits de l’homme admet une propriété collective née des interdépendances entre les populations autochtones et leur milieu de vie. [3]
Ce serait une façon d’éviter à la fois les excès sécuritaires et les abus des libertés ; les excès des guerres et des marchés et les abus d’un écologisme fusionnel ou d’un scientisme déshumanisant. Encore faut-il responsabiliser tous les acteurs de manière à orienter le droit vers cette double finalité.
Responsabiliser les acteurs de la mondialisation
A pouvoir global, responsabilité également globale. Si le principe peut sembler évident – l’exercice d’un pouvoir à l’échelle globale devrait obliger les titulaires à répondre des conséquences des effets qui résultent de cet exercice –, sa mise en œuvre l’est beaucoup moins. Les États, pendant longtemps seuls sujets du droit international, résistent au nom du dogme de la souveraineté nationale. Quant aux acteurs « non étatiques », dont la montée en puissance s’affirme d’autant qu’à la différence des États ils sont déjà organisés à l’échelle mondiale, le droit international ne leur reconnaît qu’exceptionnellement une place tandis que, précisément parce qu’ils sont organisés à l’échelle globale, ils échappent facilement au droit national.
S’agissant des États, la formule non kelsenienne inscrite dans l’accord de Paris – des responsabilités «communes mais différenciées » – amorce une évolution car elle vise à les responsabiliser en imposant des objectifs communs, tout en ménageant une mise en œuvre différenciée tenant compte du contexte national. Elle transforme la hiérarchie des normes en interaction entre le niveau planétaire et le niveau national. Le problème est que, même s’il est précis et partiellement obligatoire (ni flou, ni mou), l’accord reste doux (soft law) en l’absence d’une instance mondiale compétente pour contrôler la mise en oeuvre et sanctionner les violations.
Mais il peut se durcir car l’accord prévoit un « cadre de transparence », un comité d’experts pouvant, en publiant les violations constatées, déclencher la sanction symbolique de l’opinion publique. En outre les violations peuvent entraîner des sanctions prononcées par un juge national. Comme en témoigne le jugement d’un tribunal néerlandais contre l’État qui n’avait pas respecté ses engagements d’émission de GES. Après ce jugement Urgenda, d’autres procès ont été engagés. Enfin les cours régionales des droits de l’homme ont commencé à étendre leur compétence au droit de l’environnement et au changement climatique. C’est ainsi que, même différenciée, la responsabilité des États peut transformer leur souveraineté solitaire (indépendante) en souveraineté solidaire (interdépendante).
Il n’empêche que les États seront sans doute les derniers à accepter pleinement une gouvernance mondiale. Malgré l’engagement antérieur de l’UE en faveur de l’environnement, le repli protectionniste gagne des États européens, tandis que le nouveau président des États-Unis entend durcir sa résistance. Il est vrai que les déclarations du président chinois au sommet de Davos (2017) pourraient compenser ce retrait occidental si, par un basculement étonnant, la Chine rejoignait les entreprises transnationales (ETN).
L’organisation des ETN est déjà mondiale. Pourtant l’accord de Paris se limite à recommander de « rendre les flux financiers compatibles avec un développement à faible émission de gaz à effet de serre » (art. 2). La formule peut viser divers types d’incitations: taxe carbone, prix des émissions, obligations vertes, ou encore le « stress test » pour mesurer la capacité de résistance des institutions financières aux risques climatiques susceptibles de remettre en cause la stabilité financière. Il n’est cependant pas sûr que l’incitation suffise à l’efficacité.
Comme pour les États, il faudrait durcir le soft law (en particulier les engagements volontaires attachés à la notion de responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise, RSE) en appliquant des sanctions (hard law) quand ces engagements n’ont pas été respectés. Mais quel serait le juge compétent? Une solution serait de créer un tribunal international de l’environnement, compétent pour les États et les ETN, et déjà préfiguré par le tribunal d’opinion créé en 2014 pour protéger les droits de la nature (il s’est réuni en 2016 à propos de Monsanto).
D’autant que le projet de créer un crime d’écocide invite à élargir à certains crimes environnementaux la compétence de la CPI. Dès à présent le Bureau du procureur a d’ailleurs ouvert des examens préliminaires, par exemple contre l’accaparement de terres au Cambodge, et affirmé dans son « document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires » (15 sept 2016) qu’il s’intéresserait particulièrement aux crimes visés au statut de Rome « impliquant ou entraînant des ravages écologiques, l’exploitation illicite de ressources naturelles ou l’expropriation illicite de terrains ». Mais la CPI n’a qu’une compétence subsidiaire. Ici encore un juge national pourrait intervenir, comme certains ont d’ailleurs commencé à le faire, en déclarant recevables des actions contre des entreprises émettrices de carbone.
Face aux résistances des acteurs les plus puissants (États et ETN), les acteurs civiques pourraient jouer un rôle moteur. La pression des « citoyens du monde » a déjà largement contribué à l’élaboration puis à l’approbation et à la ratification de l’accord climat. Il resterait à renforcer leur déontologie et consolider leur statut juridique, par exemple en précisant les conditions d’accès aux juges et en renforçant leur participation à l’élaboration des conventions internationales.
Enfin il faut souligner le rôle des scientifiques notamment comme lanceurs d’alerte d’autant plus efficaces qu’ils sans doute les acteurs les mieux organisés à l’échelle globale. La crainte actuelle de voir « instrumentaliser la Science » pourrait conduire à l’adoption d’un statut mondial des chercheurs et des experts afin de garantir leur indépendance, mais aussi leur compétence et leur impartialité face aux incertitudes du monde.
En conclusion, pour s’adapter à l’anthropocène, la pensée juridique devra non seulement s’ouvrir à la déterritorialisation mais accueillir l’indétermination qui résulte des incertitudes dans un monde imprévisible, instable et apparemment inextricable. Un tel objectif implique une pensée moins dogmatique, ouverte et en mouvement.
On pourrait y voir une sorte de « bricolage » évoqué par Claude Lévi-Strauss pour désigner un processus d’adaptation qui utilise “les moyens du bord”, en essayant par tâtonnements de les ajuster à une réalité mouvante. Ce paradigme peut en effet s’appliquer au juriste, émetteur ou récepteur de normes, qui utilise des instruments de droit comparé et de droit international, voire de l’anthropologie, qui n’avaient pas été conçus pour penser un droit mondial. Mais il ne dit pas comment éviter que le bricolage conduise vers un droit instrumentalisé au service des pouvoirs (politiques, économiques, culturels et religieux, écologiques, technoscientifiques, …).
Pour sortir du pot au noir, et éviter à la fois la paralysie et le naufrage, il faudrait qu’à défaut de dogme, le « collectif humain » se donne un cap, une direction commune. « Humanisme d’interdépendance » ou « naturalisme critique », peu importe la dénomination si l’on admet que dans cette nouvelle phase de l’histoire le droit mondial devra se diriger « par delà nature et culture ».
Il ne suffira pas d’utiliser les « moyens du bord ». Il faudra aussi « tirer des bords », louvoyer entre deux finalités émergentes en droit international : l’égale dignité qui interdit la déshumanisation des humains et le bien commun qui interdit la dénaturation de l’écosystème, la destruction de la maison commune Terre, le « milieu de vie » où se rencontrent les interdépendances. Louvoyer comme si une oscillation sans fin était la seule réponse à la finitude du monde vivant.
Ce texte d’AOC est publié en prélude à La Nuit des idées, manifestation dédiée le 31/01/2019 au partage international des idées, initiée et coordonnée par l’INSTITUT FRANÇAIS. Toute la programmation en France et dans le monde sur lanuitdesidees.com