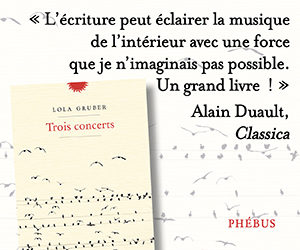Le grand tournant algérien
De l’empire romain à la « République populaire et démocratique » algérienne, c’est une axiome essentiel des sciences politiques : aucun régime ne peut durer sans un compromis négocié avec toute ou partie de sa population et l’élaboration d’un grand récit national.
Jusqu’ici, Alger vendait à son peuple ainsi qu’à ses alliés à l’étranger le mythe d’un État indépendant et stable au sein d’une région troublée, parvenu à triompher du terrorisme et à conserver sa permanence malgré les complots ourdis par ses voisins (marocains souvent, français parfois à la veille des visites officielles), capable enfin de contenter le gros de manifestants grâce à des subventions massives déversées sans compter, en particulier auprès de la jeunesse.
Ces derniers jours, c’est à la fois un compromis qui dure depuis vingt ans et sans cesse réajusté et ce grand récit qui se fissurent sous nos yeux. Un régime s’écroule-t-il ? Rien ne permet encore de la dire. Mais ce nouveau mandat – le cinquième, d’un homme incapable déjà de mener sa propre campagne en 2014 – promis à une société dont la lassitude fut déjà perceptible tout au long des cinq dernières années, est le signe d’une absence totale de renouvellement politique et d’une incapacité de ce régime à faire accoucher l’Algérie d’un système pluraliste, ouvert à la nouvelle génération qui vient, ce qui pourrait bien causer sa perte.
Si la première décennie du règne Bouteflika fut concentrée sur le souvenir de la décennie noire des années 1990 et la guerre civile algérienne, la seconde fut marquée par deux grandes tendances : le renforcement de la présidence aux dépens de l’armée et des services de renseignement militaires, dont le trop fameux DRS (Département du Renseignement et de la Sécurité) qui présidait aux destinées du pays depuis la fin de la guerre d’indépendance ; et la clientélisation d’une société qui a multiplié les manifestations, dans le sillage du printemps arabe.
Contrairement à ce que l’on entend ces derniers jours sur la plupart des ondes, l’Algérie n’est pas ce corps social inerte qui subirait, sans bouger, le régime d’un président malade depuis son AVC en 2013, et se réveillerait soudain fin février 2019, à deux mois de l’élection présidentielle. Tout ou partie du pays a manifesté ces dernières années dès le printemps arabe, et même avant lui, dès 2010. Mobilisations des enseignants contractuels, des médecins et personnels des hôpitaux – dont on se rappelle les défilés particulièrement fournis en plein centre d’Alger – des avocats, des journalistes, de toute une région (la Kabylie, le Sud…). D’Alger à Timimoun, les dix années qui viennent de s’écouler ont été secouées, chaque trimestre ou presque, par un mouvement social certes sectorisé, mais d’ampleur. En 2014, l’un des plus spectaculaire fut aussi le plus marquant par la détermination de ses partisans, et fit reculer un pouvoir algérien pourtant bien décidé à entamer l’exploitation du gaz du schiste dans le Sud du pays.
Chaque fois, le gouvernement algérien ajouta à la répression du mouvement son lot de renoncements et une série d’annonces aux portées financières considérables pour le pays. Sans doute Alger avait-il en tête la faillite de l’ancien dictateur tunisien, Zine el Abidine Ben Ali. En Tunisie, la fin du précédent régime survint autant du fait des manifestations d’une population sans horizon et soumise à un régime de fer que de la lassitude d’une classe économique face la prébende organisée par la famille Trabelsi, celle de l’épouse d’un président en bout de course.
En Algérie, la rente permit un temps de compenser la colère et la vacuité d’un pays incapable d’offrir une perspective à sa jeunesse, sacrifiant sans sourciller toute une génération née dans les années 1980. Dès l’essor du printemps arabe, un programme baptisé Ansej à destination des jeunes coûta chaque année au régime plusieurs dizaines de milliards d’euros. Il permit un temps aux Algériens qui le souhaitaient de récupérer jusqu’à 100.000 euros pour fonder une hypothétique entreprise, sans qu’aucune contrepartie sérieuse ne soit exigée. Beaucoup ont disparu avec l’argent sans demander leur reste. Un gaspillage mémorable, unique sans doute dans l’histoire des États modernes, que l’Algérie ne peut d’ailleurs plus se permettre. Autant d’argent qui manque aujourd’hui à l’économie algérienne pour se diversifier et sortir du tout-pétrole.
La permanence du régime algérien vient notamment de l’entretien d’une relation ambiguë à la répression, jamais absente ni jamais complète, maintenant dans l’équivoque toute une population.
La permanence du régime algérien est également venue d’une gestion particulière de la répression, qui rappelle somme toute cette ambition prêtée à Joseph Fouché, ministre sous le Directoire qui rêva pour le peuple français d’une « règle équivoque » favorisant la mise en place d’une police « dans toutes les têtes ».
Contrairement au voisin tunisien et à sa stratégie peu subtile du tout répressif choisi au cours de la première décennie 2000, le régime algérien a entretenu une relation ambiguë à la répression, jamais absente ni jamais complète, maintenant dans l’équivoque toute une population, traçant des lignes rouges imperceptibles mais bien réelles quand le couperet tombait sur un caricaturiste ou un patron de presse, entretenant une auto-censure largement répandu dans les médias, et dans la rue.
En 2014, il suffit de quelques camions de police pour étouffer une première manifestation à Alger et provoquer finalement la réélection de Bouteflika dans le calme. Un signe que le compromis du régime fonctionnait encore – selon les critères du pouvoir. La presse, francophone du moins, était encore relativement libre. Le billet au vitriol en der du quotidien El Watan continuait de paraître. Et le débat en vogue au sein des observateurs avisés de l’Algérie s’étendait sur la manière de qualifier ce régime, démocratie surement pas, mais dictature, vraiment ? Un régime hybride plutôt, autoritaire et corrompu certes, mais, il fallait bien le reconnaître, toujours soutenu tacitement par une partie de sa population.
La marginalisation politique des renseignements militaires au profit de la présidence sembla un temps démonter les ressources de cette dernière, et la capacité du clan Bouteflika à se tailler un chemin vers l’avenir. Au milieu du quatrième mandat pourtant, les premiers signes de la rupture du pacte commencèrent à se faire jour. L’essor médiatique d’hommes d’affaires d’envergure internationale, tel le milliardaire Issad Rebrab, dont les sorties médiatiques et critiques répétées firent la une des quotidiens internationaux, fut un indice supplémentaire suggérant un pouvoir chancelant, incapable d’imagination pour son économie comme pour sa société.
Coincée entre ce système de subvention de l’énergie et l’absence totale de progrès social et politique, le pacte implicite tissé sur le long terme avec la population algérienne est désormais intenable.
Les deux se rejoignent dans ce qu’il faut bien considérer comme la double impasse énergétique dans laquelle le régime s’est englué. Problème majeur du « modèle algérien », le coût global des subventions énergétiques lui donne des maux de tête. En Algérie, grâce aux subvention de l’État, le litre d’essence ou de gasoil est vendu en moyenne près de 3 fois moins cher qu’au Maroc et plus de 2 fois moins cher qu’en Tunisie.
L’écart est encore plus significatif pour le prix de l’électricité. En Algérie, le kw/heure est facturé de quatre à cinq fois moins cher qu’au Maroc. Et la consommation intérieure ne fait qu’augmenter, de 10 % en moyenne par an pour le carburant. A tel point que, malgré l’importance de réserves d’hydrocarbures qui fondent il est vrai à vue d’œil, l’Algérie est obligée d’en importer pour répondre à la demande intérieure croissante. Près de 3 milliards par an en moyenne depuis 2011 selon les données officielles. Un système ruineux qui conduit le pays à la banqueroute.
Coincée entre ce système de subvention de l’énergie et l’absence totale de progrès social et politique, le pacte implicite tissé sur le long terme avec la population algérienne est désormais intenable.
Le raidissement perceptible du régime envers les médias depuis deux ans, et notamment les médias en ligne dont il faisait jadis peu de cas, témoigne de la fin d’une stratégie que le pouvoir juge désormais caduque. Dimanche, les journalistes des médias publics ont dénoncé le silence imposé sur les manifestations de masse de vendredi. « FLN au musée, Bouteflika va te faire soigner » pouvait-on lire place de la République à Paris, en écho aux centaines de milliers des personnes qui manifestaient la semaine dernière de l’autre côté de la méditerranée.
Cette campagne présidentielle 2019 ne ressemble en rien a celle de 2014, du moins dans la rue. Lentement, sûrement, les lignes rouges sont franchies et le statut quo algérien vole en éclat. Dernier moudjahidin et dirigeant historique du FLN vivant, Bouteflika symbolise aujourd’hui une Algérie de l’indépendance qui n’a pas tenu ses promesses. Face aux derniers moudj, deux générations manifestent ensemble à travers tout le pays, concomitamment et non pas uniquement pour des revendications sectorielles. L’une, exclue de l’histoire, l’autre, pour ne pas subir le même sort. Un concordance des luttes inédite pour une campagne présidentielle.
Mardi, ce sont les étudiants algériens qui devait marquer leur opposition au cinquième mandat. Les jeunes regardent leur aînés sacrifiés et veulent avancer, vers une économie qui ne soit plus celle de la rente, vers un État qui ne soit plus seulement clientéliste, confisqué par une caste et tourné vers un passé dont les derniers témoins ont tous, et depuis longtemps, quitté l’avant-scène politique.
Tous ? oui, tous. Sauf un.