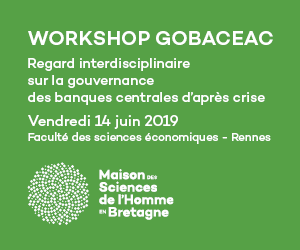Sous les intérêts individuels, les passions sociales
La France en colère – site d’information sur le mouvement des « gilets jaunes » – dénonce le mépris de classe des élites. Le ressentiment des manifestants s’est transformé parfois en actes de haine qui ont suscité l’indignation. À lire l’actualité on dirait que l’espace public est envahi par la résurgence des passions dans les conflits sociaux. Mouvements populistes, craintes millénaristes, indignation devant l’injustice, ressentiment social, colère, humiliation, solidarité et empathie vis-à-vis des plus vulnérables, font la une de l’information et semblent expliquer pourquoi les gens agissent, votent, se révoltent, bouleversent les normes sociales et s’entretuent. Pourtant, une thèse bien répandue dans les sciences sociales voit dans l’intérêt le moteur de l’action des individus.
Notion introduite entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe, l’intérêt permettrait de surmonter la dichotomie classique entre passion et raison, en rendant possible de maîtriser d’une façon raisonnable des passions comme l’amour de soi. Concept hybride, l’intérêt ne pâtit ni du pouvoir destructeur de la passion, ni de l’impuissance de la raison. L’homo oeconomicus, motivé par l’intérêt réussirait en somme à tirer le mieux de deux mondes : on reconnaît en lui à la fois la passion de l’amour de soi ennoblie par la raison.
La résurgence des passions dans les conflits contemporains ainsi que le rôle des valeurs symboliques dans le débat public et dans les mobilisations sociales, questionnent cette thèse. Comment comprendre aujourd’hui les motivations de l’action sociale sans référence au débordement des passions, bien au-delà de l’intérêt individuel rationalisé dans l’action collective ?
Les passions semblent donc faire un retour en force dans les sciences sociales. Pourtant, leur omniprésence dans l’actualité ne va pas de pair avec le développement d’une théorie sociale qui rende pleinement compte de leur rôle. Si l’étude des sensibilités humaines s’est affinée au cours des dernières décennies dans plusieurs disciplines, en engendrant des théories, des cadres explicatifs, des études empiriques, des nouvelles conceptualisations pertinentes, on est loin de disposer d’un nouveau modèle explicatif et unifié de l’action humaine qui puisse prendre enfin la place de l’exsangue homo oeconomicus guidé par la raison et l’intérêt.
Dès la crise économique de 2008, le XXIe siècle a vu des « foules sentimentales » indignées revendiquer le respect, la solidarité, l’égalité, l’altruisme…On pourrait dire que le XXIe siècle s’annonce chaud non seulement pour des raisons climatiques mais aussi pour des raisons sociales.
Si les passions sont un sujet classique en philosophie, à partir d’Aristote qui, dans le troisième livre de la Rhétorique, dresse un catalogue des passions humaines et de l’importance d’en tenir compte dans le discours politique, le terme peut sembler désuet à notre époque. Bien que la sémantique des termes « passion » et « émotion » évolue et varie au moins à partir du XVIe siècle sous l’influence en particulier de la pensée médicale, c’est le mot « émotion » qui est retenu par la psychologie scientifique pour étudier les sentiments humains dans les travaux d’un Charles Darwin ou d’un William James.
La passion serait en quelque sorte une émotion métamorphosée en un état chronique, informée par l’imagination et la pensée.
Kant cependant faisait dans l’Anthropologie une distinction aujourd’hui encore pertinente : « Dans l’émotion, l’esprit surpris par l’impression perd l’empire de soi-même. Elle se déroule dans la précipitation : c’est-à-dire qu’elle croît rapidement jusqu’au degré de sentiment qui rend la réflexion impossible […] Ce que l’émotion de la colère ne fait pas dans sa précipitation, elle ne le fera jamais ; elle a la mémoire courte. La passion de la haine au contraire prend son temps pour s’enraciner profondément et penser à l’adversaire ».
Cette distinction philosophique n’est pourtant guère reprise en psychologie avant l’Essai sur les passions de Théodule Ribot publié en 1907. Ribot accepte la distinction kantienne sous l’aspect de la temporalité, mais rejette le caractère pathologique de toute passion, en préférant une caractérisation intellectuelle. La passion, selon lui, est : « une émotion prolongée et intellectualisée, ayant subi, de ce double fait, une métamorphose nécessaire ». La passion serait en quelque sorte une émotion métamorphosée en un état chronique, informée par l’imagination et la pensée : « La passion est en partie naturelle, en partie artificielle, étant l’œuvre de la pensée, de la réflexion appliquée à nos instincts et à nos tendances ».
L’aspect « chronique », enraciné, situé des passions, leur rapport subtil avec l’imaginaire et l’opinion, leur façon de nous donner un accès privilégié à l’évaluation morale, en font un type d’objet plus apte à éclairer le rôle de l’affectif dans la sphère sociale que les émotions, plus individuelles et éphémères. Le terme se situe ainsi dans une tradition qui voit dans l’affectif une forme d’expression humaine par excellence et un ressort de l’histoire des peuples et de leur politique, et qui ne les réduit pas à un objet d’enquête purement psychologique.
Les passions, ce terrain organique mystérieux d’où sortent les grandes entreprises humaines, sont des objets à la fois historiques, culturels et « naturels ». Elles sont ancrées, certes, dans notre système nerveux mais elles n’en sont pas moins situées dans le tissu social et historique avec une temporalité qui leur est propre et qui est responsable de l’imprévisibilité de leur resurgir parfois impromptu sur la scène politique, après des périodes de latence.
Les passions nous servent aussi à évaluer notre statut social. Dans une période où les inégalités se sont accrues de façon impressionnante, il est donc logique que les passions ressurgissent. La colère sociale est typiquement déclenchée par la fragilisation du statut, tant l’humiliation – le fait de se sentir rabaissé – que le mépris – se considérer comme supérieur. Les passions peuvent donc être considérées comme des détecteurs d’inégalités. Dans une société où les inégalités augmentent, les passions augmentent aussi. C’est une espèce de trahison de la démocratie : on se croit tous égaux, on voit bien qu’on ne l’est pas et cela crée du ressentiment.
Les passions affectent le plus souvent notre image sociale, la considération que, pensons-nous, les autres nous doivent, plutôt que notre personne physique.
On peut parler des passions sociales lorsque l’étendue de la pulsion passionnelle dépasse les individus, envahit l’espace public et influence le politique. Dans cette perspective, une passion est sociale si son expression est l’objet de normes sociales plus ou moins acceptées dans un contexte historique et culturel. En ce sens, l’expression des passions contribue à chaque instance à réitérer ces normes ou à les rendre obsolètes. Prenons l’indignation, cette forme de « colère généreuse » vis-à-vis des offenses qui affectent indirectement le sujet en heurtant les valeurs qu’il tient pour fondamentales – une des passions sociales qui a joué un rôle politique puissant après la crise financière de 2008. Chaque expression d’indignation vis-à-vis de ces injustices renforce les normes sociales qui règlent les comportements collectifs de révolte morale des citoyens.
Ou prenons l’honneur, une passion considérée comme fondatrice de notre culture, dont l’expression est aujourd’hui réglée par des normes sociales bien différentes de celles de l’âge classique. Comme le montre bien le philosophe Anthony Appiah dans son livre Le code d’honneur (Gallimard, 2012), la référence à l’honneur a d’abord fondé puis remis en cause certaines normes sociales telle que le duel qui n’est plus désormais honorable. La lecture des passions et de leur rapport aux normes sociales à la lumière de l’histoire nous permet d’en saisir la portée transformative ainsi que le rôle crucial de « marqueurs affectifs » d’une époque.
Les passions affectent le plus souvent notre image sociale, la considération que, pensons-nous, les autres nous doivent, plutôt que notre personne physique. Une humiliation peut être ressentie comme insupportable lorsqu’elle nous rabaisse aux yeux des autres : une gifle reçue en public est tout d’abord une blessure à notre amour propre, qui suscite une demande de réparation immédiate. Les passions agissent alors en tant que « sociomètre » affectif, en nous équipant d’un système de monitorage des positions sociales que nous occupons les uns par rapport aux autres dans chaque interaction. Elles peuvent être conformistes et reproduire l’ordre social établi, comme dans le cas du mépris de classe, ou révolutionnaires, en nous donnant la force morale de réagir à une relation statutaire que nous ne pouvons plus accepter. En ce sens les passions nous donnent accès à une autre dimension de nos interactions sociales, qui dépasse l’échange des biens et touche à la structure statutaire de notre vie sociale.
Bien qu’on puisse analyser les émotions dans la modernité comme marchandises d’échange, comme le fait la sociologue Eva Illouz dans son ouvrage Les marchandises émotionnelles, une enquête sur le « capitalisme émotionnel » qui promeut l’usage consumériste des émotions dans des marchés comme le tourisme, l’échange sexuel, les techniques de psychologie positive ou les films d’horreur, les émotions ont aussi le pouvoir de nous faire percevoir, au-delà des relations d’échange, d’autres relations sociales, comme les relations de statut qui structurent des rapports de pouvoir parfois cachés dans la rhétorique de la démocratie.
Dans les traités classiques des passions, d’un Descartes ou d’un Spinoza, les passions sont articulées l’une par rapport à l’autre, dans une « géométrie » des sentiments. Une théorie des passions contemporaine devrait utiliser les savoirs en sciences sociales pour comprendre la logique des passions, c’est-à-dire, comment une passion peut en déclencher une autre. Prenons le cas de la confiance, cet abandon non raisonné qui nous rend vulnérables à l’agir des autres. Si nous « jouons notre peau » dans une relation de confiance, pour utiliser l’expression de Nassim Taleb (Jouer sa peau, Le Belles Lettres, 2017) nous nous attendons que l’autre aussi se mette en jeu. Lorsqu’il y a une excessive asymétrie des risques, et l’autre ne risque rien à trahir notre confiance, cela crée du ressentiment et de l’indignation. L’indignation éprouvée suite à la crise financière de 2008, à la base des mouvements comme Occupy Wall Street, était provoquée par un sentiment de trahison de la confiance dans un contexte d’asymétrie des risques.
Un monde où les passions sont exprimées et revendiquées n’est pas un monde irrationnel : c’est un monde en transition normative, un monde en mouvement où les couches souterraines de l’agir social font trembler le statu quo et nous indiquent, même si d’une façon incertaine, un nouvel horizon des valeurs.