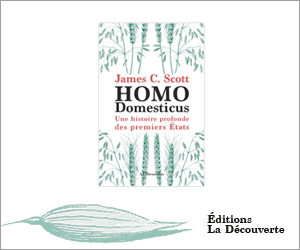Exxon et « nous » – sur Perdre la Terre de Nathaniel Rich
En février 1962, le géant pétrolier américain Humble Oil (désormais connu sous le nom d’Exxon) a publié dans l’hebdomadaire Life une publicité qui aujourd’hui paraît presque sadique. « Chaque jour Humble produit assez d’énergie pour faire fondre 7 millions de tonnes de glacier », se vantait la multinationale, en légende d’une photo du majestueux glacier Taku, en Alaska.
Il est peu probable que les dirigeants d’Exxon de l’époque (et encore moins ceux de son agence de publicité) savaient à quel point ce slogan cruel correspondait à la vérité. Mais quinze ans plus tard, en 1977, nul doute qu’ils le savaient. Bien avant tout le monde à part une poignée d’experts, les scientifiques d‘Exxon avaient compris la manière dont les émissions de gaz à effet de serre produites par la combustion des énergies fossiles contribuaient à un réchauffement climatique « potentiellement catastrophique » et « peut-être irréversible ». Leurs propres rapports le montraient et la direction était bien au courant.
Pourtant, ils n’étaient pas pressés d’avertir le public. Au contraire, le scientifique Henry Shaw conseillait aux dirigeants d’Exxon en 1979 qu’ils lancent « un programme défensif très agressif » afin de protéger leurs bénéfices de toute législation qui viserait à limiter les émissions de carbone. C’est ce que nous ont révélé les journalistes de InsideClimate News il y a maintenant presque quatre ans, en 2015.
Ce dossier choc a suscité une forte réaction non seulement de la part des militants écologistes, mais également de la justice américaine : en 2015 et 2016, les procureurs généraux des États du Massachusetts et de New York ont ouvert des enquêtes pour fraude contre Exxon, plus gros producteur d’énergies fossiles coté en Bourse. Les enquêtes sont toujours en cours et une nouvelle pourrait bientôt être ouverte à Washington, D.C. Cette série de procédures judiciaires s’appuie sur un message simple et clair : « Exxon savait ». Et maintenant, Exxon doit payer.
C’est dans ce contexte qu’est paru en août dernier un article d’un format inédit dans le magazine hebdomadaire du New York Times. L’article en question, signé par l’écrivain Nathaniel Rich, occupait à lui seul la totalité de la publication dont la couverture était presque entièrement noire, exceptée cette phrase écrite en blanc, au milieu de la page : « Il y a trente ans, nous aurions pu sauver la planète. » La mise en page soulignait bien le drame dont il s’agissait, de même que les images qui illustraient le magazine : la banquise en train de fondre, la Californie en feu, la Mauritanie en pleine sécheresse, le troisième plus grand lac de Chine empoisonné par les algues, le Texas et le Bengladesh en proie à des inondations.
Le livre de Rich s’inscrit ainsi dans une polémique qui divise depuis longtemps le mouvement écologiste et qui entoure la question de la responsabilité.
Révisé et traduit en français par David Fauquemberg, le récit de Rich paraît aujourd’hui sous forme de livre (Perdre la Terre, au Seuil) avec une présentation qui, elle non plus, ne laisse planer aucun doute quant à la nature tragique du sujet abordé.
« Il y a trente ans, nous aurions pu sauver la Terre. Et pourtant nous n’avons rien fait », annonce la jaquette. « C’est une histoire funeste, celle de comment l’humanité a échoué à se sauver », résume Le Monde à son tour.
Les enjeux sont clairs et pourtant, dès la première page, le récit de Rich laisse transparaître une ambiguïté importante. Qui est ce « nous » qui aurait pu sauver la planète et qui n’a pourtant « rien fait » ? Est-ce vraiment « l’humanité » qui a « échoué à se sauver » ? Le recours au pronom « nous », si vaste, ne risque-t-il pas d’excuser précisément ceux qui étaient les plus coupables ?
Que ce soit son intention ou non, le livre de Rich s’inscrit ainsi dans une polémique qui divise depuis longtemps le mouvement écologiste et qui entoure la question de la responsabilité. Qui nous a réellement entraînés dans le désastre actuel, qui menace la survie même de la civilisation humaine ? Et qui devrait donc payer pour essayer de nous sortir de cette impasse ? Est-ce principalement à « nous », en tant que citoyens et consommateurs, surtout dans les pays riches, de changer nos modes de vie si dépendantes des énergies fossiles ? Ou est-ce principalement aux gouvernements et aux producteurs de ces énergies fossiles, à ceux qui ont le plus de pouvoir et qui en tirent le plus de bénéfices, de mener et de financer la transformation profonde de nos sociétés exigée par la crise actuelle ?
Les réponses qu’apporte Nathaniel Rich à ces questions sont, malheureusement, décevantes. Ce n’est pas par manque d’effort journalistique : sa rétrospective sur la manière dont les élites américaines se sont emparées de la question du changement climatique pendant la décennie 1979-89 est ambitieuse et documente un chapitre important de l’histoire de la crise à laquelle nous faisons face aujourd’hui. Son récit porte un élan et un lyrisme que l’on ne trouve que rarement dans les articles sur le réchauffement climatique. Mais c’est justement quand l’auteur bascule vers le littéraire, quand il se laisse emporter par ses propres talents de conteur, que Perdre la terre perd en fiabilité. Rich voudrait faire du changement climatique une tragédie grecque, une allégorie de la nature humaine, alors que « nous » sommes bien moins coupables dans l’histoire qu’il nous raconte que la poignée d’oligarques qui se sont battus pour maintenir en place les conditions de leur enrichissement, aux dépens de la grande majorité de l’humanité.
Le récit de Rich commence à la même époque que celui de InsideClimate News, c’est-à-dire en 1979, alors qu’Exxon commence à préparer sa « campagne défensive ». En effet, les scientifiques de la firme n’étaient pas les seuls à avoir pris conscience du changement climatique à l’époque (même si leurs confrères n’étaient pas encore très nombreux).
Pomerance et MacDonald, duo improbable, entreprennent alors ensemble donc de convaincre le gouvernement du président Carter de l’urgence d’agir. En quelques mois, ils obtiennent un rendez-vous avec le conseiller scientifique du président et lui démontrent la nécessité d’abandonner l’exploitation du charbon (p. 41). Un climatologue de la NASA, James Hansen, se joint bientôt à eux dans leur démarche. Les choses semblaient en bonne voie… jusqu’à l’élection en novembre 1980 de Ronald Reagan à la Maison Blanche, dont le président de l’Association nationale du charbon (NCA) « se disaient lui-même ‘fou de joie’ » (p. 95).
Reagan fait en effet de son mieux pour renverser la politique environnementale de son prédécesseur, mais l’inertie de l’administration américaine l’empêche d’y réussir tout à fait. Sous l’égide de diverses agences du gouvernement, certains climatologues comme Hansen poursuivent leurs recherches, ce qui fait que le sujet du changement climatique ne disparaît pas tout à fait des journaux. Cependant, une nouvelle prise de position face au problème se développe, presque aussi dangereuse que l’ignorance ou le déni total, celle que le Washington Post décrira à l’époque comme « [de] retentissants appels à l’inaction » de la part de ceux qui ont parfaitement conscience des faits.
Cette nouvelle tendance surgit notamment en 1983 avec la parution du plus important rapport sur le climat jamais publié à ce jour. « Changing climate » est le résultat de quatre années de travail d’une commission créée par Carter et composée de neuf scientifiques et économistes renommés. Ses conclusions sont surprenantes, voire désolantes pour ceux qui, comme Pomerance, suivent le sujet de près : « Des scientifiques s’opposent aux conclusions hâtives sur la tendance au réchauffement de la planète », selon le New York Times.
Seulement, ce n’est pas tout à fait le cas, car ce ne sont pas les scientifiques qui nient l’urgence d’agir. Comme le racontent également Erik M. Conway et Naomi Oreskes dans leur livre Les Marchands de doute (2010), ce sont les économistes qui s’emparent de la version finale de « Changing climate », plus précisément de son introduction et surtout du communiqué de presse à l’origine des gros titres dans les journaux. William Nordhaus notamment, futur lauréat du prix Nobel d’économie, déclara la commission « incapable » de juger si les « effets impondérables pour la société [du changement climatique] se révèleront au final plus coûteux qu’une réduction rigoureuse des gaz à effet de serre ». Ceci alors que les conclusions des scientifiques, bien enfouies à l’intérieur du rapport, sont quasiment identiques à celles de MacDonald quelques années auparavant, quand il prédisait « des famines, des sécheresses, l’effondrement économique ».
Ce ne sont pas les sciences qui tiennent la plume dans l’introduction de « Changing climate », c’est l’idéologie. Et une idéologie en pleine efflorescence dans les années 80 : celle du néolibéralisme, qui cherche à éliminer toute contrainte étatique à la toute-puissance du marché et dont le triomphe au fil de la décennie explique finalement beaucoup mieux que Perdre la terre pourquoi le combat contre le changement climatique a été perdu à cette époque. Comme l’ont déjà souligné plusieurs critiques de Rich, comme l’autrice et activiste Naomi Klein et la politiste Alyssa Battistoni, l’ascension du « fanatisme du libre-échange » créaient à l’époque les conditions opposées à celles qu’il aurait fallu pour vraiment s’attaquer au problème.
Rich souligne lui aussi l’obstacle représenté par l’économie, « cette science qui consistait à attribuer une valeur aux comportements humains, [et qui] prêtait au futur une forte décote ». Pourtant, 200 pages plus loin, cette tendance à « minimiser » la valeur du futur (théorie fortement contestée dans sa propre discipline) atteint dans le récit le statut d’une vérité de la vie humaine. « [L]es êtres humains, écrit Rich, sont incapables de sacrifier leur confort présent pour éviter d’imposer une punition aux générations futures. » Il rajoute même : « Nous pouvons faire confiance à la technologie et à l’économie. Le comportement humain, c’est plus difficile » (p. 272).
Dans un autre contexte, une telle généralisation serait consternante, mais superposée à un récit qui pointe précisément du doigt une toute petite poignée d’élites américaines (nul besoin de préciser qu’il s’agit ici uniquement d’hommes blancs), elle devient criante.
Alors que les militants écologistes et la justice américaine disent que « Exxon savait », Rich réplique que « Tout le monde savait ».
Perdre la terre n’est pas l’histoire de la façon dont « nous » avons raté le défi climatique. C’est plutôt une autre version de celle qu’ont écrit Conway et Oreskes il y a presque dix ans, sur la manière dont « [d]e petits groupes d’individus peuvent exercer des influences négatives de grande ampleur, surtout s’ils sont organisés, déterminés et ont accès au pouvoir ».
C’est ce qu’illustrent justement les chapitres majeurs de Perdre la terre, dans lesquels Rich raconte les négociations entre une soixantaine de pays à Noordwijk, Pays-Bas, en novembre 1989. Alors que les parties sont sur le point de conclure un accord international juridiquement contraignant visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % en quinze ans, le directeur de cabinet de George Bush, John H. Sununu, enterre les négociations. Les représentants des pays européens et d’autant plus ceux des pays pauvres du Sud, qui se battent pourtant vigoureusement pour aboutir à un accord contraignant, ne peuvent rien contre cette superpuissance mondiale. Visiblement, eux ne font pas partie du « nous » qui a refusé de sauver la planète.
C’est dans cette fausse universalité qu’il instaure que le récit de Rich est le plus trompeur, voire irresponsable. Son propos va jusqu’à exonérer les compagnies productrices d’énergies fossiles qui commencent enfin à être confrontées à la responsabilité criminelle qu’elles portent pour avoir mis notre civilisation en péril. Alors que les militants écologistes et la justice américaine disent que « Exxon savait », Rich réplique que « Tout le monde savait », une phrase qu’il répète même à deux reprises. Selon le chercheur de Stanford Ben Franta, cette phrase pourrait servir aux compagnies pétrolières non seulement de manière rhétorique, mais aussi juridique : les compagnies de tabac ont employé la même défense face aux tribunaux dans les années 90.
Face au changement climatique, il n’y a jamais eu de « page blanche », de « conte de fées » comme le voudrait Rich, sur laquelle les Démocrates et les Républicains, les militants écolos et les dirigeants des compagnies pétrolières étaient quasiment d’accord pour relever un défi, lui, bel et bien universel. Par contre, sommes-nous en train de vivre une tragédie irréparable et fruit de la nature humaine ? Non, ce que nous vivons est la continuation d’une longue lutte économique et politique, une longue bataille sur la façon d’organiser collectivement nos sociétés, d’accepter ou non le partage du pouvoir et des ressources. Tant que les géants de l’industrie fossile et leurs alliés élus détiennent une part démesurée de ce pouvoir et de ces ressources, ils détiendront une responsabilité toute aussi importante. C’est à nous tous d’assurer qu’ils en payent les conséquences.
Nathaniel Rich, Perdre la Terre, traduit de l’américain par David Fauquemberg, éditions du sous-sol/Seuil, 288 pages.