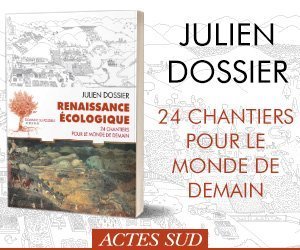Iran : de la crise de la famille à la crise politique ?
Je me souviens avoir revu, au milieu des années 1980, dans les jours les plus sombres de la guerre contre l’Irak, un grand poète d’avant la révolution, d’inspiration mystique, libertaire et même assez libertin, célèbre pour sa dénonciation littéraire de la répression, que ce fût celle du shah ou celle de la République, intime de l’un des principaux dirigeants de celle-ci. Il se félicitait de la sécurité qu’apportait le nouveau régime en instituant son ordre moral et son contrôle, aussi bien des femmes que de la jeunesse. Déclaration de prime abord surprenante dans sa bouche, puisqu’il n’avait pas été le dernier à fréquenter les cabarets, voire bien pis. Mais, au fond, le paradoxe n’est-il pas qu’apparent ? Car ce genre de propos me semble révélateur des contradictions de la société iranienne en matière de mœurs et de genre.
Depuis plusieurs années autorités politiques, religieuses et intellectuelles de la République islamique d’Iran font part de leur inquiétude quant à la crise de la famille dans le pays. Ces assertions recoupent un sentiment diffus assez général dans la société iranienne. Néanmoins, à y regarder et à y écouter de plus près, force est de reconnaître que l’on parle moins de la famille que de maux sociaux spécifiques, tels que le divorce, la drogue, le concubinage, la délinquance juvénile, la dissolution des mœurs. La notion de famille (khanevadeh) est très peu utilisée au quotidien, au contraire de celle de société (edjtema), même s’il est clair que l’une est la condition de l’autre. Il n’empêche que ce que les sciences sociales ont coutume de nommer famille est aujourd’hui au cœur du débat public en Iran, et peut fournir en soi une focale utile pour reconsidérer l’histoire contemporaine du pays, singulièrement celle de la République qui est née de la révolution de 1979.
La place des femmes fut au centre du débat public, que cristallisa l’enjeu du voile, plus que celle du droit de vote, dès lors que l’ayatollah en accepta le principe en 1979.
Les questions dites familiales ont été l’une des thématiques de la mobilisation politique, et de la révolution elle-même, au même titre que l’indépendance nationale ou la justice sociale. Tout au long du xxe siècle, elles ont alimenté les problématiques de la modernisation, à commencer par le réformisme autoritaire des Pahlavi, et le positionnement du clergé par rapport à celles-ci. Pour faire simple, les Pahlavi, en la matière, n’ont pas toujours été aussi « modernes » qu’on le suppose, ni les religieux aussi réactionnaires qu’on l’affirme. Il suffit de lire Fatemeh est Fatemeh d’Ali Shariati, ou Le Système légal de la famille de Morteza Motahhari, deux grands penseurs musulmans des années 1960-1970 — qui, d’ailleurs, n’étaient pas toujours d’accord entre eux quant à leur conception et au rôle du clergé — pour s’assurer que l’islam sait composer avec les transformations de l’ordre familial, sans pour autant rompre avec un solide conservatisme social ou politique.
L’événement révolutionnaire s’est en partie déroulé dans l’enceinte familiale, la clandestinité ou le militantisme étant une forme d’émancipation par rapport à celle-ci, contre laquelle le ralliement à la figure sévère et tutélaire de l’ayatollah Khomeyni sembla prémunir. La place des femmes fut au centre du débat public, que cristallisa l’enjeu du voile, plus que celle du droit de vote, dès lors que l’ayatollah en accepta le principe dès février 1979. Et la répression des forces dites contre-révolutionnaires, à savoir celle des Moudjahidines du peuple, prétendit mettre à contribution les parents pour dénoncer les enfants suspects — injonction qui ne survécut pas à la première émission télévisée de délation, où l’on vit une vieille mère trahir son fils. Certaines autorités religieuses saisirent cette occasion longtemps attendue pour marquer leur distance à l’encontre d’une Terreur qui faisait fi de l’autonomie de la sphère privée, et pour recommander aux croyants de faire passer les liens familiaux avant les allégeances politiques. La cause sacrée de la défense de la famille fournit un prétexte en or à celle de la propriété privée, à laquelle s’en prenait l’aile socialisante des révolutionnaires. L’annulation de la réforme agraire de 1963 fut la symétrie de l’abrogation de la loi dite de la Protection de la famille de 1975. L’une et l’autre signalèrent l’ascendant de la droite révolutionnaire sur la gauche, y compris la gauche islamique.
Néanmoins, ce fut la guerre imposée par l’Irak, en septembre 1980, qui scella l’union indéfectible entre la République islamique et la famille. L’attribution des tickets de rationnement sur une base familiale en fonction du nombre des enfants — au point que la mortalité des petites filles régressa pour la première fois, comme si leur vie était devenue aussi précieuse que celle de leurs frères puisqu’elles bénéficiaient des mêmes subventions —, l’engagement des femmes dans le soutien des combattants sur le front, le culte des martyrs tombés au champ d’honneur, qui étaient source de distinction sociale en même temps que de douleur, furent autant de facteurs qui contribuèrent à renforcer les liens familiaux. Le nouvel État-Providence y pourvut de son côté. Ses aides aux déshérités (mostas’af) ou, aujourd’hui, aux couches vulnérables (aghshâr-e asibpazir), visent à reconstituer ou à préserver leur cellule et leur dignité familiale, par exemple en subventionnant la dot ou la cérémonie de mariage, voire des agences matrimoniales permettant aux veuves de martyrs de convoler, ou encore de veiller sur les orphelins en leur fournissant un foyer. Elles ne s’adressent pas aux individus pris en tant que tels, quand bien même ils en auraient besoin, par exemple pour poursuivre leurs études ou trouver du travail. Leur orientation est résolument familialiste.
La face cachée de l’État n’est pas moins favorable à la famille. La crise économique rampante dans laquelle s’est installé le pays depuis la révolution a intensifié la solidarité entre ses membres. L’économie informelle, et notamment la contrebande, reposent largement sur les coopérations que nouent ceux-ci. C’est que la confiance est de rigueur, et qui peut mieux l’engendrer que la parenté, tout au moins jusqu’à preuve du contraire ? Les trafiquants professionnels ne manquent pas eux-mêmes de s’appuyer sur les liens familiaux pour organiser des voyages de groupe à Dubaï pour profiter des franchises douanières accordées aux populations frontalières. Sur ce plan comme sur d’autres, l’économie informelle partage les logiques de l’économie formelle. Ainsi, le développement industriel du pays, notable depuis la libéralisation économique des années 1990, repose pour l’essentiel sur un tissu de très petites entreprises familiales, de moins d’une dizaine de salariés, souvent faute de capital propre, mais aussi pour conjurer le risque de confiscation en vertu de la législation relative à l’enrichissement illicite — risque toujours présent du fait des nationalisations révolutionnaires et des expropriations au bénéfice du secteur parapublic —, pour diluer les responsabilités en cas de difficultés ou de faillite, et pour maximiser l’avantage comparatif de la confiance qu’est censée procurer la parenté. De même, l’enjeu foncier, qui paramètre sourdement les compétitions électorales à l’échelle locale et les réseaux financiers, est d’abord une affaire de famille, de parenté, de lignage, ce qui n’exclut pas de venimeuses animosités entre héritiers.
L’institution familiale s’est solidifiée « par le bas », et par le social lui-même, et non simplement sous l’effet de politiques publiques d’orientation familialiste et conservatrice. En fait, elle a été au centre des interactions ambiguës entre le régime et la société. La sphère des pratiques religieuses s’appuie sur les rapports de parenté. Les réunions dévotes, telles que les jaleseh pour les femmes, se tiennent à domicile et supposent la mobilisation des bonnes volontés familiales pour traiter les hôtes. Les formules de bénédiction (salavat) portent sur la famille, une fois que les saints ont été honorés, alors que la mention des autorités politiques est plus aléatoire. En dehors des préoccupations religieuses stricto sensu, les jaleseh sont un haut lieu de la mise en scène de la distinction familiale en tant qu’élément de la distinction sociale, et aussi de l’échange matrimonial. De même, l’évergétisme se met au service de l’ordre familial. Les bonnes actions (nikoukari, kheyrieh) dans les quartiers, telles que la distribution de mets ou le financement de la dot des jeunes filles, bénéficient mécaniquement aux parents plutôt qu’aux inconnus ou aux passants. Quant à l’adoubement des adhérents des caisses de prêts sans intérêts, il s’effectue sur la base de la réputation familiale et l’ouverture de livrets aux différents membres de la maisonnée, ne serait-ce que pour maximiser les chances de gagner au tirage au sort des nombreuses tombolas qui rythment la vie de ces institutions, elles-mêmes largement gérées sur une assise familiale notabiliaire.
L’orientation familialiste de la République islamique est en forte affinité avec les aspirations de la société iranienne, au sein de laquelle le mariage demeure la grande affaire, les jeunes urbains branchés n’étant pas les derniers des conformistes. La production culturelle, tant cinématographique que littéraire, véhicule cet attachement à l’ordre de la famille, qui en demeure le grand narratif. Et l’engouement du public iranien pour la célèbre série télévisée japonaise Oshin, dans les années 1980, devait beaucoup au fait qu’elle relatait le parcours familial d’une jeune femme, de surcroît dans un contexte de guerre qu’éprouvait à l’époque l’Iran. Si l’on accepte l’idée selon laquelle le chiisme fournit au pays son principal repère culturel, bien au-delà de la religion stricto sensu et de la population de confession chiite, force est de reconnaître que son imaginaire et son grand récit sont d’ordre familial : la destinée tragique d’Ali et sa descendance est celle d’une maisonnée, d’un lignage. Les logiques complexes et douloureuses de la parenté sont inhérentes au lien social qu’institue l’appartenance au chiisme, sinon à sa foi, du moins à sa sensibilité.
Les enfants dont le mode de vie s’occidentalise deviennent les petits rois et reines de la société au fur et à mesure que leur nombre se raréfie.
Pour autant, ce serait un contresens que d’identifier la République islamique à une forme de traditionalisme. En ce qu’elle a de familialiste, elle a promu un modèle nouveau de famille, de type nucléaire, par opposition ou distinction avec la famille élargie qui tendait à prévaloir. La chute spectaculaire de la fécondité — la plus rapide au monde — en a été le signe. Bien sûr, c’est moins le régime lui-même que la transformation générale de la société iranienne, du fait de son urbanisation et du développement de son instruction, qui est à l’origine de ce basculement. Mais les autorités politiques se sont associées à une telle évolution, qu’ils ont à bien des égards facilitée. En premier lieu, en développant l’éducation des filles et celle des populations rurales ou des habitants des quartiers les plus défavorisés, ou encore des provinces frontalières, condition sine qua non de la transition démographique, et en désenclavant les campagnes et les régions périphériques à grand renfort de nouvelles routes et de lignes électriques, sous la houlette d’une fondation paraétatique, la Croisade de la Reconstruction. En second lieu, en réservant les prestations sociales du nouveau welfare state et de ses institutions de bienfaisance aux familles nucléaires et en ne reconnaissant pas la polygamie, bien que celle-ci soit légitime aux yeux du Coran.
Sous l’effet de ces transformations sociales et de ces politiques publiques, dont la mise en œuvre est largement déléguée à des fondations de droit privé, la famille va de pair avec l’individuation croissante de ses membres. Cela est vrai des enfants dont le mode de vie — chambres séparées, leçons particulières complétant l’enseignement de l’école, multiplication des loisirs, généralisation de la pratique sportive, consumérisme — s’occidentalise ou se globalise de plus en plus, et qui deviennent les petits rois et reines de la société au fur et à mesure que leur nombre se raréfie. Mais, contrairement à l’idée reçue, cela l’est aussi des femmes qui se sont affirmées dans l’espace public sous le voile, y compris en investissant la scène économique pour compléter les revenus familiaux que la crise mettait sous pression, quitte à transformer l’habitation familiale en unité de production. Or, ces nouvelles modalités de la participation sociale des femmes enclenchent toute une série de changements dans les rapports familiaux, par exemple en ouvrant l’intimité du foyer à la visite des clients, ou en amenant l’époux à préparer le repas et à faire le ménage pour permettre à sa moitié de finir sa commande. L’une des propriétés de cette famille individuante est la mobilité croissante de ses membres à l’échelle de la ville, mais aussi à celle du pays, voire de son environnement régional. Chacune et chacun ne cesse de se déplacer pour ses besoins personnels, d’ordre professionnel, estudiantin, religieux ou culturel, ou encore familial puisque l’individuation multiplie les liens sociaux des unes et des autres, ce dont doit tenir compte le reste de la famille. Il s’ensuit des pratiques sociales de masse, telles que les pèlerinages, qui mobilisent chaque année des millions de personnes, les voyages touristiques, les séjours estudiantins dans les villes du pays, les déplacements des équipes sportives, le commerce transfrontalier licite ou illicite.
Peut-être est-ce cet imaginaire nouveau de la famille qu’a exprimé, en 2015-2016, le succès phénoménal d’une autre série télévisée, Shahrzad, dont la première partie mettait en scène, sous l’ancien régime, une jeune femme, étudiante en médecine et infirmière, qui accepte de devenir une seconde épouse pour sauver son aimé, prisonnier politique, mais voit cette union de raison se transformer en mariage d’amour à trois, en composant avec la première femme de son époux. En montrant que l’on pouvait se remarier par passion, quitte à délaisser l’enfant de son premier lit, leurs auteurs, Naghmeh Samini et Hassan Fathi, ont brisé bien des tabous sans créer de scandale, en suscitant un véritable engouement dans le public, et en créant toute une série d’effets de mode, vestimentaire ou autres. Un signe puissant que la modernisation de la famille, en République islamique, est allée de pair avec la montée du romantisme et d’une conception plus individualiste de l’amour.
En outre, la famille nucléaire et individuante s’est bureaucratisée et médicalisée. Les différentes étapes de la vie sont consignées dans les registres de l’administration et impliquent l’intervention des autorités médicales, à commencer par celle des psychologues qui sont de plus en plus sollicités pour faire face aux difficultés scolaires, éducatives, matrimoniales, ou tout simplement aux échéances de l’existence, à titre préventif : il est fréquent de consulter avant de convoler, à toutes fins utiles. Les kiosques de journaux et les librairies abondent d’ailleurs en manuels ou traités censés apprendre à leurs lecteurs à se mieux porter et à réussir.
En bref, la famille que la République islamique entend servir, et sur laquelle elle construit sa légitimité, sa morale, son contrôle social et politique, sa propre organisation, son mode d’accumulation, n’a plus rien à voir avec la famille des temps anciens. Elle se veut résolument moderne, en même temps qu’elle se distingue de la dégénérescence occidentale supposée. Il en résulte nombre de paradoxes, par exemple celui d’une République qui proscrit l’homosexualité, mais qui donne un statut légal aux transsexuels au point de rembourser leurs opérations chirurgicales.
L’État s’est arrogé l’éducation morale des jeunes au risque de devenir le père (ou la mère) que l’on doit tuer.
Néanmoins cette famille, source de stabilité morale et politique autant que de réconfort personnel, d’affection et de solidarité, est aujourd’hui en crise. Tout d’abord, le marasme économique interdit d’en observer les impératifs. Pour les jeunes, il est devenu quasiment impossible d’honorer l’obligation de la dot, d’assumer le coût des cérémonies, de trouver un logement. D’où la banalisation du concubinage, au grand dam des tenants de la morale sociale et religieuse qui s’interrogent gravement sur la destinée des enfants nés de telles unions. Par ailleurs, les divorces ont explosé, notamment dans les grandes villes : le quart des ménages s’y résolvent dans les cinq premières années de la vie commune, 60 % des divorcés étant des femmes de moins de trente ans. De ce fait, et aussi en raison de l’émigration, 1,2 million de femmes vivent seules avec leur(s) enfant(s) et sont chefs de famille, sans que la législation ni même les usages ne leur reconnaissent ce statut. La chute spectaculaire de la natalité a banalisé l’enfant unique, engendrant son lot de tensions psychologiques et remettant en cause à terme la reproduction économique de l’ordre familial, dans un pays qui ne brille pas par son système de retraite.
La société iranienne est également confrontée à différents fléaux sociaux, tels que le chômage, la précarité de l’emploi, l’insuffisance des salaires par rapport au coût de la vie, la déscolarisation ou la non-scolarisation des enfants (de un à deux millions d’entre eux vivraient dans la rue), la délinquance juvénile, la progression des suicides, notamment chez les femmes (avec un taux trois fois plus élevé que chez les hommes) et chez les jeunes de 15 à 30 ans, la montée de la prostitution et de la drogue (celle-ci est à l’origine de 53 % des divorces). Plus préoccupant, la violence s’installe dans la famille, comme l’a tragiquement illustré l’assassinat d’un père par des petits amis de ses filles, et à leur demande, à Téhéran, en 2015 : 34 % des crimes de sang impliqueraient des parents. En Iran, même le meurtre est familial !
Dans ce contexte la République islamique semble prise dans un effet de ciseaux. Depuis sa naissance, elle a fait de la famille le principal pilier de sa stabilité et de sa légitimité. Mais la crise de cette dernière menace maintenant de l’ébranler. L’État s’est arrogé l’éducation morale des jeunes, jadis dévolue aux parents, mais au risque de voir se retourner contre lui l’impatience de l’adolescence et de devenir le père (ou la mère) que l’on doit tuer. Chacun déplore la dissolution progressive des liens familiaux qui, par ailleurs, demeurent très valorisés et constituent toujours le seul horizon légitime. L’emprise croissante des pouvoirs publics sur la vie sociale, du fait de sa bureaucratisation, le développement de loisirs inédits, l’urbanisation tentaculaire, les difficultés économiques semblent les mettre en danger. De nouvelles pratiques, traumatisantes, apparaissent, telles que les fêtes de divorce, la mise en scène publique des suicides, l’auto-scarification chez les jeunes filles, l’augmentation des viols entre garçons ou des relations sexuelles entre des femmes divorcées ou célibataires et de jeunes adultes, la drague numérique sur Internet et par Telegram grâce à la magie des téléphones portables. Elles perturbent l’opinion autant que les autorités.
Près de quarante ans après la révolution, la République islamique, qui se voulait morale et protectrice de la famille, se trouve confrontée à des défis inattendus. À commencer par le recul du voile, qui, sur les écrans des smartphones, est depuis longtemps tombé, sans que ses hiérarques l’aient bien compris et aient le courage de renoncer à ce symbole fondateur du régime. Et aussi à un mouvement social que des femmes ont largement conduit, en janvier 2018, en prenant la tête des manifestations contre la spoliation de leur épargne. L’ambiguïté de la société iranienne trouve là son résumé : les femmes ne s’y révoltent pas contre l’obligation du voile, mais contre les faillites bancaires. Les mères, devenues des actrices économiques autonomes, et de plus en plus responsables de leur famille, ont une voix légitime, mais non les femmes jugées sans liens ni loi.
(NDLR : Ce texte a initialement dans le premier numéro d’AOC le 26 janvier 2018, nous le republions en signe de soutien au moment où nous apprenons avec émotion l’arrestation de Fariba Adelkhah en Iran)