Faut-il avoir confiance dans l’éducation ?
La longue période de massification scolaire ouverte au début des années 1960 n’a pas tenu toutes ses promesses. Il importe de comprendre quelques-uns des paradoxes provoqués par les profondes mutations des systèmes scolaires dans les sociétés riches, ouvertes et, encore, plus ou moins démocratiques, car les déceptions engendrées par la massification scolaire affectent les conduites des acteurs, leurs représentations des inégalités et leur confiance en eux et dans les sociétés dans lesquelles ils vivent.
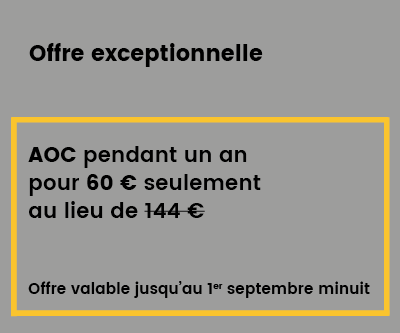
Même si les mutations du capitalisme et celles des États nations expliquent sans doute mieux les crises que nous vivons que les seules transformations de l’école, on doit aussi s’interroger sur le rôle de l’éducation. Interrogation d’autant plus nécessaire qu’elle pourrait élargir la critique et appeler de profondes réformes.
Les postulats de la confiance dans l’éducation
Au cours des cinquante dernières années, le lycée français s’est ouvert à presque tous les élèves et l’enseignement supérieur, à beaucoup d’entre eux : plus de 80% des jeunes âgés de 18 ans sont scolarisés et plus de 40% des jeunes âgés de 21 ans sont étudiants. Ceci n’a rien d’exceptionnel et bien des pays comparables font beaucoup mieux. En France notamment, le développement de l’éducation a été justifié par trois arguments dont l’origine est bien antérieure à la massification amorcée au début des années 1960 puis accélérée dans les années 1980.
Le premier postulat est celui de la croyance dans les progrès de l’égalité. Alors que les longues carrières scolaires étaient, de fait, réservées aux élèves issus des catégories sociales les plus favorisées, à l’exception de quelques boursiers parvenant à se glisser au lycée, l’ouverture de l’enseignement secondaire et l’allongement des études devaient accroître l’égalité des chances scolaires. En plaçant tous les élèves dans les mêmes conditions, la massification scolaire a porté une promesse démocratique selon laquelle l’égalité des chances devant les é
