Quel avenir pour le langage sous le règne du discours creux ?
Dans Au jour le jour, son « journal », l’helléniste Jean Bollack pointait un trait de l’époque : on ne demande à la parole, écrivait-il, que d’être efficace. Le contemporain s’exprime directement plutôt que librement, il vise un but. C’est un langage de la fonctionnalité qui règne, fait de vocables issus des sphères de l’économie et du « management ». La langue commune s’en voit en partie contredite et effacée.
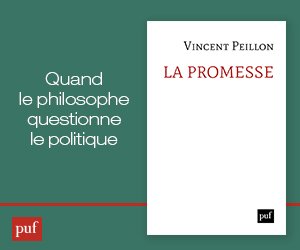
Dans le même temps – et sans doute les deux phénomènes sont-ils en partie liés –, on constate une brutalisation, un ensauvagement des mots (pour reprendre des termes utilisés récemment par l’historienne Mona Ozouf dans un entretien accordé à la revue Zadig). Cet ensauvagement, qui se traduit notamment par d’inquiétantes résurgences sémantiques, on ne le voit pas seulement à l’œuvre sur les réseaux dits sociaux ou à l’occasion de certaines explosions de colère sociales. On le sait, ce n’est pas là une spécificité française ni même européenne. Signe de l’ampleur de ce phénomène, de son caractère inquiétant, Robert Habeck, le jeune chef de file des Verts allemands, vient d’y consacrer un ouvrage [1].
C’est cette double violence aujourd’hui infligée aux mots qui m’a poussé à relire les Journaux tenus en Allemagne, à Dresde, de 1933 à 1945, par Victor Klemperer, journaux à partir desquels ce philologue (la philologie vise à réunir les conditions de la juste compréhension des textes) allait ensuite écrire, à l’après-guerre, son grand essai sur l’avilissement de la langue par l’idéologie, LTI, la langue du IIIe Reich. Carnets d’un philologue. Ayant lu ces ouvrages au début des années 2000, étant revenu vers eux il y a un peu plus de dix ans, partagé à chaque fois – comme, je le suppose, chacun de leurs lecteurs – entre admiration, stupéfaction et effroi, je savais que j’y retrouverais des aperçus décisifs sur la manière dont la langue commune, quelle qu’elle soit, peut être contredite et effacée, en l’occurrence par une idéologie mortifère. En revanche, il restait à voir si ces aperçus pouvaient être d’une quelconque utilité pour approcher les phénomènes que je viens d’évoquer. Après tout, il est plus que légitime de se demander dans quelle mesure une réflexion menée au temps du nazisme pourrait éclairer notre situation, aujourd’hui, dans le langage (je cite ici une expression de Pierre Pachet).
Une certaine modestie s’impose toujours quand on décide de traiter du langage.
Convaincu par cette nouvelle lecture que la portée de cette œuvre excède de loin son temps, je me suis décidé à restituer la démarche de son auteur et à proposer de cette œuvre une lecture retenant ce qui peut faire sens dans le présent. Il est vrai que l’univers intellectuel et moral du philologue (Montaigne, Lessing, Voltaire, Thomas Mann…), la sobriété de son écriture, l’empirisme de sa démarche exerçaient sur moi, depuis leur découverte, une séduction certaine ; il y avait donc aussi le désir de passer du temps en compagnie de l’auteur, dont je savais que les pages, les mots, ouvriraient sur d’autres en une série d’échos.
Chez Klemperer, qui ne s’estimait pas au-dessus du lot, j’aime d’abord l’humilité. Le philosophe Vladimir Jankélévitch rappelait qu’une certaine modestie s’impose toujours quand on décide de traiter du langage : « Le langage, obéissant aux affinités et résonances qui se créent entre les mots, ne cesse de véhiculer des partis pris venus du fond des âges », soulignait-il. « Les mots finissent par s’assembler entre eux de façon presque autonome, comme si le langage possédait une histoire indépendante de la nôtre ; et nous n’avons pas toujours la volonté d’opposer à la tentation des associations l’ascèse des dissociations, ni la force de résister à cet attrait des mots qui vont par deux, par trois, par quatre… »
Klemperer le savait fort bien : lui aussi, comme il le reconnut dans LTI, avait été, tout au long du règne nazi, dans le même paquebot que tous les autres. Lui aussi, à certains moments, avait été pris de mal de mer et s’était précipité au bastingage. Cette métaphore maritime que je lui emprunte est suffisamment claire : il lui arriva aussi de prononcer certains mots, certaines phrases trahissant une résurgence sémantique plus ou moins malheureuse. Robert Habeck, dans son tout récent ouvrage, a l’honnêteté de reconnaître avoir lui aussi connu ce « mal de mer », n’avoir, à l’occasion de telle ou telle manifestation publique, de tel ou tel interview, pas toujours su se prémunir de pareils faux pas.
De fait, personne ne le peut. Bien présomptueux celui qui se prétend parfaitement à l’abri de ce risque. Comme le résumait Jankélévitch, « nous sommes à la remorque du langage alors que nous croyons le conduire ». Prendre conscience de ce fait, ajoutait-il, c’est se rendre capable de déjouer cette constante menace de glissement : « Savoir qu’en parlant on obéit bon gré mal gré aux couches profondes de l’inconscient, c’est déjà n’être plus entièrement dupe des mots dont on se sert ». Toute réflexion conséquente sur le sujet devrait débuter par la reconnaissance de cette réalité dérangeante.
Une philologie du souvenir se soucie de généalogie, celui qui la pratique se fait historien du présent, anthropologue aussi.
Mais la modestie de Klemperer était aussi d’ordre méthodologique. S’il se gardait bien de plaquer sur le réel des cadres préétablis, il ne se souciait guère, en revanche, des frontières disciplinaires : à une sémiologie du nazisme, il articula une philologie d’un genre bien particulier, une « philologie du souvenir » (Philippe Roger), et cela afin de mieux enrichir le minerai qu’il parvenait à extraire du quotidien. « La culture savante de l’observateur, écrit Roger, sa mémoire vive du passé linguistique viennent alors mettre en perspective le détail sémantique ou onomastique, et réinscrire la LTI dans l’histoire culturelle allemande [2] ».
Une philologie du souvenir se soucie de généalogie ; celui qui la pratique se fait historien du présent, anthropologue aussi. Comment portraiturer, en effet, une nation renonçant à sa meilleure part et se donnant la mort sans combiner à l’empirisme de l’observation une réflexion à la fois généalogique et anthropologique ? Se lançant à l’après-guerre dans sa réflexion sur les douze années ayant précédé, précisément consignées dans les « journaux », Klemperer ne pouvait qu’inventer les modalités, la forme même de ce récit-là, à nul autre pareil.
Quant à moi, j’ignorais – bien heureusement – quelle forme définitive mon livre allait adopter, devinant seulement qu’il s’agirait d’un ouvrage où d’autres s’entre-appelleraient, l’enrichissant de leurs sens accumulés. Étant entendu que les « carnets du philologue » – c’est là le sous-titre de LTI – avaient été écrits à partir de la masse des « journaux des années de persécution », il allait s’agir de restituer dans un premier temps le quotidien du diariste tout au long de ces années et, dans un deuxième, l’écriture des « carnets », qui avait avant tout consisté en un travail de décantation et de mise en perspective des expériences vécues. Ce qui suivrait, dans une sorte de troisième mouvement, je ne le discernais pas encore.
Il arrive qu’au fil de l’écriture un motif a priori secondaire en vienne à jouer un rôle notable, central même, indiquant dès lors une direction aussi inattendue que nécessaire. Ce fut le cas et ce motif, formel en l’occurrence, fut celui du « carnet ». La lecture des « carnets » de Paul de Roux [3], qui a compté pour moi, qui compte toujours, m’avait permis, il y a quelques années, d’en découvrir d’autres, évoqués par ce très discret écrivain en raison de la parenté qu’il y discernait avec sa propre manière : je veux parler des carnets de Leonardo Sciascia (un seul et unique titre à vrai dire, Noir sur noir) et de ceux, plus nombreux, de Kazimierz Brandys (Carnets de Varsovie, de New York et de Paris). Je revins vers eux, ceux-ci me reconduisant aux Journaux de Gustaw Herling, où je retrouvais des pages consacrées à Klemperer lui-même.
A une sorte de brève histoire des sévices infligés à la langue commune par les idéologies meurtrières du XX siècle – brève histoire que me permettait de mener à bien la restitution de l’itinéraire du philologue dresdois, qui, à l’après-guerre, allait devoir supporter jusqu’à sa mort le langage stalinien, qu’il baptiserait LQI – s’articula dès lors une autre brève histoire, de ce que j’appellerais ici la forme « carnet philologique », forme inventée par quelques-uns pour mieux décortiquer ces logiques d’avilissement de la langue commune. Cela m’amena, à travers les figures et réflexions respectives de Pierre Pachet et Kazimierz Brandys, à évoquer la Pologne des années 1970 et 1980.
On désigne l’esprit d’un temps par sa langue.
Et c’est ainsi, sans l’avoir prémédité, que je « remontais » jusqu’à notre époque, cette époque où la langue se voit appauvrie à force d’être simplifiée, « en vertu » de cette croyance naïve selon laquelle une telle simplification rimerait avec communication améliorée, alors que, comme le soulignait Pachet, on ne communique correctement dans une langue qu’à la condition que ce soit bien difficile. Les empêtrements qui en résultent n’ont certes plus grand-chose à voir avec la pétrification de la langue du fait de l’idéologie, cette « lourde barre de métal rouillé » qui avait tant frappé Pachet à l’occasion de son séjour en Pologne en 1980, et qui condamnait alors tout échange à l’amertume de la non-coïncidence.
C’est à ces empêtrements d’un nouveau type qu’est consacrée la dernière partie du livre. Loin de partager l’idée plus que simpliste, défendue il y a quelques années par Eric Hazan dans LQR: La propagande du quotidien, selon laquelle notre rapport au langage serait exclusivement grévé par un très mégaphonique « novlangue » néolibéral, j’envisage l’actuel idiome néolibéral comme un élément parmi d’autres, certes notable, de notre situation, aujourd’hui, dans le langage. Je vois surtout notre époque comme celle d’une absence de langage commun, de langages également pauvres et ne partageant rien entre eux, hermétiques les uns aux autres et donnant expression à des expériences du présent n’ayant rien à voir entre elles (Ernst Bloch parlait en son temps de « non-contemporanéité » pour désigner une telle situation) ; comme celle, aussi, d’un présentisme le plus souvent subi, parfois choisi (je reprends ici des termes de François Hartog). Beaucoup attirent aujourd’hui l’attention, à mon sens à raison, et en lien direct avec ce constat (la non-contemporanéité et le présentisme sont propices à l’opinionisme), sur le rapport à la vérité problématique de nombreux contemporains, et j’ai également choisi de m’attarder sur cette question.
Comme l’écrit le philosophe Pascal Engel dans Les Vices du savoir, son récent et très précieux « essai d’éthique intellectuelle », notre temps partage au moins un trait avec celui de Klemperer : nous vivons une époque du baratin, où le souci de vérité semble toujours plus relever du superflu. Je ne sais si l’on peut parler au sujet de l’œuvre de Klemperer, comme on peut le dire de celle de son cher Lessing, d’une poétique de la vérité. Elle en a en tout cas le souci extrême. Dans le beau dossier consacré à « l’enquête » proposé cet été par le site En attendant Nadeau, le même Pascal Engel soutient – en faveur du pragmatisme, contre l’empirisme – qu’un savoir certain doit toujours préexister à l’enquête. Klemperer, s’était, avant de se faire enquêteur – contraint et forcé par les circonstances –, constitué un savoir considérable sur son objet de travail de toujours, la langue. Un savoir qu’il serait possible de résumer de la manière suivante : on désigne l’esprit d’un temps par sa langue ; celle-ci, qui ne ment jamais, est un révélateur ; c’est elle, toujours, à travers les sévices qu’on lui inflige, à travers les langages qui viennent la contredire et l’effacer, qui dit la vérité de son temps.
NDLR : Frédéric Joly publie La langue confisquée : Lire Victor Klemperer aujourd’hui aux éditions Premier Parallèle.
