Les trompe-l’œil du « 100 % santé »
Bien identifié par la recherche en sciences sociales et par les services de l’État et de l’assurance maladie, le phénomène du renoncement aux soins révèle les inégalités de santé que produit le système sanitaire français dont l’universalité est alors ramenée à son statut d’intention.
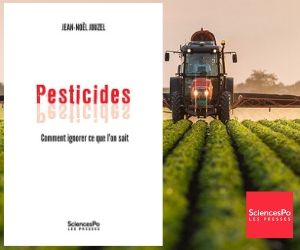
Si ses causes sont multiples, des raisons financières expliquent en grande partie cette insatisfaction des besoins de soins. Le renoncement se concentre ainsi sur des soins plus faiblement remboursés par l’assurance maladie (équipements optiques, prothèses dentaires, etc.) et dont le niveau de participation financière des assurés – leur « reste à charge » – dépend de l’acquisition d’une assurance complémentaire et de la qualité de ses garanties. Ainsi, 17 % des assurés sociaux de plus de 18 ans ont renoncé à des soins dentaires et 10 % à des soins optiques pour des motifs financiers en 2014, selon l’Enquête santé et protection sociale de l’IRDES. Si l’on s’intéresse au quintile le plus pauvre de la population, ces taux de renoncement montent respectivement à 28 et 17 %.
C’est en réponse à ce problème sanitaire qu’est lancée en 2018 la réforme dite du « 100 % santé » qui vise à supprimer le reste à charge des assurés dans les domaines de l’optique, du dentaire et des aides auditives. Promesse électorale du candidat Macron, cette couverture financière sera progressivement mise en place entre 2019 et 2021.
Elle porte sur un panier de produits de santé à prix plafonné, arrêté par l’administration, qui couvre un large éventail de soins optiques et prothétiques (verres pour l’ensemble des troubles visuels, prothèses dentaires, etc.). Ces soins sont remboursés conjointement par l’assurance maladie, dont la contribution est rehaussée, et par les assurances privées (mutuelles, sociétés d’assurance, institutions de prévoyance), contraintes de couvrir l’important reliquat, auxquelles les individus sont affiliés à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat collectif d’entreprise.
Le « 100 % santé » a tout de la mesure dont les gouvernants peuvent espérer un crédit politique. La répartition des coûts et avantages de la réforme peut tout d’abord nourrir une espérance en des profits électoraux futurs : elle bénéficie à un public étendu et concentre les pertes sur un nombre restreint d’acteurs.
Qui plus est, les effets symboliques de la mesure dans l’espace politique sont nombreux. Elle entretient l’image de gouvernants courageux et fidèles à leurs promesses électorales, qui bousculent les agencements institutionnels les plus enracinés et dont l’action parachève un système de protection sociale auquel les Français sont très majoritairement attachés. Présentée comme « une conquête sociale essentielle » par le président de la République au congrès de la Mutualité de juin 2018, la réforme prolonge en réalité des dynamiques d’action publique plus anciennes et renforce une tendance à l’individualisation de la protection sociale enclenchée depuis près de trente ans.
La construction étatique d’un marché de la santé
Jusqu’alors, les soins optiques et prothétiques se distinguent de la plupart des autres types de soins par la faiblesse de la régulation de leur prix et de l’évaluation de leur qualité par les autorités publiques. Ils sont ainsi rémunérés sur la base soit de tarifs libres sans remboursement public (implants dentaires), soit de « tarifs de responsabilité » (équipement optique, aides auditives, prothèses dentaires) fixés par l’assurance maladie, à partir desquels celle-ci calcule sa contribution financière.
Non opposables aux professionnels, ces tarifs sont très inférieurs aux prix réels pratiqués, à l’image des montures de lunettes tarifées à 2,84€ que la Sécurité sociale rembourse à hauteur de 60 % mais dont le prix moyen en optique simple est de 138€ en 2014. L’opacité économique de ces produits et prestations fonctionne alors comme une barrière dans l’accès aux soins. En effet, elle peut entretenir des hausses de prix, notamment dans l’optique, qui détournent une partie de la population de soins nécessaires et sont imparfaitement couvertes par les assurances privées dont les garanties ont été certes aménagées en conséquence mais restent très inégales selon les contrats.
La réforme du « 100 % santé » procède en premier lieu à la réduction de cette opacité à travers des opérations administratives de classification de produits et prestations de santé qui sont censées permettre le développement de relations d’échanges et de concurrence entre acteurs du secteur (assurances, assurés, professionnels). Ces opérations consistent à différencier à partir de critères techniques des biens de santé qui composent un « panier de soins » intégralement financés par la Sécurité sociale et par les assurances privées.
À ces biens sont associés des standards de qualité et des prix limites de vente ou des honoraires plafonds qui sont autant de repères dans les transactions. Par exemple, un prix maximum de 950€ est attribué à une aide auditive sans reste à charge pour un assuré de plus de 20 ans, qui présentera des caractéristiques techniques minimales complétées de prestations de suivi. Elle sera remboursée à hauteur de 240€ par la Sécurité sociale, l’assurance privée abondant en complément jusqu’à 710€. Dans une perspective de sociologie économique, la réforme peut être analysée comme une réponse à un « déficit cognitif » sur le marché des produits de santé par la production de classifications et de normes publiques fonctionnant comme des institutions marchandes qui rendent possibles des appariements entre acteurs du secteur et dont le respect est garanti par l’État.
La réduction de l’incertitude sur le contenu et le prix des biens de santé participe aussi à une uniformisation des conditions de l’échange entre professionnels de santé et assurances privées dont les formes de relation présentent jusqu’alors un caractère hétérogène lié à la coexistence de plusieurs types d’opérateurs (mutuelles, sociétés d’assurance, institutions de prévoyance). Ceux-ci se sont historiquement construits en référence à des principes de fonctionnement et des modèles économiques spécifiques qui se retrouvent partiellement dans leurs rapports aux opticiens, dentistes et audioprothésistes : mise en concurrence des professionnels dans le cadre de réseaux de soins initiés par des compagnies d’assurance, services de santé assis sur les principes de la médecine sociale développés par des mutuelles, etc.
Ces formes d’échange sont toutefois susceptibles d’être fragilisées par la réforme qui institue un nouveau cadre transactionnel commun aux différents opérateurs. Celui-ci prolonge un processus d’harmonisation des conditions d’exercice des assurances privées, amorcé dès les années 1980, qui soutient leur mise en concurrence sur un nouveau marché du risque santé construit par les autorités nationales et européennes.
L’individualisation de la protection sociale
Organisée dans un cadre marchand façonné par l’État, la prise en charge financière des soins auditifs, dentaires et optiques s’appuie très largement sur les assurances santé privées, en dépit de la revalorisation du niveau de remboursement de certaines prestations par la Sécurité sociale. Cette stratégie politique est d’abord rendue possible par la généralisation progressive de l’assurance maladie complémentaire depuis les années 1980 sous l’effet de plusieurs mesures adoptées par les autorités publiques : incitations fiscales à la mise en place de contrats collectifs d’entreprise (rendue obligatoire par l’Accord national interprofessionnel de 2013), financement public complet ou partiel de contrats individuels sous conditions de ressources, etc. Aujourd’hui, l’assurance maladie complémentaire couvre 95 % de la population, contre 69 % en 1980.
Cette stratégie se fonde ensuite sur le progressif encadrement étatique du contenu des contrats d’assurance santé depuis la fin des années 1980. C’est ainsi par le biais des « contrats responsables » – dispositif incitatif créé en 2004 auquel adhère la quasi-totalité des contrats de santé et qui les soumettent à une série d’obligations en échange d’allègements fiscaux – que les assurances privées sont amenées à couvrir intégralement les frais des produits du panier « 100 % santé » laissés par l’assurance maladie.
Par son architecture financière, la réforme du « 100 % santé » s’inscrit dans une dynamique d’individualisation de la protection sociale et d’affaiblissement des mécanismes de solidarité collective institués en 1945 au profit de logiques assurantielles privées qui présentent certes un caractère semi-obligatoire dans le cas de la santé, via l’entreprise, mais limitent la mutualisation des risques et produisent de faibles effets redistributifs. Contrairement à l’assurance maladie dont les ressources proviennent de prélèvements uniformes et globalement proportionnels aux revenus (cotisations sociales, contribution sociale généralisée), les assurances privées sont financées selon des règles hétérogènes et le plus souvent fondées sur le calcul des risques (l’âge, le lieu de résidence, limite d’âge à la souscription, etc.), en particulier pour les contrats individuels qui concernent plus de la moitié des personnes couvertes.
Bordées par l’État, ces pratiques tarifaires sont même de plus en plus adoptées par les mutuelles, pourtant attachées historiquement à une tarification solidaire, sous la pression concurrentielle des autres opérateurs soumis à une logique de marché. La réforme du « 100 % santé » ne fait finalement qu’approfondir le processus de « dualisation » de la protection sociale observé par Bruno Palier qui s’exprime notamment dans le développement d’une protection individuelle privée aux côtés de la Sécurité sociale, suite au recalibrage de ses prestations par une série de réformes mises en place depuis les années 1990.
Ces processus de dualisation et d’individualisation de la protection sociale entretiennent des inégalités de santé que la réforme du « 100 % santé » ne corrige qu’imparfaitement. Si elle impose à l’ensemble des contrats un nouveau socle de garanties qui améliore incontestablement l’accès aux soins, ses conséquences sur le niveau des primes sont encore incertaines et pourraient varier selon le type d’opérateur, la qualité et la nature individuelle ou collective du contrat.
De plus, la réforme reconnaît, à côté du panier sans reste à charge, un panier d’équipements à tarifs libres, aux propriétés techniques le plus souvent supérieures, dont la couverture par les assurances privées sera inégale. Elle dépendra de la qualité des garanties qui est partiellement corrélée au niveau de revenu des assurés et apparaît généralement plus faible pour les contrats individuels auxquels sont contraints d’adhérer les individus sans accès à une couverture collective (fonctionnaires, retraités, etc.). Ce faisant, la réforme reproduit en partie les inégalités sociales de santé qu’entretient l’assurance maladie complémentaire, comme le soulignent des économistes de la santé.
Une logique intégrative protectrice d’intérêts professionnels
Bien que la réforme du « 100 % santé » s’appuie dans sa mise en œuvre sur des acteurs marchands, elle ne participe pas pour autant à un évidement de l’État sanitaire. Au contraire, elle donne à voir le travail de coordination économique et politique entre l’assurance maladie dite « obligatoire » et l’assurance maladie complémentaire, auquel les autorités étatiques œuvrent depuis le début de années 2000. Celui-ci a pu être analysé par la sociologie politique en termes de processus intégratifs non linéaires qui rapprochent des acteurs de la santé (administratifs, financiers, professionnels) autrefois fragmentés et éloignés, par l’intermédiaire de nouvelles organisations ou d’instruments gestionnaires, et renforcent les capacités de pilotage sectoriel de l’État.
Les assurances privées sont directement touchées par ces dynamiques qui se traduisent au cours des années 2000 dans l’accumulation d’instances et d’outils de coordination (l’union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, les contrats responsables, etc.), d’efficacité inégale, auxquels s’agrège en partie la réforme du « 100 % santé ». Celle-ci peut ainsi être ramenée à un dispositif financier, supervisé par l’administration sanitaire centrale, qui articule la participation des différents financeurs à des soins ciblés et organise leurs relations avec les professionnels de santé dans un cadre marchand via la spécification de leurs produits et prestations, le plafonnement de leur prix et la formulation de standards de qualité.
La logique intégrative de la réforme présente l’intérêt pour les autorités étatiques d’afficher un objectif de santé publique tout en se pliant aux règles de la maîtrise budgétaire. Le coût de la réforme transféré aux acteurs privés est non seulement financier mais aussi politique dans la mesure où les assurances privées sont susceptibles de concentrer le mécontentement des assurés qu’une hausse des primes nourrirait, comme le pressentent les représentants des organismes d’assurance complémentaire.
La réforme trouve, de surcroît, le soutien de plusieurs représentants des professionnels de santé concernés, alors même que les mécanismes intégratifs sont initialement pensés comme un moyen de circonscrire la domination professionnelle et son emprise relative sur les politiques de santé. Non seulement le « 100 % santé » garantira probablement aux professionnels de santé un supplément de revenus par la solvabilisation d’une demande de soins encore insatisfaite, mais il leur apparaît aussi comme une alternative préférable aux réseaux de soins développés par les assurances privées à partir des années 1990 dans le même but de réduire le reste à charge de leurs assurés sur des soins optiques et prothétiques.
Fondé sur une contractualisation entre assurance et chaque professionnel autour de tarifs plafonds, ce dernier instrument intégratif d’origine privée exerce une pression à la baisse des prix et marginalise les organisations professionnelles. Ces dernières sont, à l’inverse, intégrées à la conception et à la mise en œuvre de la réforme du « 100 % santé » qui assure aux professionnels des tarifs stables et uniformes sur tout le territoire.
À la réforme du « 100 % santé » peut être opposée une solution plus solidaire et économe qui est celle du « 100 % Sécu » avancée par des hauts fonctionnaires du social et des économistes et que l’on trouve dans des programmes politiques à gauche. Dans cette perspective, la Sécurité sociale assurerait une prise en charge financière complète des soins – y compris dans les domaines optique, dentaire et audioprothétique – conduisant à la disparition de l’assurance maladie complémentaire. Ce changement organisationnel pourrait d’ailleurs s’appuyer sur le travail de référencement et de tarification des produits réalisé dans le cadre du « 100 % santé ».
Cette transformation semble cependant de plus en plus ardue à engager, à mesure que l’encastrement des assurances privées dans la protection sociale s’approfondit sous l’effet d’une accumulation de dispositifs dont la technicité croissante rend difficile le démantèlement, et qui constituent des clientèles toujours plus larges et promptes à défendre le statu quo.
