Retour des néonicotinoïdes : l’impossible réduction des pesticides ?
Interdits depuis 2018 en raison de leur nocivité pour les abeilles, les pesticides néonicotinoïdes sont actuellement réclamés par les producteurs de betterave et de maïs, en raison des menaces que les ravageurs font peser sur leurs récoltes en cet été 2020. Le spectre de ce retour de produits pourtant toxiques donne à voir la difficulté que représente la volonté affichée par les autorités de réduire fortement le recours aux pesticides en agriculture. En février dernier, un avis de la Cour des Comptes pointait du doigt l’échec des politiques publiques qui se sont succédées depuis plus de dix ans pour atteindre cet objectif. Constitué de six pages lapidaires, il donne à voir la pluralité et la coexistence des définitions du problème sur lesquelles ces politiques reposent.
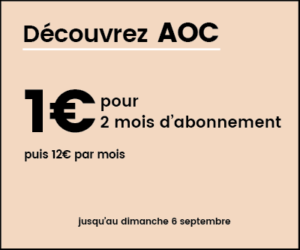
Historiquement, le principal mode de régulation des pesticides et de leurs effets indésirables a été le contrôle étatique de leur accès au marché. Dès le milieu du XXe siècle, ces produits ont été soumis à une autorisation de mise sur le marché, adossée à une évaluation des risques. Au terme de cette évaluation, ne peuvent être commercialisés que les pesticides pour lesquels ont été identifiées des doses « acceptables » d’exposition pour l’ensemble des organismes « non cibles », qu’il s’agisse d’insectes sauvages, de riverains ou de travailleurs. Pour qu’un produit soit autorisé à la vente, il faut que l’industriel précise les conditions d’utilisation (quantité maximale à l’hectare, mode de pulvérisation, port d’équipements de protection…) garantissant que ces doses acceptables ne seront pas dépassées.
Ce contrôle a priori a été par la suite progressivement complété par des dispositifs de surveillance post-autorisation de mise sur le marché des effets indésirables des pesticides, tant en termes de pollution de l’eau et de l’air que d’effets sur la faune sauvage, les abeilles domestiques ou la santé des travailleurs agricoles. L’objectif de cette surveillance est de produire des données permettant éventuellement de revoir les conditions de l’autorisation de mise sur le marché des pesticides pour lesquels des effets néfastes sont signalés, voire de les interdire.
Cette approche longtemps dominante des problèmes induits par le recours agricole aux pesticides repose sur un postulat simple : il est possible de réguler ces produits en évaluant leurs risques substance par substance, et en définissant pour chacune d’elles les conditions d’un usage contrôlé censé apporter une garantie de protection pour la santé humaine et l’environnement. Cependant, dans le monde réel, la faune, la flore et les populations humaines ne sont jamais exposées à des substances actives isolées.
Les pesticides constituent une nuisance sanitaire et environnementale difficilement maîtrisable.
Celles-ci sont, d’abord, mélangées avec des co-formulants pour former des préparations commerciales. Elles sont, ensuite, épandues sur des parcelles sur lesquelles peuvent subsister, parfois sur de longues durées, des résidus de traitements précédents avec lesquels elles peuvent interagir. De plus, les conditions d’utilisation mentionnées sur l’étiquette des produits ne sont pas toujours rigoureusement suivies par les agriculteurs et peuvent parfois s’avérer difficiles à mettre en pratique.
Les effets de ces expositions multiples et de leur répétition sur le long terme sont impossibles à objectiver dans le cadre de l’évaluation des risques. Mais depuis deux décennies, ils sont rendus progressivement visibles par un ensemble de recherches scientifiques dans des champs divers comme l’écotoxicologie qui donne à voir les dégâts que le recours aux pesticides engendre pour la biodiversité, et l’épidémiologie, qui montre que l’exposition des travailleurs agricoles aux pesticides constitue un facteur de risque significatif pour plusieurs pathologies chroniques parmi lesquelles la maladie de Parkinson, des cancers du sang ou de la prostate, des maladies respiratoires ou des troubles des fonctions reproductives.
En somme, les problèmes posés par les pesticides et leurs effets sur la santé et l’environnement varient suivant la focale à travers laquelle on les regarde. Observés substance par substance, en postulant que les utilisateurs des produits se conformeront strictement aux indications de « bonnes pratiques » mentionnées sur l’étiquette, les effets des pesticides apparaissent contrôlés. En revanche, lorsqu’on observe ces effets de façon holistique, à l’échelle de l’exposition aux pesticides en général, le doute n’est plus guère permis : les pesticides constituent une nuisance sanitaire et environnementale difficilement maîtrisable.
Il ne s’agit plus de garantir des conditions acceptables d’utilisation, mais de transformer en profondeur les pratiques agricoles.
Au début du XXIe siècle, ces constats ont débouché sur le développement d’une approche alternative, prenant en quelque sorte le problème des pesticides par l’autre bout : plutôt que de contrôler les risques des substances actives, il s’est alors agi de promouvoir la réduction globale de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Cette idée a été légitimée en 2005 par une expertise collective conjointe de l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) et du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref), dont les conclusions soulignaient la méconnaissance relative aux effets des pesticides dans leur ensemble et la nécessité d’engager les agriculteurs français à une moindre consommation de ces substances. C’est de cette idée que découle le plan « EcoPhyto » lancé en 2008 à l’issue du Grenelle de l’environnement avec pour objectif de réduire de 50% de la consommation de pesticides agricoles dans un délai de dix ans.
Si ce tournant n’a pas fait disparaître l’ancienne modalité de traitement politique du problème des pesticides, par l’intermédiaire de l’autorisation de mise sur le marché, de l’évaluation des risques et de la surveillance des effets indésirables, il en a institué une seconde, dotée d’objectifs propres. Il ne s’agit plus de garantir des conditions acceptables d’utilisation pour chaque substance, mais de transformer en profondeur les pratiques agricoles. Cet objectif de politique publique n’appelle pas les mêmes modes d’intervention, ne désigne pas les mêmes responsables, ne s’appuie pas sur les mêmes acteurs que le contrôle de l’accès au marché des substances actives.
En France, la responsabilité de l’orientation des pratiques agricoles a fait l’objet d’un grand partage lors de la phase de modernisation de l’agriculture, qui s’est étendue de la fin de la seconde guerre mondiale aux années 1970. Le ministère de l’Agriculture, dont certains agents étaient directement engagés dans des activités de vulgarisation technique et d’accompagnement, a peu à peu délégué ces fonctions à un ensemble d’organisations proches de la profession agricole : chambres d’agriculture, instituts techniques, fédérations et syndicats. C’est à ces organismes qu’est revenue la mission d’engager les exploitants dans l’adoption de nouvelles technologies et de pratiques leur permettant d’augmenter leurs productions. La transformation profonde de l’agriculture française a reposé sur la diffusion de technologies mais aussi sur le travail politique de ces intermédiaires de la modernisation.
Le plan Ecophyto est le théâtre de la confrontation entre l’ensemble des institutions chargées de l’orientation des pratiques agricoles et une nouvelle injonction : réduire la consommation de pesticides. Au bout de douze années, force est de constater que ses résultats « demeurent très en deçà des objectifs fixés », pour reprendre les termes de l’avis de la Cour des Comptes : la consommation des pesticides en France est relativement stable sur la période. C’est là la conséquence de la difficulté à intégrer dans les registres d’action du développement agricole la question de la réduction des pesticides. Une grande partie des instruments mis en place dans le cadre du plan Ecophyto, et dont le fonctionnement a accaparé l’essentiel des financements alloués, reposent sur les logiques traditionnelles du développement agricole : formation et démonstration, création de réseaux d’agriculteurs engagés…
Des modes d’intervention qui ont porté leurs fruits dans le cadre de la modernisation agricole des années 1970 n’ont pas permis de réduire la consommation des substances préoccupantes que sont les pesticides. La question soulevée par les difficultés du plan Ecophyto dépasse le cas des pesticides : comment gouverner les pratiques agricoles en dehors du cadre de la modernisation productiviste ? Et malgré ce que semble suggérer le rapport de la Cour des Comptes, les leviers qui permettront d’atteindre cet objectif sont toujours en cours d’élaboration.
Il faut une voie moyenne entre les approches « microscopiques », substance par substance, et les approches « holistiques », qui peinent à identifier les pesticides responsables des dégâts.
La situation peut sembler désespérée. D’un côté, un mode de gestion centré sur le contrôle de l’accès des pesticides au marché, sur la base d’une évaluation substance par substance, est de plus en plus contesté, comme en témoignent les controverses autour de la ré-autorisation du glyphosate. De l’autre côté, les tentatives qui prennent le problème de façon holistique pour tenter de transformer les pratiques agricoles afin de réduire globalement l’utilisation des pesticides se heurtent à l’inertie d’un monde agricole qui peine à oublier les sirènes de la modernisation. Les récents débats autour de l’agribashing nous montrent à quel point la place des organisations agricoles dans la transition écologique reste à négocier.
Entre ces deux perspectives d’action publique, sans doute existe-t-il cependant des options intermédiaires, qui restent à développer. Tel est par exemple le cas d’approches qui promeuvent une « évaluation des risques systémiques », abandonnant l’objectif d’identifier et de mesurer chaque effet toxique de chaque substance active, pour privilégier l’identification des effets éco-toxicologiques des pesticides en fonction des contextes spécifiques dans lesquels ils sont épandus. Une telle perspective est rendue possible par une série d’évolutions techniques et sociales qui ont pour effet de multiplier et de rendre plus accessibles les données relatives aux usages agricoles des pesticides : d’un côté, les progrès de la télédétection aérienne et de la modélisation des milieux, de l’autre l’incitation à la déclaration de leurs pratiques par les agriculteurs induite par l’éco-conditionnalité des subventions de la Politique agricole commune (PAC).
Intégrer davantage ces données sur les pratiques dans un processus d’évaluation continue du risque permettrait de dégager une voie moyenne entre les approches « microscopiques », substance par substance, qui peinent à tenir compte des effets systémiques des pesticides, et les approches « holistiques », qui peinent à identifier les pesticides responsables des dégâts sanitaires et environnementaux qu’elles documentent. La mise en place d’un système d’évaluation des risques qui ne soit plus caractérisé par une logique descendante, mais par une implication des agriculteurs dans la production de données sur les substances qu’ils utilisent laisse également entrevoir la possibilité d’une mise en débat de ces technologies à un niveau local.
On peut y voir l’opportunité de structurer les controverses et d’apaiser les tensions qui traversent les campagnes françaises, notamment à l’échelle des communes. C’est en ce sens que la première des recommandations de la Cour des Comptes « introduire, dans les négociations de la nouvelle politique agricole commune, un objectif prioritaire de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques » peut s’avérer stratégique pour les évolutions futures des politiques de contrôle des pesticides. C’est bien à un niveau européen que devra être menée la réflexion, et l’ambition d’une réduction de la consommation de ces substances ne pourra être envisagée sans une mise en débat du processus d’évaluation des risques que leur usage occasionne.
