Haut-Karabakh, une mémoire à vif
Pourquoi le conflit ravivé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan depuis le 27 septembre est-il perçu par les Arméniens du monde entier comme une lutte pour la survie de leur peuple ? À première vue, on se trouve face à un conflit territorial classique, une crise qui aurait éclaté il y a une trentaine d’années. Le Haut-Karabakh est une région sécessionniste du Caucase, une zone grise de la géopolitique héritée de l’Union soviétique, disputée entre deux jeunes États.
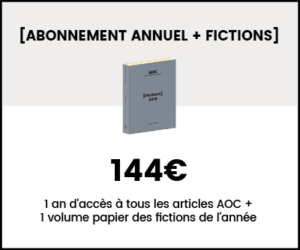
Historiquement peuplé d’Arméniens, rattaché à l’Azerbaïdjan par Staline en 1921, le Haut-Karabakh fait, selon plusieurs résolutions successives des Nations Unies, partie intégrante du territoire de l’Azerbaïdjan redevenu indépendant en 1991. La province, occupée par l’Arménie, a été rebaptisée république d’Artsakh.
Après une première guerre (1988-1994) sanglante, des pogroms anti-arméniens à Soumgait et Bakou, un nettoyage ethnique et un massacre de civils azéris à Khojaly, 30.000 morts et finalement un cessez-le-feu en 1994, le conflit s’est gelé, un statu quo s’est installé. Mais la haine entre les deux voisins n’est jamais retombée. Alors quand Bakou, en position de force, s’est lancé militairement à la reconquête de ce territoire fin septembre, le brasier s’est rallumé aussitôt. De part et d’autre, la mobilisation générale a été décrétée dans une atmosphère d’exaltation nationaliste. Les vétérans de la première guerre du Karabakh, le « jardin noir », ont repris les armes.
Pourtant, l’histoire commence bien avant les premiers heurts inter-communautaires de 1988. La plupart des analyses mésestiment souvent un paramètre essentiel pour comprendre la profondeur historique de ce conflit et le sentiment de revanche qui anime les belligérants. Sa dimension psychologique. Que ce soit en Arménie, État fondé sur l’ancienne république soviétique, ou dans la diaspora arménienne, disséminée à travers le monde après le génocide perpétré par le gouvernement Jeune Turc en 1915, cette nouvelle guerre ne sera jamais considérée comme un simple différend territorial.
C’est une question de survie collective. « Une menace existentielle », selon le premier ministre arménien, Nikol Pachinian. « Nous estimons que la Turquie est venue dans le Caucase du Sud pour poursuivre la politique de génocide du peuple arménien, a-t-il déclaré le 12 octobre devant les ambassadeurs étrangers à Erevan. Les hostilités et leur nature ont démontré une fois de plus que le peuple arménien, les Arméniens du Haut-Karabakh sont confrontés à une menace existentielle. Il devient évident que l’objectif politique officiel de l’Azerbaïdjan est d’anéantir les Arméniens ».
Loin de se dissiper avec le temps, le négationnisme officiel turc reste un pilier idéologique d’État.
Discours paranoïaque ? « Le danger est probablement surjoué par Nikol Pachinian », fait observer le politologue turc Cengiz Aktar. En Azerbaïdjan comme en Turquie, le frère de sang et le principal allié de Bakou dans cette offensive, cette rhétorique arménienne est parfaitement inaudible car le génocide de 1915 reste un tabou historique absolu. Plus de cent ans après, Bakou et Ankara rejettent ce qu’ils considèrent être « des thèses arméniennes mensongères » ou « un soi-disant génocide » et les deux États déploient des efforts diplomatiques et financiers colossaux pour s’opposer à sa reconnaissance à travers le monde.
« À cause de leur déni du génocide, les populations de la Turquie et de l’Azerbaïdjan ne peuvent pas comprendre que tous les Arméniens, indépendamment du conflit au Karabakh, perçoivent ces attaques comme la continuation du génocide et donc comme une question de vie ou de mort », souligne Cengiz Aktar. Avec un groupe d’intellectuels, celui-ci avait été l’instigateur, en 2008, d’une pétition publique en Turquie pour « demander pardon aux Arméniens », initiative qui, aujourd’hui, lui vaudrait des poursuites judiciaires. L’heure n’est plus à l’ouverture démocratique ni à l’introspection historique. En 2018, Cengiz Aktar s’est exilé en Grèce.
La mécanique du déni est commune à la plupart des crimes contre l’humanité. Mais le négationnisme du génocide des Arméniens a une particularité de taille. C’est un discours d’État, entretenu depuis plus de cent ans par les héritiers du gouvernement Jeune-Turc de 1915. La Turquie refuse catégoriquement de reconnaître la préméditation et la planification des déportations et des massacres qui ont mené au « grand crime ». Depuis un siècle, un récit alternatif s’est même imposé, au prix d’un lobbying intense. Il présente les Arméniens comme une cinquième colonne, alliés aux Russes, et les déportations comme une mesure de sécurité indispensable à la survie de l’empire turc. Les archives ottomanes ont été progressivement expurgées et les traces de la présence arménienne en Anatolie ont été effacées. C’est paradoxalement ce qui rend cette question aussi brûlante.
Comme le théorisait l’historien Pierre Vidal-Naquet dans Les Assassins de la Mémoire, Essai sur le déni de l’Holocauste, le négationnisme est « une tentative d’extermination sur le papier qui succède à une extermination physique », le prolongement idéologique du génocide lui-même. « Dans le cas du massacre des Arméniens, l’État turc est clairement révisionniste », écrivait Vidal-Naquet, parlant d’une « historiographie de la dénégation ». La mécanique du déni est strictement semblable à celle qui s’est construite après la Shoah. « Imaginons Faurisson ministre, Faurisson général, Faurisson ambassadeur, Faurisson membre influent des Nations unies, Faurisson répondant dans la presse chaque fois qu’il est question du génocide des Juifs, bref un Faurisson d’État doublé d’un Faurisson international et, avec tout cela, Talaat-Himmler jouissant depuis 1943 d’un mausolée solennel », soulignait-t-il pour parler de la Turquie.
Loin de se dissiper avec le temps, le négationnisme officiel turc reste un pilier idéologique d’État, « une industrie », selon l’historien Taner Akçam, pionnier des travaux sur le génocide dans son pays[1]. « En niant ce qui s’est passé en 1915, la Turquie reproduit les institutions, les relations sociales et la mentalité qui ont conduit au génocide. Le déni va beaucoup plus loin que la défense d’un régime passé dont l’idéologie a abouti à un génocide. Cela nourrit une politique d’agression continue, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la Turquie, contre tous ceux qui s’opposent à la mentalité négationniste », soulignait Akçam en 2014. L’historien a rappelé qu’en 2001, le Conseil de sécurité nationale, la plus haute autorité institutionnelle, avait établi un Comité de coordination et de lutte contre les accusations infondées de génocide (ASIMKK), regroupant toutes les institutions les plus importantes, sous l’égide des militaires. C’est l’institutionnalisation du négationnisme. Ces structures ont été réactivées après 2007 par Recep Tayyip Erdogan et ses proches. Elles demeurent d’actualité.
En 2008, c’est sous la pression de Bakou que la Turquie dut refermer une période de dialogue avec l’Arménie,
L’ex-militant maoïste Dogu Perinçek, leader nationaliste désormais allié au président turc, devenu un rouage essentiel du pouvoir, fut envoyé pour porter le combat jusque devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Il avait été condamné, en Suisse, pour avoir déclaré que la « thèse » du génocide arménien relevait « d’un mensonge international ». Il sortit vainqueur de cette bataille judiciaire, en 2015, année du centenaire. La propagande révisionniste s’infiltre dans la bureaucratie, dans les ministères, mobilise d’obscurs think-tanks et des départements d’universités. « La république turque s’est bâtie sur le déni national. L’écrasante majorité des Turcs n’a aucune empathie et se trouve incapable de prendre conscience que tout Arménien ressent ce qui se passe comme la poursuite du génocide », appuie Cengiz Aktar.
Cette histoire officielle et les efforts d’influence auprès de la communauté internationale ont été largement sponsorisés, dès la fin des années 2000, par l’Azerbaïdjan. En 2008, c’est sous la pression de Bakou que la Turquie dut refermer une période de dialogue avec l’Arménie, marquée par « la diplomatie du football » et l’espoir d’un début de réconciliation. L’Azerbaïdjan, riche producteur de pétrole et de gaz naturel, est un fournisseur majeur d’énergie pour Ankara et la compagnie nationale Socar est devenue un poids lourd de l’économie turque au prix de nombreux investissements.
En Turquie, les Arméniens restent la première cible des « discours de haine » dans les médias et dans la sphère politique, selon les études réalisées chaque année par la fondation Hrant Dink, qui porte le nom du journaliste arménien assassiné par un jeune nationaliste à Istanbul en 2007. La société turque les considère toujours comme « les restes de l’épée », expression qui désigne les rescapés de 1915, utilisée encore récemment par Recep Tayyip Erdogan dans une allocution officielle. Cette inclinaison est d’autant plus forte que, depuis 2015, le président turc gouverne avec les ultranationalistes du MHP (parti d’action nationaliste), parti d’inspiration fasciste, viscéralement négationniste.
Leur chef, Devlet Bahçeli, s’est montré le plus en verve pour justifier la guerre dans le Haut-Karabakh, appelant à « écraser la tête du serpent » et à « noyer les Arméniens dans leur propre sang ». « C’est la même rhétorique de haine que nous vivons depuis quatre générations, fait remarquer Garo Paylan, député arménien de Turquie, élu sous l’étiquette du parti pro kurde (HDP). Comme à l’époque, la démocratie est suspendue et la Turquie est dirigée par deux leaders racistes. Enver et Talaat Pacha à l’époque. Erdogan et Bahçeli aujourd’hui. »
Pour l’historien du génocide de 1915, Raymond Kevorkian[2], « nous payons aujourd’hui, au Haut-Karabagh et ailleurs, l’incapacité des vainqueurs de la Première Guerre mondiale à punir les criminels turcs auteurs du génocide des Arméniens ». L’impunité des criminels de guerre et des génocidaires, leur recyclage par Mustafa Kemal dans l’appareil d’État républicain, leur glorification par l’histoire officielle, ont créé un monstre prêt à récidiver. Et si la Turquie s’est lancée en 2020 dans cette aventure pour reprendre le Haut-Karabakh, c’est justement parce que « ce pays partage avec l’Azerbaïdjan, que le régime jeune-turc de triste mémoire a porté sur les fonts baptismaux en 1918, un héritage génocidaire ».
L’affaire Safarov est souvent citée en exemple de cette « obsession génocidaire » qui continue de hanter Arméniens et Azerbaïdjanais, d’un climat de haine entretenu selon lui par le régime du président Ilham Aliev. Le 12 octobre, le premier ministre arménien Nikol Pachinian a cité Safarov pour illustrer la « menace existentielle » qui planerait sur son peuple.
Ramil Safarov, lieutenant-colonel de l’armée azerbaïdjanaise, fut choisi pour participer, en 2004, à un séminaire de formation du Partenariat pour la paix de l’Otan, organisé à Budapest. Deux officiers arméniens y prenaient part. Le 18 février, Safarov acheta une hache dans un magasin de bricolage, l’aiguisa patiemment. La nuit suivante, il traversa les dortoirs et attaqua Gurgen Margaryan dans son sommeil. Ce dernier fut massacré de 16 coups de hache. « L’expression du visage de Safarov montrait qu’il avait achevé quelque chose d’important », témoigna le compagnon de chambrée de la victime, un Hongrois.
Les aveux faits par Ramil Safarov lors de son procès sont lourds de sens. Né à Jabrayil, une ville du Haut-Karabakh occupée par les Arméniens en 1993, l’officier azéri a exprimé « son regret de ne pas avoir tué plus d’Arméniens avant cela ». « Ma mission est de les tuer tous car tant qu’ils vivent, nous souffrirons », déclara-t-il avant d’être condamné à vie en 2006. Mais après huit ans de prison et un marchandage entre Aliev et le gouvernement hongrois de Viktor Orban, Safarov fut extradé vers Bakou, où il fut aussitôt gracié et promu au rang de major. Célébré comme un héros national après avoir été emprisonné pour avoir, selon la présidence azerbaïdjanaise, « défendu l’honneur et la dignité de son pays ».
