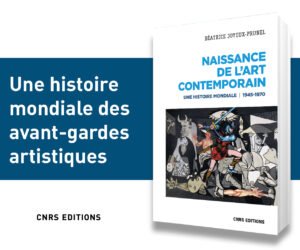To test or not to test ? Le dépistage au cœur des controverses
Invention majeure du début des années 1980, aujourd’hui centrale en biologie moléculaire, la technique PCR (Polymerase Chain Reaction) n’a pas été conçue pour répondre à un problème spécifique[1]. Ce n’est qu’une fois disponible qu’elle est apparue comme une solution à différents problèmes. Une des caractéristiques de cette technique est ainsi son extraordinaire polyvalence. Elle est utilisée dans des domaines aussi divers que la recherche sur le génome humain, les enquêtes médico-légales, la science alimentaire et vétérinaire, l’écologie, le diagnostic médical ou encore l’épidémiologie.
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de SARS-CoV-2, les tests PCR, tout comme les tests antigéniques introduits plus récemment, participent à deux registres d’usage que l’on peine parfois à distinguer.
Le premier registre d’usage relève de la prévention individuelle et collective. En l’absence de traitement spécifique, les tests servent à identifier et trier les personnes contaminées pour les séparer de celles qui ne le sont pas. Quel que soit le résultat des tests, chacun peut se sentir individuellement concerné par le rappel de mesures de prévention (gestes barrières, port du masque, etc.). Préoccupation qui, dans le même temps, s’étend à l’entourage et aux espaces de circulation des individus. Plus formellement encore, les personnes testées positives doivent entrer dans un dispositif prophylactique comprenant des mesures d’isolement et de traçage de celles et ceux ayant été ou étant en contact avec elles.
En outre, ces résultats intéressent collectivement certaines organisations. Depuis peu, les tests peuvent ainsi participer à la protection de la santé et de la sécurité des entreprises. Les employeurs peuvent donc proposer des tests antigéniques à leurs employés, à l’instar de ce que font depuis le printemps dernier les établissements de soins pour leurs personnels.
Le second registre d’usage des tests est celui de la production de données pour la surveillance épidémiologique. Les résultats des tests s’insèrent dans des bases de données sanitaires (SI-Dep) afin de calculer le taux d’incidence du virus et d’en estimer la prévalence, tout en rendant compte de sa dynamique de diffusion par différentes représentations graphiques. Sous la forme de cartes, d’indicateurs et de courbes, celles-ci sont utilisées pour évaluer l’ampleur et la gravité de l’épidémie, afin d’adapter et justifier les stratégies gouvernementales de lutte contre le virus.
Même s’ils semblent cohérents et complémentaires, ces deux registres d’usage des tests, préventif et statistique, font l’objet, directement ou indirectement, d’une controverse, dont les différents enjeux sont plus ou moins médiatisées.
Du virus ou des risques : que mesurent les tests ?
Devenu le standard mondial, les tests PCR détectent l’ARN viral présent chez une personne infectée pendant la semaine qui suit la contamination, c’est-à-dire pendant la période de contagiosité. Toutefois, cet ARN pourrait être présent chez une personne qui a inhalé du virus sans être contaminée. Il peut aussi rester dans le nez pendant des semaines, voire des mois, après une guérison, c’est-à-dire bien après qu’une personne contaminée a cessé d’être contagieuse. Une personne guérie et non contagieuse peut donc très bien s’avérer positive à un test PCR alors qu’elle ne présente plus de risque de transmettre la Covid.
Dès le mois d’août dernier, ces aspects techniques ont conduit des experts médico-scientifiques britanniques à interroger la signification des variations du nombre de « cas » quotidiennement répertorié et communiqué par les autorités publiques pour faire état de l’ampleur de l’épidémie[2]. Jusqu’à l’arrivée récente des tests antigéniques, ces mêmes chercheurs relevaient qu’un cas de Covid était enregistré comme tel du fait d’un test PCR positif. Il en résulte que la notion de « cas » amalgame des personnes pouvant être contagieuses avec des personnes qui ne les sont plus mais ayant encore du virus « mort », i.e. non actif, dans les fosses nasales. Ainsi, un dépistage de masse peut conduire à l’augmentation du nombre de cas alors même qu’une proportion d’entre eux ne présente pas ou plus de danger de transmettre le virus.
L’incertitude du « cas »
De manière connexe, cette controverse sur la signification et le nombre réel de « cas » conduit à un second débat sur la qualité de l’information des tests PCR comme outils de prévention. Sauf rares exceptions, le résultat de ces tests est binaire : négatif ou positif. Or, cette information est insuffisante. En effet, savoir à quel point une personne est positive à un test PCR importe davantage. Sinon, le risque est d’isoler des personnes qui ne sont pas ou plus contagieuses.
Ici le fonctionnement d’un test PCR doit être pris en compte. Il procède d’un nombre de tours d’amplification (Cycle threshold – CT) – qui peut être limité, cette limite tenant lieu de seuil de positivité ou de détection des tests. Plus le nombre de tours est élevé, plus le test détecte des fragments de virus, c’est-à-dire du virus inactif chez des personnes alors non contagieuses. D’un strict point de vue statistique, et pour repérer et surveiller la présence du virus (mort ou vif) dans une population, un nombre élevé de tours d’amplification peut avoir du sens. Mais du point de vue de la réduction des chaînes de transmission, cela en a-t-il, a fortiori quand ces résultats conduisent à isoler des personnes positives mais non contagieuses ?
En France, des médecins et des scientifiques ont publiquement posé cette question, en demandant pourquoi les autorités n’avaient pas fixé un seuil de positivité des tests PCR au-delà duquel l’information n’est plus pertinente pour la prévention[3]. Par ailleurs, il est encore rare qu’une personne dépistée positive à un test PCR reçoive son résultat accompagné du nombre de CT, malgré des recommandations émises en ce sens par la Société française de microbiologie en septembre dernier. Le choix du nombre de CT variant d’un pays à l’autre voire d’un laboratoire à l’autre, les comparaisons internationales et statistiques mondiales sur les personnes positives au SARS-CoV-2 s’en voient complexifiées.
PCR vs. Antigénique : un dilemme ?
Sans remettre en cause l’usage des tests PCR, une des solutions proposées par les pouvoirs publics est de les compléter par des tests antigéniques. La controverse s’est alors déplacée sur la mise en balance des qualités respectives de ces deux techniques. Pour certains épidémiologistes, les tests antigéniques offrent plusieurs avantages. Ils sont moins chers que les tests PCR, fournissent un résultat plus rapide (en moins de 30 minutes contre plusieurs jours pour les PCR), ne nécessitent pas le recours à un laboratoire d’analyse puisque qu’ils se présentent sous la forme de kit et peuvent donc être réalisés par un médecin, un infirmier ou dans des pharmacies disposant d’un espace dédié. En outre, contrairement à la PCR, les tests d’antigènes détectent du virus vivant, et non pas seulement l’ARN viral. Si le but est de repérer des personnes contagieuses afin de casser les chaînes de transmission, alors les tests antigéniques sont plus efficaces que les PCR.
À cela, les partisans des tests PCR répondent d’abord que cette dernière technique relève du standard international. Ensuite, ils arguent de la moindre sensibilité des tests antigéniques qui ne détecteraient comme positives que les personnes ayant une charge virale élevée. Ceux qui défendent les tests antigéniques considèrent que cette comparaison ne tient pas car les deux techniques sont différentes et ne répondent pas aux mêmes finalités. Schématiquement, le test PCR serait un dispositif médical de diagnostic visant à repérer du virus quel que soit son état, alors que le test antigénique serait un outil de santé publique visant à repérer les personnes contagieuses afin de pouvoir limiter rapidement les risques de transmission. Ce dilemme est résumé par le Dr. Supriya Sharma, conseiller principal à Santé Canada : « Un test qui donne trop de faux résultats négatifs peut conduire à ce que les individus ne s’isolent pas comme ils le devraient, et potentiellement à ce que davantage de personnes soient exposées au virus. Et un test qui donne trop de faux résultats positifs pourrait conduire les gens à s’isoler inutilement ».
Désorganisations : toujours un manque de moyens
Un autre aspect de la controverse sur le dépistage porte aussi sur son organisation par les pouvoirs publics. On peut s’étonner qu’ils croient encore qu’un dépistage massif soit la solution pour arrêter la transmission d’un virus très infectieux ayant une période d’incubation courte. Cependant, d’autres experts et responsables publics voient dans les longues files d’attente devant les laboratoires et le caractère caduc de résultats rendus trop tard des défaillances organisationnelles que plus de moyens, de tests et de personnels mieux formés permettraient de corriger.
Ces solutions humaines et matérielles sont également avancées afin de surmonter l’échec de la première phase des procédures de traçage et d’isolement. Le remplacement de l’application StopCovid par TousAntiCovid devant, par la grâce de la technologie et du marketing, laisser espérer, cette fois-ci, la réussite de la stratégie « tester-tracer-isoler ».
Les sens de la maîtrise : pourquoi dépiste-t-on ?
Les critiques et solutions émises dans la controverse sur le dépistage du SARS-CoV-2 ne sont pas nouvelles : elles ont déjà été formulées dans le cadre d’autres pathologies et épidémies. Ces énoncés présentent toutefois des limites car ils se focalisent essentiellement sur la dimension instrumentale ou utilitaire du dépistage. De fait, ils conduisent implicitement à supposer que les failles du dispositif de dépistage sont inconnues des autorités publiques. Plus encore, ils présument qu’une fois les erreurs reconnues, ces mêmes autorités publiques les corrigeraient en abandonnant, pourquoi pas, certaines mesures techniques pour d’autres, plus performantes.
Or, depuis des mois, on assiste davantage à une superposition qu’à une substitution de techniques. Les tests antigéniques s’ajoutent aux tests PCR et les modes comme les substrats de prélèvements se diversifient. De façon circulaire, l’empilement des solutions techniques doit permettre de corriger des problèmes considérés, eux-aussi, comme avant tout techniques.
Se déprendre de la technique : une question politique
Face à ces approches instrumentales et leur tropisme technophile, nous proposons un pas de côté. En effet, comment envisager que les responsables politiques et les experts en charge de penser, gérer et organiser la lutte contre cette épidémie, ne soient pas conscients (au moins dans une certaine mesure) des limites du dépistage de masse, des équivoques des tests par PCR, des inconvénients des tests antigéniques, de l’inefficacité des mesures de traçage et d’isolement ? Et ce, alors même que ces armes sont présentées comme centrales dans la stratégie de la « guerre contre le virus » ?
Nous faisons l’hypothèse, soutenue par des travaux en sciences sociales, qu’en dépit de la connaissance de ces limites, les pouvoirs publics ne peuvent pas renoncer au dispositif de dépistage. Cette continuité a des raisons politiques, certes instrumentales, mais aussi symboliques car relatives au contrôle qu’ils souhaitent avoir et donner à voir sur cette épidémie.
À cet égard, alors que la diffusion de l’épidémie révèle et renforce des inégalités socio-économiques et sanitaires, la vulnérabilité de notre système de soins, les défaillances dans l’organisation de la réponse publique, la faiblesse structurelle de la santé publique en particulier sur son volet prévention, elle souligne également une crise symbolique du contrôle.
C’est bien ce que rappelle le président Macron dans son allocution du 24 novembre dernier. Reconnaissant que les faiblesses de la stratégie adoptée depuis mars relèvent d’une « organisation imparfaite » jugée « trop bureaucratique », une nouvelle stratégie, résumée par la formule « tester, alerter, protéger, soigner » prévoit un « retour à la normale » si nous « pouvons maîtriser l’épidémie dans la durée » et « contrôler » le virus. C’est donc bien à retrouver la maîtrise et le contrôle de l’épidémie que les tests doivent servir.
Des solutions qui viennent d’ailleurs
Pourtant, des travaux de sociologie des organisations ont depuis longtemps montré que ces dernières peuvent pour des raisons diverses prendre des mesures qui n’ont pas forcément d’efficacité immédiate. Dans cette lignée, des routines ou des traditions organisationnelles, pourraient en partie expliquer pourquoi le dépistage, solution fortement ancrée dans la culture occidentale de santé publique, est considéré comme ce qu’il est nécessaire de faire. On peut aussi prendre en compte les études relatives à l’isomorphisme[4] et aux transferts internationaux de politiques publiques, pour envisager l’adoption du dépistage par PCR en France à l’aune de choix étrangers.
En effet, d’autres pays ont privilégié ce type de dépistage auparavant et la technique de la PCR a été constituée en norme internationale – on se souvient des louanges adressées aux États ayant, dès le mois de mars, fait ce choix. Ce mimétisme international s’illustre également dans le choix du confinement – la Chine puis l’Italie ayant érigé en modèle ce qui n’était qu’une solution nationale ou locale, discutable sur de nombreux plans (sanitaires, sociaux, économiques, politiques, éthiques…). On peut également s’étonner du choix récent de plusieurs municipalités françaises de dépister massivement leurs habitants en prenant comme exemple la ville de Liverpool ou un pays comme la Slovaquie.
Contre le désordre des conduites
Dans une perspective historique, d’autres travaux verront dans le dépistage un instrument s’inscrivant dans une logique d’institutionnalisation de la surveillance et du contrôle des populations. Déployée au XXe siècle, elle a conduit les organisations, dont l’État, d’une part à repérer et surveiller les individus porteurs d’agents pathogènes comme étant à risques, pour ne pas dire dangereux pour l’ordre public ; d’autre part, à rendre ces mêmes individus comptables de leurs comportements, en fonction de normes notamment sanitaires. Michel Foucault voyait dans les maladies à déclaration obligatoire une des illustrations de cette police sanitaire fondée sur la responsabilisation des individus.
On pourrait ainsi comprendre les pratiques actuelles d’isolement plus ou moins volontaires des personnes testées positives, de recensement des « cas » dans des bases de données épidémiologiques et d’extension de la surveillance aux cas contacts sur un modèle désormais rétroactif. De même, jeter publiquement l’opprobre sur les comportements déviants par rapport aux normes sanitaires est une pratique récurrente depuis l’été dernier. On ne répertorie plus les appels à davantage de discipline et à la responsabilité de chacun, sans compter les accusations de mise en danger de la vie d’autrui pour quelques rassemblements ou fêtes dites « clandestines ». C’est entendu, les Français seraient naturellement rétifs à adopter les « bons comportements ».
Mais à qui s’adressent ces appels répétés à plus de vertu sanitaire ? Comme l’ont montré des sociologues et des économistes de la santé, la stigmatisation de certains comportements se fonde sur leur mise en opposition à ceux de l’homo medicus[5], cette fiction sanitaire ciblée par les campagnes et messages de santé publique. Rationnel et calculateur, cet être idéal ignore ses émotions et les plaisirs tant culturels que sociaux pour se consacrer entièrement à la préservation de sa santé.
Parmi les outils dont l’homo medicus dispose, les tests occupent une place de choix. Grâce à leurs résultats, validés par la science, ils permettent de compléter l’observation quotidienne, quasi clinique, des signaux du corps et de vérifier l’absence de risque pour le « capital santé ». Et si en contexte épidémique, se protéger c’est aussi protéger les autres (et vice versa), alors l’homo medicus deviendra epidemicus. Il se fiera sans réserve aux messages et conseils préventifs pour réformer ses conduites et inciter les autres à faire de même. Rationalité instrumentale oblige.
Une symbolique du contrôle : des vagues en courbes
D’autres travaux s’inscrivant dans les approches institutionnelles ont montré combien de nombreuses mesures prises par les organisations présentaient une dimension symbolique. Dans cette lignée, il s’agit alors moins de s’intéresser à la généralisation du dépistage comme instrument d’action sanitaire, que comme un outil porteur de significations et de valeurs associées à l’exercice du pouvoir en situation de crise. La recherche du sens qu’a le dépistage pour ceux, pouvoirs publics et parties prenantes, en charge de gérer cette crise épidémique, doit ainsi être interrogée.
Comme l’ont montré des travaux sociologiques récents, la crise de la Covid-19 ne répond pas aux solutions habituelles de gestion publique. La sémantique des « vagues » pourrait signifier une possible submersion des autorités publiques. Dans cette situation, agir sur le sens des événements est pourtant décisif alors que ces mêmes autorités publiques pourraient perdre leur légitimité en étant perçues ou désignées comme passives ou incapables de maîtriser l’épidémie. C’est ici que le dépistage revêt une dimension symbolique. Il permet de maintenir, voire de restaurer, l’image d’un pouvoir qui ne se laisse pas déborder par le virus. Ainsi, appeler et inciter au dépistage massif, c’est aussi afficher publiquement que quelque chose est fait contre l’épidémie et que (re)prendre le contrôle est encore possible.
Pour bon nombre d’entre nous, se faire dépister s’apparente à un rituel de réassurance. C’est aussi le cas pour les organisations publiques comme privées dont l’ordre interne semble menacé par l’épidémie. Pour autant, avons-nous des données ou des publications scientifiques étayées montrant qu’un dépistage massif a déjà permis de limiter la diffusion d’une épidémie ? De même, savons-nous si le dépistage aux frontières ou sur des enfants scolarisés est efficace ? Nous n’avions pas de tests en mars et avril alors que depuis juillet, près de 30 millions ont été réalisés.
Or, après cette seconde vague, certains en annoncent déjà une troisième. Dans les deux expériences de Liverpool et de la Slovaquie, très controversées, ne serait-ce qu’en raison de leur coût exorbitant, les résultats sont mitigés et rien ne permet d’affirmer que ce soit ce mode de dépistage qui ait conduit à une baisse des contaminations.
À l’instar d’autres instruments de mesure, le dépistage donne une représentation du problème qu’il est censé résoudre, une réalité sur laquelle il est possible d’agir tout en en occultant d’autres possibles. Grâce aux résultats des tests, les autorités sanitaires traduisent ainsi l’énigmatique succession de « vagues » en chiffres puis en courbes dont le commentaire des variations quotidiennes permet de signifier publiquement que les pouvoirs publics, les scientifiques et experts gardent une prise sur l’épidémie.
Devenus indicateurs, ces figures statistiques permettent ainsi non seulement de scander le temps de la réponse publique en fonction d’objectifs chiffrés à atteindre mais également de justifier le choix des mesures publiques. En cela, elles s’avèrent, comme les tests qui les rendent possibles, des outils de gouvernement.
Des usages aux usagers. Les limites d’une réponse technico-scientifique
Le dépistage est une procédure technico-scientifique fondée sur les connaissances des sciences occidentales, dont la biologie médicale. En tant que tel, il symbolise une réponse qui se veut à la fois neutre et objective à une pandémie. Pour autant, avons-nous des données sur les différentes raisons pour lesquelles autant de Français se sont fait dépister ? L’ont-ils fait avant ou après avoir développé des symptômes ? L’ont-ils fait parce qu’ils se considèrent ou sont considérés comme cas « contact » ? Pour conjurer la peur ? Parce qu’ils souhaitent protéger des tiers qui présentent plus de risques de développer une forme grave de la Covid-19 ? Parce qu’un employeur a conseillé et organisé ce dépistage ? Combien de fois les mêmes personnes se font tester ? Pourquoi certains s’y refusent-ils ?
Ces questions hantent les problématiques de dépistage mais sont rarement posées dans un débat public saturé par un discours médico-sanitaire qui réduit les individus à leur corps biologique et à des comportements décontextualisés. Tout se passe comme si la nature scientifique et objective des tests conduisait à devoir ainsi ignorer les dimensions subjectives et sociales du recours à ces instruments et des significations qui leur sont conféré(e)s. En l’absence de symptômes et d’offre de soins spécifiques, on peut se demander pourquoi se faire dépister lorsque l’on respecte les gestes de prévention, ce que font largement les Français.
De même, si l’isolement et le traçage des cas contacts se font plus contraignants, accompagnés de possibles sanctions, y compris financières ? Certes, à ce jour, ce durcissement annoncé n’a pas eu lieu. Certains y verront le respect des libertés publiques, d’autres, plus pragmatiques diront qu’il est impossible d’opérationnaliser de telles mesures avec plus de 5 000 cas quotidiens.
Si le résultat d’un test ne confère qu’une illusion de sécurité pour soi et les autres, alors pourquoi se faire dépister ?
D’un point de vue normatif, on peut entendre qu’être contaminé par le SARS-CoV-2 est un danger pour soi et les autres, et que, par conséquent, le dépistage massif et l’isolement sont éthiquement appropriés pour s’en préserver et préserver les autres.
De même, dans le cadre professionnel, défendre la primauté du bien collectif des organisations sur certains droits individuels semble tout aussi défendable. C’est d’ailleurs ce qu’avance la ministre du Travail, Elisabeth Borne, lorsqu’elle justifie le recours aux tests par le besoin « d’assurer la pérennité de l’entreprise », au-delà de l’intérêt moral de leur direction à protéger la santé de leurs salariés.
Apprécier la légalité ou la légitimité du dépistage dans un contexte où l’exceptionnalité des mesures sanitaires est quotidiennement étayée par des discours et des chiffres rappelant la gravité de l’épidémie n’est pas une affaire aisée. Pour autant, comment envisager que des personnes au statut professionnel précaire, en intérim ou travaillant à la journée, puissent se permettre une semaine sans revenu, voire prendre le risque de perdre leur travail en cas de résultat positif ?
À Liverpool, où seuls 4% de la population des quartiers défavorisés s’est portée volontaire, une des principales raisons avancées est l’impact sur le travail. Certains aspects des politiques de dépistage s’avèrent ainsi bien dissuasifs. On peut d’ailleurs se demander si au-delà d’une forme de lassitude et des effets propres au confinement, la baisse importante du nombre de tests réalisés ces dernières semaines n’est pas une réaction compréhensible à des messages de prévention sans prise concrète avec la vie réelle.
Comme de nombreux travaux l’ont montré, la gestion des organisations modernes est essentiellement technocratique. Elle s’enracine dans une idéologie managériale qui veut que la résolution des problèmes publics passe par des solutions scientifiques et techniques.
Tel qu’il est pensé par les pouvoirs publics et utilisé aujourd’hui, le dépistage est parfaitement compatible avec les déclinaisons opérationnelles de cette idéologie que sont la surveillance, le contrôle et la maîtrise. Au-delà de ses aspects instrumentaux, le dépistage semble bien s’avérer un outil de (re)légitimation du pouvoir dans une crise qui n’a jamais été uniquement sanitaire.