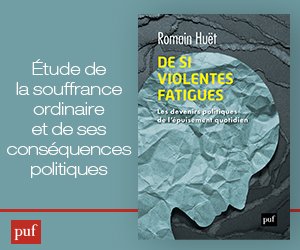En Turquie, les universitaires face au pouvoir
La culture est un champ de bataille qui « n’a pas encore été gagnée », a déclaré à plusieurs reprises le président Recep Tayyip Erdoğan depuis fin 2016, année de la tentative du coup d’État du 15 juillet. L’état d’urgence a donné un blanc-seing juridique pour les milliers de limogeages dans la fonction publique, ainsi que pour la criminalisation et la marginalisation des voix discordantes qui s’expriment depuis les médias et la société civile. À quoi s’ajoutent les universités, terrain brûlant de la « bataille culturelle », et lieu d’émergence des nouvelles formes de résistance dans la Turquie actuelle.
Le lundi 4 janvier 2021, les policiers condamnent les portes de l’Université Boğaziçi (Bosphore) à Istanbul afin de bloquer des centaines d’étudiants qui manifestent contre la nomination par le président de la Turquie – nomination prenant acte le 1er janvier à minuit – d’un universitaire extérieur à l’institution et membre du parti d’Erdoğan, Melih Bulu, comme recteur à la tête de cet établissement prestigieux. Dans la Turquie actuelle, au moment où les mouvements contestataires sont réduits au silence, les enseignants de Boğaziçi se retrouvent régulièrement sur le campus du sud vêtus de leurs toges, et tournent le dos au bureau de M. Bulu.
Le mouvement prend de l’ampleur. En son sein s’expriment conjointement les activistes LGBT, les féministes et les étudiantes voilées. Cette composition, reflétant la diversité culturelle des manifestants, a aussi pour fonction de démentir les campagnes de décrédibilisation menées par le pouvoir et les médias progouvernementaux. Une vague de protestations voit le jour, réprimée par la violence policière, les arrestations des étudiants et les déclarations de M. Erdoğan et de son ministre de l’intérieur Süleyman Soylu accusant les groupes mobilisés d’être des « terroristes », « dépravés » et « antinationaux ». Une rhétorique employée également contre les « universitaires pour la paix ».
La nomination de Melih Bulu à la tête de Boğaziçi en janvier 2021 symbolise la perte de toute marge d’autonomie des universitaires face au pouvoir central en Turquie.
Seule université turque classée parmi les deux cents meilleures universités du monde en 2020, l’Université du Bosphore est redevenue un symbole phare de la lutte contre la tutelle politique sur les libertés académiques. C’est au sein de cette université anglophone que le système de nomination des recteurs par le pouvoir central, établi lors du régime militaire de 1980, fut contesté et contourné en ayant recours à l’organisation d’élections de rectorat informelles par les membres de l’université. Le modèle électoral forgé par les enseignants de Boğaziçi allait être officialisé par le gouvernement de coalition droite-gauche en 1992, remplaçant l’ancien par un système peu démocratique de nomination. La loi modifiée imposait, en effet, un double mécanisme de contrôle sur la nomination de recteurs par vote interne.
En réalité, les universitaires n’avaient autorité que sur la désignation des six candidats. Le Conseil de l’enseignement supérieur réduisait arbitrairement ce nombre à trois et les transmettait au président de la République, qui nommait enfin l’un de ces trois comme recteur des universités publiques. Néanmoins, dès les premières élections officielles, les universitaires de Boğaziçi inventèrent une nouvelle pratique afin d’acquérir leur autonomie administrative : les cinq candidats ayant participé à l’élection rejetèrent la proposition officielle du rectorat en faveur du premier placé par eux. Comme ce fut le cas pour tous les recteurs élus depuis 1992, il s’agissait d’un accord tacite entre la capitale et le Bosphore, jusqu’à ce que le système d’élections intra-universitaires soit aboli le 29 octobre 2016, 93e anniversaire de la fondation de la République, par un décret-loi émis par le Conseil des ministres de l’AKP au moment de l’état d’urgence, qui durera jusqu’en juillet 2018.
Par le décret-loi concerné, le Conseil de l’enseignement supérieur devint la seule autorité à même de désigner les noms des candidats à transmettre au président, sans avoir à consulter les universitaires. Refusant de nommer le recteur élu de Boğaziçi en juillet 2016, Erdoğan désigna ainsi à sa place, au mois de novembre, Mehmed Özkan, un professeur d’université conseiller du recteur précédent et frère d’une députée de l’AKP. Avec ce premier recteur parachuté au mépris du processus électoral interne, il s’agissait d’un jeu de compromis entre les universitaires et le pouvoir.
Au moment où, partout dans le pays, étaient révoqués des universitaires signataires de la pétition « Nous ne serons pas complices de ce crime » – qui demandait l’arrêt des violations des droits de l’homme pendant les opérations militaires dans la région à majorité kurde, et qui fut rendue publique revêtue de plus de deux mille signatures en janvier 2016 –, le nouveau recteur n’eut quant à lui pas recours aux sanctions disciplinaires envers les pétitionnaires à Boğaziçi. Une nouvelle entente vit le jour : la protection de ces derniers en échange de l’autonomie administrative.
En dépit de cet accord, trois pétitionnaires sur cent dix-sept furent révoqués de Boğaziçi aux mois de février et mars 2017 : un par le décret-loi, deux par la non-prolongation de contrats par l’initiative du Conseil de l’enseignement supérieur. En juillet 2018, à la veille de la fin de l’état d’urgence, un des derniers décrets-lois donna toute autorité de nomination de recteurs au président, annulant même la procédure de désignation de candidats par le Conseil de l’enseignement supérieur. La nomination de Melih Bulu à la tête de Boğaziçi en janvier 2021 symbolise donc la perte de toute marge d’autonomie des universitaires face au pouvoir central en Turquie.
Les universitaires pétitionnaires révoqués de leurs universités lors du tournant 2016 et 2017 en avaient déjà fait quant à eux l’amère expérience. Nombre d’entre eux entreprirent dès lors de créer des espaces alternatifs de production académique. À la même période d’état d’urgence, près de 800 signataires étaient poursuivis pour « propagande pour une organisation terroriste » et près de 400 furent révoqués de leurs universités par des décrets-lois. Même si la cour constitutionnelle a rendu en juillet 2019 une décision qualifiant la condamnation des universitaires de « violation de leur liberté d’expression », à ce jour, moins de cent-cinquante universitaires ont repris leurs postes.
En réalité, comme l’ont précisé ses membres, ce groupe s’était formé en novembre 2012, avant même le lancement public du processus de pourparlers de paix entre le gouvernement turc et le parti kurde. Jusqu’en 2016, ils s’étaient engagés autour de cet enjeu soit en organisant des conférences, soit en tant qu’auteurs d’autres pétitions, de rapports et d’éditoriaux traitant du sujet. Mais les réactions violentes contre la publication de la fameuse pétition début 2016 attestèrent que ces interventions ne seraient plus tolérées.
Cette fermeture des possibles découle, d’une part, de la cessation du processus de paix, dont témoignent les luttes armées entre les forces militaires et les guérillas kurdes dans les villes du sud-est de la Turquie au cours de l’été 2015, et, d’autre part, de l’alliance qui s’est formée, parallèlement, entre les dirigeants de l’AKP et le parti ultranationaliste MHP. Au lendemain de la publication de cette pétition, Erdoğan accusa les pétitionnaires, « les soi-disant intellectuels » dit-il, de trahison d’État. Ces déclarations virulentes en faisaient les cibles des groupes et organisations d’extrême droite, ainsi que d’autres citoyens, légitimant le recours à la violence à leur encontre, violences que confirment les enquêtes menées par une dizaine d’universitaires révoqués.
Quant aux universitaires signataires qui travaillent toujours dans les universités turques, ceux-ci déclarent qu’ils s’autocensurent dans leurs activités académiques et qu’ils n’ont plus de « motivation ». Cela se confirme également par une étude comparant le nombre de publications depuis la Turquie dans des revues internationales entre 2016 et 2017 : la diminution globale de la production de publications turques est de 28% dans tous les domaines de recherche, mais la baisse la plus spectaculaire se produit dans les sciences sociales où elle atteint 44%. En ce qui concerne les conséquences de cette campagne de répression auprès des universitaires, leurs témoignages évoquent donc la perte de l’illusio dans leur engagement académique, illusio que Bourdieu définit comme « le fait d’avoir envie d’entrer dans le jeu », perte liée à cette rupture dans leur trajectoire académique.
Il s’agit de faire de la production académique, hors de l’institution officielle, une arme.
En ce qui concerne les universitaires révoqués, qui ne peuvent plus continuer à travailler dans les universités, elles et ils forment des instances alternatives d’enseignement connues sous le nom d’« académies de solidarité » ou d’« académies de rue », au sein desquelles elles et ils poursuivent leurs métiers. Leurs pratiques de résistance sont sous-tendues par une volonté de reconquête de leur autonomie qui se manifeste non seulement par la persistance de ces exclus du champ universitaire à exercer leur activité intellectuelle, mais aussi par le fait qu’ils se dotent de moyens de production et de circulation plus autonomes par rapports aux demandes extérieures dans ces circuits alternatifs.
Il faut aussi prendre en compte l’intégration croissante de ces universitaires aux réseaux de solidarité européens, qui conduit donc à l’émergence et au renforcement d’un champ académique transnational, comme en France via le lancement du programme PAUSE d’aide aux universitaires en danger et en Allemagne à travers le programme équivalent Philipp Schwartz.
La première des académies alternatives, l’Académie de solidarité de Kocaeli (KODA), fondée en fin 2016 par les universitaires limogés de l’Université de Kocaeli, a été officialisée en tant qu’association légale en décembre 2017. KODA diffuse les actes des nombreux ateliers qu’ils organisent depuis l’automne 2016, en complément des séminaires organisés régulièrement sur des questions locales et urbaines telles que la vie artistique et culturelle dans la ville, les travailleurs et la sécurité du travail, la politique locale, la lutte des femmes et la transformation urbaine.
Parmi les ouvrages, L’école des sciences de la vie de l’Académie de solidarité de Kocaeli comme pratique de la résistance, met en évidence l’expérience de l’École des sciences de la vie, maintenue pendant deux ans au sein de l’Académie ; Une vie dans la lutte pour la démocratie et les droits de l’homme : Tahsin Yeşildere a été préparé à partir des séances tenues à l’Atelier d’histoire orale sur la liberté de pensée et d’expression ; et Ville, syndicat et lutte: Union des syndicats de Kocaeli, édité par le groupe d’histoire orale du travail et de l’organisation, se focalise sur le mouvement syndical à Kocaeli, ville industrielle à cent kilomètres d’Istanbul.
Parus en 2020, ces trois ouvrages, qui traitent plutôt de sujets locaux, sont accompagnés de deux articles et d’un recueil, La première longue année de KODA, portant sur l’expérience propre des universitaires à la suite de leurs révocations. Cette publication est à la fois un essai d’auto-histoire et un recueil d’articles tirés des présentations faites par les membres de KODA dans le cadre du programme de séminaires 2016-2017.
Tout comme KODA, l’École d’Eskişehir prend la forme d’une association en octobre 2017 sous le slogan « La science, c’est oser ! ». Au sein de l’École, une quinzaine d’universitaires révoqués des deux universités publiques de la ville, Université d’Anadolu et Université d’Osmangazi, organisent des ateliers sur des thèmes allant de la philosophie du droit, des sciences et de l’histoire, la théorie littéraire, l’analyse critique du discours, jusqu’à la sexualité et la sémantique.
Quant à l’Académie de solidarité d’Ankara (ADA) et au groupe des « sans-campus » d’Istanbul, ceux-ci sont organisés en tant que coopératives formelles : au sein d’ADA, de nombreux ateliers à distance se tiennent dans le cadre de deux programmes : les labour studies et les cultural studies ; alors qu’à Istanbul, les universitaires ne portent pas le programme universitaire en dehors du campus, mais constituent des groupes d’étude pour appliquer les formes alternatives de l’enseignement supérieur tout en évitant la relation hiérarchique entre les enseignants et leurs étudiants.
À Ankara, à Antalya (sud) et à Şanlıurfa (sud-est), des académies de rue se mobilisent sur Facebook afin d’organiser des séminaires publics. Dans la troisième plus grande ville de Turquie, au sein de l’Académie de solidarité d’Izmir, fondée en novembre 2016, les universitaires se concentrent plutôt sur les questions urbaines et de genre, tout en menant des recherches sur leurs propres expériences en dehors de l’académie officielle, actuellement sous le nom d’Association de solidarité et de recherche scientifique d’Izmir.
Enfin, à Mersin, la Maison de la culture Kültürhane, fondée en juin 2017, qui fonctionne à la fois comme un café et comme une bibliothèque publique avec sa collection de cinq mille livres appartenant à des universitaires révoqués qui poursuivent leur vie académique à l’étranger, « classés selon le système de classification de la Bibliothèque du Congrès », devient dès lors le centre culturel le plus animé de la ville.
Au sein de ces réseaux et institutions, les universitaires mettent en place des cours à horaires réguliers, organisent des ateliers, des conférences et des universités d’été, publient des articles selon leurs domaines de recherche. Ils transcrivent également et parallèlement les violations de leurs droits sous la forme de communiqués de presse ou d’enquêtes académiques. Ainsi, il s’agit de faire de la production académique, hors de l’institution officielle, une arme : certains d’entre eux soutiennent que l’« académie de rue est une forme d’action politique », autrement dit une forme de politique par le bas.
Tandis que les « universitaires pour la paix » diffusent leurs déclarations à propos des enjeux actuels sur leur site en turc et en anglais en tant que collectif de solidarité, ceux qui prennent la rue mènent des enquêtes et publient plusieurs rapports détaillés sur le processus de leurs révocations. En témoigne, entre autres, la publication de deux volumes d’enquêtes en novembre 2019 par un groupe d’universitaires révoqués à Izmir.
Le premier, intitulé « L’état d’urgence de l’université : une étude sur la destruction de l’environnement universitaire », évalue, dans un cadre historico-analytique, les réglementations légales de l’académie pendant l’état d’urgence, les pratiques au sein des universités et la transformation du régime politique qui a façonné l’environnement académique. Le deuxième, intitulé « Révocations d’universitaires : violations des droits, pertes, et processus de renforcement », documente les témoignages des universitaires pour la paix en évoquant également les effets des révocations sur eux.
Ces enquêtes, menées dans le cadre du projet « soutenir les universitaires en tant que militants des droits de l’homme dans des conditions difficiles », sont financées par l’Union européenne. Un autre indice de leur transnationalisation. Dans l’introduction du deuxième volume, les chercheurs précisent : « l’équipe de recherche espère que ces rapports seront une résistance par la documentation et en même temps une intervention dans le contexte de la violence politique et de la répression, et souhaite également donner l’espoir de survivre en se renforçant. »
Ces entreprises permettent ainsi de reconstituer une communauté scientifique autonome en marge de l’université et un espace de diffusion de recherches imprégnées de l’esprit critique inhérent à l’ethos des chercheurs dans ces circonstances de violation de la liberté académique et de la liberté d’expression. Son organisation et son maintien reposent sur un mouvement de solidarité et de résistance tant au niveau national que transnational, qu’il est nécessaire de pérenniser.