La « condition toubab »
La notion de « privilège blanc » défraie depuis plusieurs mois la chronique. Mise en exergue par les décoloniaux et fustigée par le Printemps républicain, la droite en général et la gauche universaliste, elle désigne la volonté de la population majoritaire de s’abstraire de toute appartenance à une identité « colorée », cette identité fut-elle « blanche ». C’est ce qu’on nomme l’aveuglement à la couleur (color blindness).
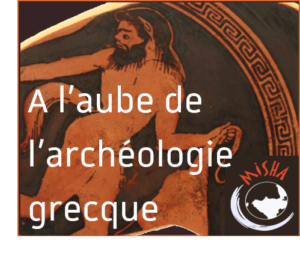
Pour ma part, je ne m’étais, au cours de mon enfance et de mon adolescence, jamais posé la question de ma couleur de peau même si je m’étais interrogé, en raison du fait que j’étais juif, sur ma qualité de Français à part entière ou comme l’on dit désormais de « Français de souche ».
Pendant longtemps, j’ai considéré que je ne faisais pas corps avec la France et que j’étais simplement titulaire d’un passeport français. Ce sentiment de porte-à-faux par rapport à la communauté nationale m’a entraîné vers d’autres cieux et notamment vers ce que l’on appelait à l’époque les « Noirs Américains », le Black Panther Party et Malcolm X, auxquels je me suis identifié dans une sorte de « communauté de souffrance ». Je suis donc devenu un fan de jazz et par ricochet me suis rapidement intéressé à l’Afrique, continent d’origine de ces jazzmen états-uniens, ainsi qu’à la « négritude », notion qui ne laissait pas de m’interroger.
M’étant engagé dans des études d’anthropologie et ayant choisi le Mali comme terrain d’enquête, je suis arrivé à Bamako en 1967 en tant que Volontaire du Service National, comme l’on disait à l’époque, et j’ai été affecté à l’Institut des Sciences Humaines.
Je me suis alors rendu rapidement dans le Wasolon, région méridionale du pays, que j’avais entrepris d’étudier, et là j’ai expérimenté pour la première fois la « condition toubab ». En effet, à chaque fois que j’arrivais dans un village, des groupes d’enfants m’accueillaient au cri de « tubabu, tubabu, tubabu ». Il ne s’agissait pas de leur part d’une quelconque hostilité mais plutôt d’une joyeuse surprise de voir arriver un exemplaire étrange d’un groupe humain qu’ils avaient rarement l’occasion d’observer. En effet, à cette époque, peu d’Européens résidaient au Mali et encore plus rares étant ceux qui se rendaient dans cette région reculée.
J’étais donc enfermé dans une étiquette globale, celle de tubabu, et par là je perdais mon identité individuelle en tant que personne singulière.
Qu’en est-il de cette catégorie de « toubab » (tubabu en bambara) dont j’étais affublée à mon corps défendant et dont l’étymologie a fait couler beaucoup d’encre ? Maurice Delafosse (1870-1926), l’ethnologue-administrateur colonial qui a arpenté l’Afrique de l’Ouest, s’est efforcé d’en donner, sans emporter totalement la conviction, un sens originaire, mais quoi qu’il en soit ce terme, malgré sa proximité orthographique, n’a rien à voir avec celui de « toubib », terme d’origine arabe et qui désignait autrefois chez nous, selon une tournure argotique ou familière, le médecin.
Le terme tubabu ne se réfère pas aux étrangers blancs dans leur ensemble, mais uniquement aux étrangers blancs européens. Les Arabes et les Maures sont désignés par le terme suraka (de l’arabe sur qui signifie « Syrie ») alors que les Libanais sont nommés pour leur part surakanin (petits Maures ou petits Arabes). Ce terme revêt même une acception culturelle puisque des Africains européanisés se voient affublés du terme dépréciatif de farafin tubabu, littéralement « tubabu à peau noire ».
J’étais donc enfermé dans une étiquette globale, celle de tubabu, et par là je perdais mon identité individuelle en tant que personne singulière dotée d’un prénom et d’un nom de famille. Je me voyais ainsi renvoyé à un groupe dont précisément j’entendais me distinguer puisque je m’identifiais fortement à l’Afrique, au Mali et à leurs habitants. Victime de la condition juive, je m’étais réfugié dans la « condition noire » et je me trouvai finalement rejeté dans la « condition toubab ».
La profération de ce terme tubabu par ces enfants ne témoignait en aucun cas d’un quelconque « racisme anti-blanc » qui aurait été l’exact symétrique d’un racisme anti-noir. Je ne faisais, bien entendu, l’objet d’aucune discrimination puisque j’étais dans la position dominante d’un anthropologue en mission officielle débarquant dans leurs villages pour observer les pratiques de leurs familles. Ils étaient donc dans une position de dominés et exprimaient ce sentiment de domination en adoptant une posture englobante liée à leur incapacité d’accéder à l’individualité de cet étranger blanc européen.
Ne pas être pris pour ce que l’on est mais pour ce que l’on représente est toujours désagréable, mais il faut replacer cette expérience dans le cadre de la situation, en l’occurrence postcoloniale, qui était celle de ma venue dans cette région en tant qu’anthropologue.
Bien que n’ayant à voir ni de loin, ni de près avec une période coloniale qui n’était pas si éloignée, l’indépendance du Mali n’étant survenue que quelques années auparavant, j’étais perçu, en raison des enquêtes que je menais sur les différents lignages de cette région, comme l’instrument du rétablissement de la chefferie de canton, autrefois courroie de transmission de l’administration coloniale.
Il est d’ailleurs difficile de dire si l’intention qui m’était prêtée était perçue négativement ou positivement mais, quoi qu’il en soit, ma présence s’inscrivait pleinement dans le cadre d’un rapport de pouvoir instauré par les différentes autorités (fangaw) qui s’étaient succédé dans cette région. De sorte qu’il était difficile pour ses habitants de dissocier mes activités d’ordre anthropologique des multiples contraintes étatiques que subissaient les paysans, que celles-ci concernent le paiement de l’impôt, les investissements humains ou la réquisition des récoltes.
Les racisés ne demandent qu’une chose : d’être traités comme des atomes républicains.
La « condition toubab » telle que je l’ai expérimentée à l’époque signale donc en creux la perte de privilège que subit l’étranger européen blanc lorsqu’il n’est plus en situation majoritaire, situation assez rare en France où certains peuvent néanmoins se faire occasionnellement traiter de « toubab », ou en verlan de « babtou ».
L’invisibilité du Blanc est donc liée à une position majoritaire, dominante, dans le cadre de laquelle peut s’exprimer une posture universaliste énoncée indépendamment de ses conditions d’énonciation et faisant ainsi l’objet de la vindicte postcoloniale. En effet, la preuve par l’inverse est donnée par les Noirs et les Arabes qui lorsqu’ils sont désignés, insultés ou maltraités en tant que tels perdent toute individualité. Le contrôle au faciès, le refoulement à l’entrée d’une boîte de nuit ou à l’embauche ne portent pas sur une infraction présumée ou sur la teneur d’un curriculum vitae mais bel et bien sur la couleur de la peau ou sur la nature d’un prénom ou d’un nom.
L’identité d’un individu quelconque est donc renvoyée à sa race et à ce titre il est déresponsabilisé en tant que tel, son comportement devenant purement et simplement indexé à un groupe. C’est bien ce processus de racisation auquel se réfèrent les postcoloniaux, le « racisé » n’existant plus par lui-même mais devenant simplement le représentant ou le porte-drapeau d’une « communauté », la partie valant pour le tout.
L’exclusion dont fait l’objet le porte-drapeau d’un groupe peut certes être retournée sous la forme de la revendication de réunions « non-mixtes » qui provoquent à leur tour l’ire des républicains universalistes. Mais ce qui est pointé par les partisans de ces réunions « non-mixtes », c’est précisément la non-mixité qui prévaut dans la société française. « Traitez-nous comme des individus à part entière et nous cesserons de nous revendiquer en tant que groupe spécifique », semblent-ils leur (nous) dire. Car les racisés ne demandent qu’une seule chose, c’est d’être traités comme des atomes républicains. Le communautarisme, dont ils sont accusés, n’est que celui dont ils sont victimes. « Encore un effort, Français, si vous voulez que nous devenions républicains » pourraient-ils, en paraphrasant Sade, jeter à la tête des majoritaires.
La situation de racisé telle qu’elle s’applique aux Noirs et aux Arabes peut sans doute être transférée également aux juifs, qui bien que ne faisant pas l’objet du même rejet que les deux premiers groupes, perdent néanmoins toute individualité lorsqu’ils se voient insultés.
Au cours de mes séjours au Mali, j’ai toujours été englobé dans la catégorie de tubabu et n’ai jamais subi une forme quelconque d’antisémitisme qui aurait pu être par exemple liée à mon patronyme. L’antisémitisme n’existe pas au Mali, ne serait-ce que parce que les Maliens ignorent tout des juifs. Ce n’est que dans certains milieux musulmans que la question peut se poser. Il m’est ainsi arrivé d’être interrogé sur mon appartenance religieuse. En général, pour éviter tout problème, plutôt que de dire que je suis athée, ce qui me caractérise, je préfère répondre que je suis chrétien. Mais une seule fois, il m’est arrivé de répondre à des islamistes que j’étais juif et j’ai immédiatement ressenti un malaise chez mes interlocuteurs.
Dans ce milieu en effet, le partage ne se fait pas tant entre ceux qui sont « toubab » et ceux qui ne le sont pas qu’entre ceux qui appartiennent à l’oumma et les autres, le fait d’être juif pouvant être associé comme ailleurs dans le monde musulman au conflit israélo-palestinien. On voit donc que l’assignation à la condition toubab est une affaire d’échelle : tous les étrangers européens blancs ne sont pas rangés dans la même case.
La couleur de la peau et l’origine géographique ne sont pas seules à intervenir dans la définition de l’identité, la religion entre également en ligne de compte. C’est dans cette voie que s’est engagée l’ex-otage Sophie Pétronin en se convertissant à l’islam pour faire corps avec la société malienne, sans que l’on sache si sa conversion a eu quelque chose à voir avec le fait que sa vie ait été épargnée par ses ravisseurs.
