Prisons : autopsie contradictoire de la dissolution du Genepi
L’émotion suscitée par la dissolution début août du Genepi tient avant tout à la place qu’a eue l’association dans le parcours de dizaines de milliers d’étudiantes et d’étudiants, l’auteur de ces lignes inclus[1]. Depuis 1976 et jusqu’à la suspension des actions en détention de l’association, ils ont été jusqu’à 1300 chaque année à entrer chaque semaine en prison pour y rencontrer des personnes détenues autour d’un soutien scolaire ou d’activités culturelles. Ces activités à l’intérieur des prisons se complétaient d’une formation interne particulièrement riche aux enjeux de l’enfermement et d’actions de sensibilisations de publics divers, notamment scolaires.
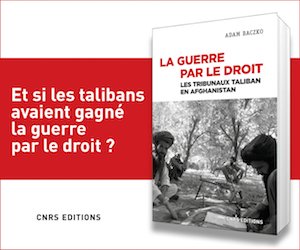
Comment une association fondée par un secrétaire d’Etat de Valéry Giscard d’Estaing, rassemblant initialement une poignée d’étudiants de Polytechnique et de HEC, en est-elle venue à être la plus grosse association étudiante de France, puis à devenir un petit collectif anticarcéral non-mixte dénonçant le patriarcat, le racisme et le classisme de l’institution pénitentiaire ? À quelques exceptions près, la couverture médiatique a largement vilipendé les rédactrices du communiqué de dissolution, les accusant d’entrisme, les ralliant au nouvel épouvantail de la « woke culture ». La dissolution du Genepi serait le résultat d’un coup d’État interne, entièrement imputable à quelques militantes radicalisées.
Ce récit escamote pourtant une évolution de plusieurs décennies, portée par des générations de membres de l’association en regard des transformations de son partenaire historique, l’administration pénitentiaire. La disparation du Genepi apparaît alors moins comme un coup de tonnerre que comme un révélateur d’évolutions de fond aussi bien du monde militant sur les questions carcérales que des politiques pénitentiaires.
Le Genepi, une exception française
Il n’existe pas d’équivalent dans le monde à ce que fut le Genepi. Une association nationale et exclusivement étudiante, forte à la fin des années 2000 de près de 1300 membres et intervenant sur tout le territoire ou presque. Des liens entre l’université et la prison existent dans plusieurs pays, mais prennent ordinairement la forme de programmes locaux, portés par le corps professoral, auquel les étudiants ne participent qu’à titre de tuteurs et dans le cadre de leurs études.
Cette exception française s’explique par un contexte particulier de création, que rappelle à juste titre le communiqué de dissolution. Au milieu des années 1970, des révoltes éclatent dans plusieurs prisons françaises. Les images de prisonniers sur les toits interpellent le public, alors que de nouveaux groupes militants – à commencer par le Groupe d’information sur les prisons de Michel Foucault – portent une critique forte de la prison. Soucieux de préserver son image modernisatrice, le président Giscard d’Estaing, nouvellement élu, affirme une volonté de réforme.
C’est dans ce contexte que Lionel Stoléru, alors secrétaire d’Etat chargé de « la condition des travailleurs manuels », crée le Genepi. L’acronyme fait écho au nom d’une fleur de montagne, moins connue que l’alcool auquel elle a donné son nom. Il a fallu son poids politique et le soutien de l’Elysée pour que voie le jour ce projet ambitieux à une époque où l’administration pénitentiaire est encore loin d’ouvrir ses portes à des intervenants aussi divers qu’aujourd’hui. Ancien polytechnicien, c’est d’abord aux étudiants de cette école et à leurs voisins d’HEC qu’il s’adresse.
Rapidement, le Genepi essaime sur tout le territoire national et ses bénévoles se diversifient. Se renouvelant à près de 80% tous les ans, l’association touche un nombre très important d’étudiantes et d’étudiants. Elle marque les trajectoires de celles et ceux qui quelques années plus tard entrent dans des professions liées au droit pénal et à la prison, mais aussi qui suivent une route professionnelle éloignée de la prison tout en y restant attentifs et sensibles.
Le Genepi est en cela un centre de diffusion des connaissances et des réflexions sur la prison. S’y croisent des professionnels, des témoins, des experts invités lors des weekends qui rythment l’année. Outre le soutien de son fondateur, l’association peut compter sur le soutien de personnalités, à commencer par celui Robert Badinter qui en fut longtemps membre d’honneur.
Fort de cette histoire, fort de son action, fort de ses anciens, le Genepi est ainsi devenu au tournant du XXIe siècle un acteur central des politiques pénitentiaires. Ses responsables sont systématiquement auditionnés dans le cadre des travaux parlementaires. Ils sont associés aux travaux préparatoires de la loi pénitentiaire de 2009. L’association occupe alors une place centrale dans les collectifs d’association œuvrant en milieu carcéral.
Cette présentation trop rapide ce qu’a représenté le Genepi dans le paysage associatif n’a pas pour but d’alimenter le sentiment de gâchis qui a gagné la plupart des commentaires à l’annonce de la dissolution. Elle invite à comprendre quelles dynamiques ont pu y conduire.
Partenaires ou prestataires ? Des étudiants face à l’administration pénitentiaire
Il importe de rappeler que si le Genepi s’est dissout de sa propre initiative, son évolution, elle, s’est faite en miroir de celle de son partenaire historique, l’administration pénitentiaire. Aux termes de conventions pluriannuelles, celle-ci accordait aux membres de l’association l’autorisation de pénétrer dans les établissements pénitentiaires et subventionnait en partie son fonctionnement. Les contreparties de cette autorisation et de cette subvention ont rapidement été la source de tensions. Que peut exiger l’administration en échange de la subvention qu’elle accorde à une association indépendante, composée d’étudiantes et d’étudiants bénévoles ?
La dernière fois que l’association a eu les honneurs de la presse, c’était en 2018 lorsque la direction de l’administration pénitentiaire (DAP) avait refusé de renouveler la convention pluriannuelle la liant au Genepi, arguant principalement d’une baisse importante du nombre d’heures des activités en détention, mais visant également les prises des positions publiques de plus en plus critiques à son égard. La force des réseaux et le capital de sympathie dont pouvait encore se targuer l’association avaient alors permis de faire revenir la DAP sur sa décision.
Pourtant, quelques mois plus tard, c’est l’association elle-même qui votait en assemblée générale la fin de ses activités en détention, signant à court terme la fonte de ses effectifs et la redéfinition politique de son action. Tout comme la dissolution, cette passe d’armes décisive s’inscrit dans près de deux décennies de dégradation du partenariat historique qui liait le Genepi et l’administration pénitentiaire. Dégradation progressive, nullement linéaire et encore moins irrésistible.
À l’origine de cette dégradation, on trouve la transformation de la gestion publique notamment marquée notamment par la Loi organique sur les lois de finances (LOLF) en 2001, puis par la Révision générale des politiques publiques en 2007. Le principe est simple : une bonne gestion des deniers publics se doit d’associer chaque euro dépensé à des indicateurs chiffrés, eux-mêmes liés à des objectifs des politiques publiques. Pour l’administration pénitentiaire, les subventions accordées à des associations doivent obéir à la même logique : si l’association reçoit de l’argent, elle doit participer à un objectif de politique publique.
Le partenariat avec le Genepi ne semblait pas devoir souffrir de cette obligation. L’association avait fait en 1976 son objet social de sa volonté de « collaborer à l’effort public en faveur de la réinsertion des personnes incarcérées ». Reste à savoir comment cette participation se mesure et se contrôle. Au fil des années et des conventions, l’administration pénitentiaire a imposé les normes de la nouvelle gestion publique. L’association devait justifier du nombre d’heures d’activité qu’elle dispense, du nombre de personnes détenues touchées, de la part de soutiens scolaires par rapport aux activités culturelles, etc.
Rapidement, les indicateurs descriptifs deviennent prescriptifs, cherchant à imposer leur action aux bénévoles. Le partenariat prend de plus en plus la forme d’une délégation de service public. Par exemple, l’administration pénitentiaire ne voit pas d’un bon œil les activités collectives qu’organise le Genepi. Ce qui compte – au sens le plus gestionnaire du terme – ce sont les diplômes préparés et, si possible, réussis par les personnes détenues. L’administration impose donc au Genepi que le ratio soutien scolaire/activités culturelles doit se rééquilibre en faveur des premiers. Certains établissements décident même d’interdire purement et simplement les secondes.
Auprès des étudiants bénévoles du Genepi, ces objectifs passent mal. Ils contredisent la volonté affichée depuis au moins 1983[2] de ne pas se substituer à une Éducation nationale en effectifs insuffisants en prison et celle, plus récente, de considérer que le contenu des activités compte moins que la rencontre qu’elles rendent possible. Face à ce rouleau compresseur, le Genepi négocie, obtient des concessions. Dans une prise de position votée en assemblée générale en 2011, il est ainsi écrit : « Le Genepi souhaite rappeler que son projet associatif n’a pas pour vocation de développer des actions afin de pallier le manque de moyen des pouvoirs publics. […] En ce sens, si son projet propre peut présenter certains points de rencontre avec les missions ou les dispositifs des services publics, il ne saurait ni accepter de voir ses actions s’y réduire ni de voir son action comptabilisée dans le cadre de l’évaluation de ces politiques[3] ». La même année, l’association décide de réduire d’elle-même la subvention demandée à l’administration pénitentiaire pour réduire sa dépendance.
Les sujets de blocage se multiplient pourtant. En 2009, la loi dite « pénitentiaire » instaure une obligation d’activité pour les personnes détenues. L’article 27 de la loi dispose que « toute personne condamnée est tenue d’exercer au moins l’une des activités qui lui est proposée par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dès lors qu’elle a pour finalité la réinsertion de l’intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité ».
Affirmant l’indépendance de son action vis-à-vis de la peine, le Genepi demande à l’administration pénitentiaire la garantie qu’aucune de ses activités ne sera comptabilisée dans ce cadre. L’administration tergiverse et refuse de s’engager, poussant le Genepi à mettre pour la première fois dans la balance, par un vote de son assemblée générale, l’arrêt complet de ses interventions.
Un an plus tard, le Genepi change son objet social. Face au risque de se voir phagocyter par une administration de plus en plus donneuse d’ordre, il s’agit de définir de manière indépendante son projet associatif. L’objet de l’association devient alors le « décloisonnement des institutions carcérales », insistant sur la « circulation des savoirs » que permet son action en détention, la formation de ses membres et la sensibilisation de publics divers.
La dissolution de l’association interroge la possibilité de la subvention publique d’un projet associatif indépendant qui ne prenne pas la forme de l’achat d’une prestation à moindre coût.
Il serait vain de retracer ici les nombreuses confrontations qui ont marqué le partenariat entre le Genepi et la direction de l’administration pénitentiaire ces dernières années, notamment marquées par la mise en cause de la prison dans les parcours de radicalisation de terroristes islamistes et la volonté de développer des programmes de prévention de ces dérives[4]. Les termes des désaccords restent les mêmes : une association qui affirme son indépendance critique et une administration qui cherche à l’intégrer à son action.
En 2017, le Genepi adopte ce qu’il nomme des « limites basses » qui doivent conditionner ses actions en détention : absence de dispositif d’écoute dans ses ateliers ainsi que de tout membre du personnel pénitentiaire, refus de l’obligation de rapporter à l’administration les comportements des personnes détenues pendant les ateliers, absence de fouille à nu des personnes détenues avant ou après les ateliers, etc.[5] C’est considérant que ces limites ne seraient pas respectées et face à la volonté de l’administration pénitentiaire de n’autoriser dorénavant que le soutien scolaire que le Genepi a décidé, en 2019, de mettre un terme à ses activités en détention.
La fin des activités en détention s’inscrit donc dans une histoire longue. Évoquée dès 2010 face au risque de voir les activités des bénévoles participer à l’administration des peines, elle revient périodiquement face aux multiples injonctions de l’administration à participer à ses missions, notamment sécuritaires. Ici, la fin du Genepi raconte une histoire pénitentiaire plus large. La dissolution de l’association interroge en effet la possibilité de la subvention publique d’un projet associatif indépendant qui ne prenne pas la forme de l’achat d’une prestation à moindre coût. Quelle place peut alors avoir la société civile dans les institutions et auprès des publics dont l’Etat a la charge[6] ?
Le renouveau d’une critique radicale de la prison
Une dernière dimension des tensions entre le Genepi et l’administration mérite l’attention. Elle réside dans la parole publique que l’association tenait sur la prison. Le ton virulent du communiqué de dissolution[7] a occasionné des commentaires sur le dévoiement d’une association d’enseignement en prison qui en venait à tenir un discours de critique de l’enfermement pénal.
Le Genepi, en tant qu’association, n’a pourtant pas longtemps caché ses velléités critiques vis-à-vis de la prison. Dès 1981, cinq ans après sa création, la première prise de position de l’association critique la loi « Sécurité et liberté » récemment adoptée et dénonce « la situation du milieu carcéral qui ne fabrique aujourd’hui que des laissés-pour-compte[8] ». Depuis quarante ans, ces prises de position se multiplient, s’affinent et se répondent.
Cette continuité ne doit cependant pas cacher les lignes de ruptures dans le contenu de ces prises de position. Disponibles en ligne[9], elles ouvrent une fenêtre sur les évolutions de la manière dont l’association a pensé et critiqué la prison. Celles-ci tiennent bien sûr aux dynamiques propres de l’association. Cependant, les étudiantes et étudiants du Genepi lisent, écoutent, participent à d’autres mobilisations. L’évolution des prises de position votées par l’association informe ainsi également sur les reconfigurations du paysage militant, sur la question pénitentiaire et plus largement. En cela, le communiqué de dissolution invite à penser la renaissance actuelle d’une critique radicale de la prison qui s’appuie, d’une part, sur l’expérience de la répression policière et judiciaire de mouvements sociaux récents et, d’autre part, sur une dénonciation intersectionnelle des inégalités qui structurent notre société. À la rencontre de ces deux mouvements, une série d’indices invitent à penser ces dernières années comment un nouveau moment de politisation de la prison.
Ceux-ci n’ont pas été si nombreux au cours du XXe et du XXIe siècles. Après l’engouement des réformes pénitentiaires de la fin du XIXe siècle, les prisons sombrent dans l’oubli des politiques. C’est le « temps de l’indifférence », pour reprendre l’expression de Robert Badinter dans son histoire de la prison républicaine[10]. Il faut attendre la Libération et l’arrivée au pouvoir de personnalités qui ont connu l’enfermement pendant l’Occupation pour que la prison fasse de nouveau l’objet d’une attention réformatrice.
La critique de la prison est ensuite marquée par deux moments majeurs. On a déjà évoqué les années 1970, ainsi que les révoltes carcérales et la politisation de la prison par divers groupes et personnalités de gauche dont elles ont été marquées. Dans une perspective de critique des modes d’exercice du pouvoir, ces mobilisations ont notamment mis l’accent sur l’impossibilité pour les prisonnières et les prisonniers de s’exprimer, de porter des revendications et de faire entendre des plaintes. Le Groupe d’information sur les prisons conduit par Michel Foucault adopte un mot d’ordre éloquent : « La parole aux prisonniers ! ». Là encore, l’incarcération de militants de gauche n’est pas étrangère à cette redécouverte critique de la prison.
Vient ensuite le début des années 2000 où la prison se retrouve sur le devant de la scène politico-médiatique suite à la publication remarquée du livre de la médecin-cheffe de la prison de La Santé[11]. Cette politisation se focalise sur l’inhumanité des conditions de détention imposées aux personnes détenues. Un rapport parlementaire s’intitule de manière éloquente : « Prisons : une humiliation pour la République »[12].
Le communiqué de dissolution de l’association s’inscrit […] dans un renouveau de la pensée critique de la prison qui se concentre en réalité davantage sur la justice pénale que sur la prison elle-même
Présentes, la revendication démocratique et la dénonciation de l’indignité des conditions de détention sont peu centrales dans la politisation de la prison que porte le communiqué de dissolution du Genepi. C’est au principe même de l’incarcération qu’est porté l’essentiel des coups. Cette critique radicale de la prison a récemment retrouvé une place dans la matrice des revendications sociales, se nourrissant tout d’abord de la répression policière et judiciaire de mouvements sociaux de grande ampleur (manifestations contre la Loi Travail, mouvement des Gilets Jaunes, etc.). La police, la justice pénale et la prison deviennent des sujets de discussion au sein de cortèges et d’assemblées rassemblant des personnes diverses, souvent peu sensibilisées à ces questions. Tout comme par le passé, l’incarcération de militantes et de militants très éloignés socialement de l’expérience carcérale a rendu la prison visible. Comme dans les années 1970, la prison semble ainsi gagnée par la « proliférante criticabilité des choses[13] » qui gagne les contestations sociales.
Ce renouveau se nourrit également d’une approche intersectionnelle des inégalités et des dominations. La triple critique que le communiqué de dissolution adresse à la prison – patriarcale, classiste et raciste – laisse peu de doutes sur ce point. La dénonciation du rôle de la prison dans la validation et la fabrication de ces inégalités sociales n’a rien de nouveau pour le Genepi, encore moins pour les travaux académiques qui les documentent de longue date. Ce qui change ici, c’est la matrice intellectuelle qui structure cette dénonciation et la centralité qu’y occupe l’antiracisme et le féminisme.
On retrouve les échos des revendications de baisse des budgets voire d’absolution de la police et de prison à la suite du meurtre raciste, en mai 2020, d’un homme noir, Georges Flyod, par un policier blanc aux Etats-Unis. On y retrouve aussi le renouveau récent d’un féminisme anticarcéral, qui dénonce notamment l’instrumentalisation des violences faites aux femmes pour alimenter un système pénal inégalitaire. L’historien Jean Bérard avait documenté le déclin de ce courant de pensée au cours des années 1970[14]. Le livre Pour elles toutes de Gwenola Ricordeau[15], publié en 2019, a de ce point de vue largement contribué à réintégrer la question pénitentiaire à la pensée féministe.
Loin d’être le produit de l’action isolée de quelques militantes, le communiqué de dissolution de l’association s’inscrit ainsi dans un renouveau de la pensée critique de la prison qui se concentre en réalité davantage sur la justice pénale que sur la prison elle-même. Le cœur des critiques porte sur des flux et sur les inégalités qui les structurent. Essentielle, une telle approche porte néanmoins le risque de perdre de vue ce qui se passe en prison, se privant de la possibilité d’en proposer une critique fine et compréhensive.
Ces deux dynamiques, partenariale et idéologique, sont bien évidemment liées. Les prises de positions de plus en plus critiques du Genepi ont durci les relations avec l’administration pénitentiaire ; tandis que la dégradation du partenariat a poussé les membres de l’association à réinventer le sens de leur action. Au-delà de l’émotion causée par la dissolution du Genepi, ces dynamiques donnent à comprendre les nouveaux rapports de forces et les nouveaux affrontements idéologiques qui structurent le champ pénitentiaire. Si le Genepi n’y a pas survécu, reste à savoir le type de militantisme qui peut naître de cette critique radicale et surplombante de la prison. Quels pourront être ces « autres moyens de luttes réellement féministes et anticarcéraux » que le communiqué de dissolution appelle de ses vœux ?
