Voter pour rien : une vieille histoire
Genève, 1707. Au terme de cinq mois de crise politique, les citoyens de la petite république obtiennent l’introduction d’une « loge » ou isoloir dans les élections, peut-être son utilisation la plus ancienne dans une assemblée populaire, et l’instauration d’assemblées périodiques pour délibérer ensemble des lois tous les cinq ans, dans un esprit de démocratie directe. Comment cet épisode historique quasiment inconnu en France et remontant à une époque plus souvent associée chez nous à l’absolutisme louis-quatorzien qu’aux expériences républicaines peut-il faire écho aujourd’hui dans notre pays, à la veille de l’élection présidentielle ? Comment le détour par l’histoire ancienne du vote, renouvelée récemment par plusieurs études[1], peut-il permettre de faire un pas de côté, de regarder sous un angle un peu différent nos pratiques actuelles ?
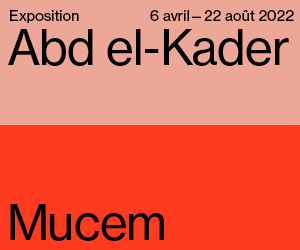
Elle peut d’abord nous rappeler combien une protection comme l’isoloir est précieuse, alors que nous avons désormais tendance à l’oublier tant elle nous paraît évidente et naturelle. Dans la République de Genève, le vote obéissait à des principes opposés à notre modèle actuel du vote secret permettant le choix libre et indépendant d’un citoyen-individu. Il devait au contraire inciter à la déférence et toute l’organisation matérielle du vote dans le temple de Saint-Pierre, où avaient lieu les élections, y contribuait, reflétant la hiérarchie sociale et politique dans la République.
Portant la robe longue, les 28 membres du Petit Conseil, qui occupaient leur charge à vie et se cooptaient parmi les grandes familles de la République, dont ils constituaient le gouvernement de facto, siégeaient sur des gradins dans le chœur face aux bourgeois et citoyens réunis en Conseil général. Ces derniers, qui représentaient un tiers de la population masculine adulte, constituaient le peuple au sens politique du populus pourvu de droits, avec une diversité sociale en leur sein, des riches marchands aux artisans modestes des bas métiers urbains du cuir ou du textile en passant par l’élite des maîtres-artisans de la Fabrique, dans l’horlogerie ou l’orfèvrerie. Ils s’asseyaient sur les « bancs communs », dans la nef du temple, qui a un plan en croix latine puisque c’est l’ancienne cathédrale de la ville.
Les représentants de l’Église s’asseyaient quant à eux dans le transept, à la fois derrière et en face de la chaire du pasteur ; tandis que les membres du Conseil des Deux-Cents, l’antichambre du Petit Conseil, occupaient probablement les bancs de devant. Cette répartition des places, qui donnait lieu parfois à des conflits de préséances typiques de sociétés d’Ancien-Régime obsédées par le respect du rang, déterminait l’ordre de vote : d’abord les membres du Petit Conseil, comme lors de la Cène pour aller à la communion, puis les pasteurs, les membres du Conseil des Deux-Cents, et enfin les citoyens ordinaires, « banc par banc », chacun retournant ensuite à sa place pour attendre la fin de l’élection, qui durait environ 4 heures en tout.
Ces élections ressemblaient le plus souvent à des « hommages collectifs » rendus par le peuple à ses magistrats, et pouvaient donner l’impression que les citoyens genevois « votaient pour rien ».
Quand ils allaient voter, les citoyens passaient devant les gradins où siégeait le Petit Conseil, prêtaient serment sur la Bible et se dirigeaient ensuite vers trois secrétaires, exprimant leur suffrage à leur oreille (on parle de vote « auriculaire »). Ils devaient choisir « ceux qui sont idoines », comme leur avait expliqué le pasteur appelé à prononcer une exhortation au début de l’assemblée, et comme ils en avaient fait le serment.
Il s’agissait en fait pour eux de choisir parmi des candidats à certaines magistratures qui devaient nécessairement être pris au sein du Petit Conseil (syndic, lieutenant, trésorier général) ou du Conseils des Deux-Cents (procureur général, auditeurs), lors d’élections qui avaient lieu deux fois par an, en janvier et en novembre. On n’était donc pas ici dans un système représentatif puisque ces deux assemblées étaient cooptées, le rôle des citoyens n’étant que de « retenir » en dernier lieu les titulaires de ces charges à partir d’une liste qu’on leur proposait de candidats classés selon leur rang.
Dans la très grande majorité des cas, ils reconduisaient les sortants, qui revenaient périodiquement en charge après des périodes d’inéligibilité imposées. Par exemple, les postes des quatre syndics, qui étaient les premiers magistrats de la République, furent pourvus 116 fois (4 fois 29) entre 1679 et 1707. Par 95 fois, les citoyens reconduisirent les syndics sortants (ceux qui étaient en charge 4 ans auparavant et « revenaient en élection »). Par 21 fois, ils élurent des conseillers sur un poste de syndic devenu vacant, dont 13 fois des candidats nominés dans les quatre premiers de la liste proposée par les Conseils, et 8 fois des candidats nominés en position d’outsiders, entre la cinquième et la huitième position dans la liste.
Ces élections ressemblaient donc le plus souvent à des « hommages collectifs » rendus par le peuple à ses magistrats, et pouvaient donner l’impression que les citoyens genevois « votaient pour rien », même si des grains de sable se glissaient parfois dans ces rouages bien huilés, par exemple quand ils menaçaient de faire « sauter les vieux », c’est-à-dire de ne pas reconduire les sortants.
C’est ce fonctionnement qu’ils contestèrent lors de la crise de 1707, la première des « révolutions genevoises » du XVIIIe siècle[2], dénonçant dans un mémoire bourgeois la pratique du vote auriculaire, qui les mettait sous pression. La présence des syndics sortants sur les gradins « devant l’endroit où l’on donne son suffrage » intimidait les votants qui étaient « frappés par leur présence », malgré un rideau qui était tendu devant eux afin de les cacher. Les électeurs n’osaient pas alors « suivre les sentiments de leur conscience », et, plutôt que de donner leur suffrage à ceux « dont ils ont fait le choix dans leurs âmes », ils les donnaient aux parents des syndics. Ils risquaient alors le parjure, puisqu’ils avaient fait le serment d’élire « ceux qui sont propres et idoines », et c’est le salut de leur âme qui était ainsi remis en question.
Le comportement des trois secrétaires recevant les voix était aussi dénoncé. Ces derniers tentaient d’intimider les électeurs en les regardant au moment du vote « pour les connaître », faisaient mine d’avoir mal entendu pour leur faire répéter tout haut le nom d’un candidat, « ce qui les gênait », dissimulaient de la main les noms de certains candidats sur les cartons où ils recueillaient les votes etc. Les citoyens réclamèrent donc l’introduction du vote par billet et d’une « loge » ou isoloir, dans laquelle ils pourraient réfléchir librement à leur choix et prendre le temps de « rentrer en eux-mêmes » afin de prendre la bonne décision. Cette pratique, qui fut instaurée au terme de la crise, était alors très nouvelle pour une assemblée populaire, bien qu’alors plus commune dans les assemblées patriciennes.
Cette histoire genevoise est celle d’un modèle alternatif de démocratie directe mis en avant par les citoyens révoltés, qui peut encore nous interroger aujourd’hui.
Comme l’écrivit Montesquieu un peu plus tard, elle était censée convenir aux assemblées restreintes et « sages », alors que « lorsque le peuple donne ses suffrages, ils doivent être publics » car il faut que « le petit peuple soit éclairé par les principaux, et contenu par la gravité de certains personnages »[3]. Si les romains avaient voté de manière secrète à partir des lois dites « tabellaires » au moyen de tablettes de cire et les citoyens des communes italiennes médiévales ou de la république de Venise au moyen de petites balles de lin ou « ballotes », ils ne se réfugiaient pas pour ce faire dans cette « cachette » que représentait pour les genevois la « loge », bien avant les premiers projets de ce type, jamais mis en pratique, sous la Révolution française, et l’expérience habituellement considérée comme fondatrice pour les pays occidentaux de l’Australian ballot en 1856[4].
Des différences majeures demeuraient néanmoins avec notre modèle actuel du vote secret, puisque l’organisation de l’espace dans le temple et le rituel électoral restaient inchangés, continuant de donner aux élites politiques et sociales de la République un poids majeur dans l’élection. Au contraire, notre modèle actuel du vote secret assure une double protection, « d’abord dans les rapports entre l’électeur et son environnement social, puis dans l’interaction établie entre les votants et les membres du bureau de vote », l’espace de vote étant conçu comme « un espace neutralisant les appartenances sociales et favorisant l’isolement de l’acte électoral du tissu des activités sociales quotidiennes »[5].
Il ne faut donc pas sous-estimer les libertés politiques dont nous jouissons aujourd’hui, qui apparaissent en creux dans cette vieille histoire : vote secret, suffrage universel, gouvernement représentatif, qui fut longtemps un espoir des genevois et qu’ils n’obtinrent qu’à la fin du XVIIIe siècle[6], droit de constituer des partis politiques qui étaient alors assimilés à des factions œuvrant contre le bien commun.
Ce petit épisode genevois serait-il alors un exemple de plus du combat pour ces libertés durement acquises au fil de l’histoire, dont nous jouissons aujourd’hui comme des enfants ingrats, qui devraient être conscients de leur chance plutôt que de protester ? Sûrement pas. D’abord, parce que si aucun politiste sérieux ne proposerait de renoncer totalement au système représentatif, son application en pratique est très loin d’être parfaite : manque de représentativité sociologique des élus par rapport à la population, faible niveau de confiance dans le personnel politique, abstention et non-inscription sur les listes électorales etc[7].
Ensuite parce que cette histoire genevoise est aussi celle d’un modèle alternatif de démocratie directe mis en avant par les citoyens révoltés, qui peut encore nous interroger aujourd’hui. Le chef de file de la contestation est un patricien en rupture de ban, Pierre Fatio, qui finit fusillé. Il porte la critique à un haut niveau d’élaboration intellectuelle, se livrant devant le Conseil général à de longues joutes verbales avec le syndic et philosophe Jean-Robert Chouet, et s’appuyant sur de grands auteurs de l’époque comme Pufendorf. Il élabore des projets hardis visant à restaurer en pratique la souveraineté jusque-là toute théorique du Conseil général, comme des Conseils généraux annuels pour délibérer des lois, qui nous font penser aux assemblées périodiques du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau (1762), ou une procédure permettant à 50 citoyens de faire convoquer le Conseil général pour examiner un projet, dans l’esprit des initiatives populaires qui existent aujourd’hui en Suisse.
Il est entouré d’artisans plus ou moins modestes, les principaux meneurs étant des maîtres-artisans appartenant à l’élite de la Fabrique, notamment dans l’horlogerie, alors que les foules qui s’assemblent lors des grands rassemblements sur les places publiques ont une composition plus plébéienne[8]. Ces artisans savent eux aussi manier des concepts politiques comme celui de souveraineté du Conseil général, dans un vocabulaire très différent et souvent très imagé. Le maître-tailleur François Delachana la justifie ainsi par la sagesse du plus grand nombre puisque selon lui tout le bon sens ne réside pas dans le Petit Conseil, mais qu’« il y en a parmi le peuple, qui ne le cède à personne, étant à présumer que le bon sens est dans le plus grand nombre et par conséquent dans le Conseil suprême [le Conseil général] ».
Il est donc bien permis « aux mains de redresser la tête quand elle penche », et les magistrats ne doivent être que les « commis et économes » du peuple, ils ne sont que « Messieurs les sous-arcboutants de nos affaires ». Sous la pression, le gouvernement doit organiser trois Conseils généraux délibératifs en mai 1707, qui constituent une expérience concrète de la délibération collective, même si celle-ci reste mise en œuvre dans le cadre d’une société d’Ancien-Régime – on prend la parole selon son rang, les syndics ont le privilège d’ouvrir et de clôturer les débats. Le gouvernement accorde finalement quelques concessions : vote par billet et isoloir, limitation des liens de parenté au sein des Petit et Grand Conseils, publication des Édits de la République de Genève, qui n’avaient pas été publiés depuis 1568 alors qu’ils étaient considérés (à tort) comme une sorte de constitution.
Mais les propositions les plus radicales sont rejetées d’un revers de main (l’idée que 50 citoyens puissent faire convoquer le Conseil général pour un vote serait « d’une dangereuse conséquence »), ou accordées de manière provisoire pour être très vite abandonnées : des Conseils généraux délibératifs quinquennaux sont instaurés, mais un seul est tenu en 1712 pour voter leur suppression définitive, pour des motifs que Rousseau qualifie d’« absurdités palpables ».
L’importance qu’un Pierre Fatio accordait à la démocratie directe en 1707 peut néanmoins nous inciter à regarder autrement notre propre époque et notre propre pays où ce type de démocratie est peu développée et reste historiquement assimilée à la tradition plébiscitaire. On pourrait alléguer que Fatio ne concevait cette démocratie que dans le cadre limité de la bourgeoisie, dont le droit de vote était un privilège, dans la logique d’une société de corps. Ou que, même si l’on reconnaît que le modèle qu’il proposait au sein de la bourgeoisie était très démocratique, ce type de participation directe des citoyens à l’élaboration des lois n’est possible qu’à l’échelle réduite de la cité-État, la seule à permettre matériellement l’assemblée de tout le peuple en un même lieu.
Mais plusieurs expériences historiques ont depuis invalidé ce vieil argument. Pendant la Révolution française, en 1793, Condorcet conçut dans son Exposition des principes et des motifs du plan de Constitution (1793) un système sophistiqué permettant des procédures de démocratie directe à l’échelle de toute la France.
On ne saurait verser dans un optimisme béat et voir la démocratie directe comme une panacée ou une forme de démocratie pure qui aurait vocation à remplacer la démocratie représentative.
Ce projet trop souvent oublié reposait sur des assemblées primaires comptant 400 à 900 citoyens au niveau du village ou d’une petite région, et qui en constituaient la cellule de base. La procédure était la même pour proposer une nouvelle loi, demander qu’une loi soit soumise à un nouvel examen, ou demander un changement dans la Constitution et partait toujours « d’en bas ». Condorcet s’inscrivait ainsi en faux face à la division du travail politique prônée par Sieyès et qui s’était imposée dans la Constitution de 1791 : on ne pouvait se contenter d’une démocratie qui serait purement représentative, où le seul contrôle du peuple sur ses représentants se limiterait à la possibilité de ne pas les réélire et aux bornes fixées par une Constitution qu’il ne pouvait pas lui-même réviser.
De même, la Suisse a développé au cours du XIXe siècle des procédures de démocratie directe à l’échelon municipal, cantonal aussi bien que fédéral, moyennant quelques variantes, la plus connue étant l’initiative populaire, qui permet au niveau fédéral une modification de la Constitution si 100 000 signatures au moins sont recueillies et si elle obtient la majorité des voix et des 26 cantons lors d’une votation populaire (dans le cas d’un projet de loi rédigé). C’est le cas aussi de nombreux États américains, dont 49 connaissent le référendum constitutionnel obligatoire, 21 l’initiative populaire sous différentes formes et 38 le référendum révocatoire ou recall.
Enfin, la mise en œuvre récente dans plusieurs États d’assemblées tirées au sort représente une dernière manière pour les citoyens d’un pays de s’exprimer directement sur les lois sans avoir à s’assembler tous en un même lieu comme à l’époque de Pierre Fatio. Citons parmi d’autres les expériences islandaise (2010-2012), irlandaise (2012-2016), et française avec la Convention citoyenne pour le climat (2019-2020).
Ces exemples suscitent des espoirs, tout en incitant à la nuance. En Suisse, le parti ultranationaliste et conservateur de l’UDC (Union Démocratique du Centre), qui se présente comme le champion de la démocratie directe, fut à l’origine des initiatives populaires couronnées de succès contre l’interdiction des minarets (2009), pour l’expulsion des criminels étrangers (2010) ou contre l’ « immigration de masse » (2014). Aux États-Unis, le recall est parfois cyniquement instrumentalisé par les partis d’opposition dans des stratégies de reconquête du pouvoir. Dans notre propre pays, Éric Zemmour prévoit de recourir au référendum afin de contourner une très probable censure du Conseil constitutionnel sur nombre de ses projets de réformes.
Les assemblées tirées au sort ont souvent déçu, que ce soit en Islande en raison d’un blocage post-référendum par le nouveau gouvernement, ou en France avec le détricotage progressif des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. On ne saurait donc verser dans un optimisme béat et voir la démocratie directe comme une panacée ou une forme de démocratie pure qui aurait vocation à remplacer la démocratie représentative. Elles sont plutôt complémentaires et l’on parle d’ailleurs en Suisse de démocratie « semi-directe ». Néanmoins, certains exemples sont encourageants, comme ceux de la Convention constitutionnelle et de l’Assemblée citoyenne en Irlande, deux assemblées de citoyens tirées au sort qui ont vu largement adoptées par référendum certaines de leurs recommandations comme la légalisation du mariage homosexuel (2015) ou le droit à l’avortement (2018) dans un pays pourtant ancré dans une forte tradition catholique.
Il semble que de tels processus peuvent en effet permettre à des gouvernements de mettre au cœur du débat public des questions qu’ils n’auraient pas osé porter par la seule voie parlementaire parce que trop polémiques et risquant d’obérer leurs chances de réélection, ces assemblées citoyennes permettant aussi de réfléchir aux principaux arguments du débat avant de soumettre la question à un référendum. La bonne santé d’une démocratie dépend de multiples facteurs, qui tiennent aussi aux mobilisations et à l’évolution des rapports de force au sein de la société, à la répartition de la richesse, à la liberté et à la qualité de l’information, au niveau d’éducation etc., et il ne faut donc pas verser dans un fétichisme de la procédure. Mais ces dispositifs, bien mieux connus en d’autres pays et qui prolongent une généalogie ancienne et largement ignorée chez nous de la démocratie directe, pourrait permettre au moins d’un peu « démocratiser la démocratie »[9].
NDLR : Raphaël Barat a publié en janvier 2022 Voter pour rien chez Payot.
