La société des scélérats
« Je m’avance vers celui qui me contredit. »
Montaigne
Dans cet article, nous allons analyser les ramifications de l’incapacité à dialoguer, qui est bien le problème des problèmes auquel nous sommes confrontés dans nos sociétés développées, puisque, par définition, aucune résolution collective des problèmes ne peut s’amorcer sans mettre en présence les épineux partenaires des dits problèmes.
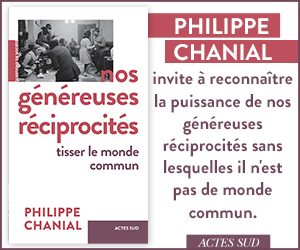
Le dialogue impossible
Aux États-Unis, lors de l’assaut du Capitole, des gens meurent à balles réelles dans l’enceinte du parlement. Depuis deux décennies, le fossé ne cesse de s’approfondir entre les Bleus (les Démocrates) et les Rouges (les Républicains). Cependant, le fil du dialogue des différences n’y est pas rompu : une association, Braver Angels, organise des débats entre les partisans des deux camps sur des questions clivantes.
Une sociologue de Berkeley, Arlie Russell Hochschild, appelle, dans Strangers in their own land, à « escalader le mur de l’empathie » pour comprendre les « sentiments profonds » des électeurs de la droite américaine. De gauche, progressiste, elle montre l’exemple d’un dialogue qui part en quête, qui écoute, qui se laisse affecter par la vie de l’autre, de droite – et elle découvre des raisons qui font, par exemple, que des ouvriers d’industries polluantes de Louisiane, mourant de maladies professionnelles, votent quand même contre les règlements environnementaux de l’État fédéral.
Et en France, où en sommes-nous ? Chez nous, pas de morts au Parlement, mais la pratique du dialogue y est peut-être encore plus dévastée qu’outre-Atlantique. La trumpisation des esprits est bien là. Elle surfe sur des stratégies de clivage pour capter des suiveurs, prendre le pouvoir ou le conserver. Trump en a rendu explicite la méthode dès les années 1980 dans un bestseller : « la controverse aidait à maintenir une présence dans les médias », écrivait-il.
Arnaud Benedetti (dans Le Figaro, le 5 janvier 2022) en arrive à parler d’un « trumpisme des élites » à propos d’un Président qui admet, selon ses propres termes, vouloir « emmerder » une partie des Français. Et pour illustrer que, bien sûr, c’est toujours l’autre qui clive, le garde des Sceaux, Dupond-Moretti, partisan du Président, dit regretter qu’« on [ait] besoin, dans cette société, de démolir [les autres] » (France Info, le 17 février 2022).
Presque plus personne ne conteste désormais l’extinction de la valeur du débat. Un chiffre absolument sidérant en témoigne : 91 % de la population française reconnaît qu’« il n’est plus possible de débattre sans que cela ne tourne aux dialogues de sourds, voire à l’affrontement[1] ».
Semer la controverse crée l’événement et soude les groupes. Sur les plateaux télé, il y a plus à gagner à mettre de l’huile sur le feu. La dramatisation attire l’attention. Quant aux réseaux sociaux, ils participent à la diffusion effrénée des messages qui se distinguent par leur brutalité, jusqu’à préférer la fausseté du moment qu’elle assure le spectacle (ce qu’on appelle les fake news).
Le délitement du débat public renforce la non-rencontre des différences : la présence de quelques Gilets Jaunes à la télévision n’a pas fait long feu, comme si seule une contestation sur de nombreux ronds-points et des violences lors de manifestations pouvaient enclencher l’invitation adressée aux milieux populaires de s’exprimer dans des talk shows.
À la poursuite de la conversation disparue
Montaigne a de très belles pages sur le goût de conférer (converser) entre personnes ayant de fortes divergences. À les relire, on ne peut que ressentir, aujourd’hui, un sursaut d’étrangeté. Dialoguer dans l’écart est à des années-lumières de nos pratiques et théories. Il écrit, entre autres passages d’anthologie :
« Quand on me contrarie, on éveille mon attention, non pas ma colère ; je m’avance vers celui qui me contredit, qui m’instruit » (p. 888 dans l’édition de La Pléiade de 1930).
Et cette rature : « Les amitiés ne me semblent assez vigoureuses et généreuses si elles ne sont querelleuses » (indiquée en note de bas de page).
Symptomatique de l’absence du dialogue comme thème d’intérêt, la riche étude de l’Institut Montaigne qui vient de paraître sur les jeunes. Sur un large panel de questions (qu’il convient de saluer), il n’y en a aucune qui pointe de manière centrale vers le thème du dialogue, de la discussion, du débat, de la conversation : quelle est la position des « jeunes », de leurs « parents » et des grands-parents « baby boomers » (les trois populations sondées) sur cet enjeu crucial en démocratie ? Le deuil de la confrontation d’idées pour se faire une opinion éclairée, pour évoluer dans ses positionnements, pour construire un lien politique, est-il consommé ? Jusqu’à en éliminer la rubrique dans la liste des questions structurantes ?
Prenons un point, parmi d’autres, qui ressort de cette étude et mériterait conversation. Le mot « wokisme » apparaît en introduction et dès la première phrase de la 4e de couverture. Il est poussé sur le devant de la scène. Pourtant, aucune question n’a été posée sur le sujet. Le « wokisme » y est défini comme un identitarisme (« jouant sur un registre identitaire », p. 55). Mais là encore, aucune question ne porte sur le phénomène (idéologique) d’identitarisme, éventuellement assimilable à du wokisme.
Comment, alors, comprendre que le wokisme arrive en tête des commentaires ? L’interprétation qui vient à l’esprit est qu’un sujet fortement clivant, comme l’est le wokisme dans l’actualité, attire l’attention des lecteurs.
Parmi les « points à retenir », p. 90, nous lisons : « Ils [les jeunes] ne sont pas massivement gagnés par le “wokisme”, ils sont très clivés sur le sujet, mais la plupart adoptent des positions modérées (choisissant les modalités “plutôt” que les modalités “très”, favorables ou défavorables) », ou encore « Les jeunes les plus convaincus par l’idée du “racisme structurel” (11 %) et les plus convaincus de l’importance des questions de genre (28 %) sont une minorité ».
Cependant, un autre chiffre peut être retenu, celui de la p. 48 : « 48 % d’entre eux [les jeunes] sont d’accord (tout à fait ou plutôt) avec l’idée que la France est et demeurera une société raciste du fait de son passé colonial », qui relativise le message de la p. 90.
Il semblerait que la montée en visibilité du thème du wokisme serve surtout de phare pour attirer l’attention vers un sujet brûlant ; puis, que les analyses minimisent l’enjeu en mettant l’accent sur un chiffre plutôt que sur un autre.
En résumé : la valeur dialogue n’intéresse pas ; en revanche, la controverse attire ; mais la peur d’un débat difficile conduit à ne pas trop insister sur les divergences. Venez voir, mais circulez, il n’y a pas grand-chose à voir.
L’alternative serait de se mettre en enquête en demandant : que pensez-vous, en général, de la valeur du dialogue dans nos sociétés ? Comment percevez-vous la pratique du dialogue dans nos sociétés ? Plus précisément, quelle est votre attitude face à tel problème ? Et une fois le problème mis sur la table : quel est votre degré d’ouverture au dialogue sur cette question ?
L’étude semble plus étayée sur la fragilité du discours intersectionniste ou de convergence des sentiments de discrimination (cf. p. 98, les questions de « race » et de « genre » qui n’apparaissent pas « superposables »). Mais l’intersectionnalisme ne résume pas le wokisme.
L’universalisme de dialogue
Un tableau figure p. 44 qui peut être lu comme faisant ressortir une forte sensibilité des « jeunes » à des questions sociales et sociétale. Sujets prioritaires pour une large majorité d’entre eux : les violences faites aux femmes (77 %), le racisme (67 %), le terrorisme (66 %), la faim dans le monde (65 %), l’écologie (62 %), les inégalités (62 %), les violences entre jeunes (55 %).
La sensibilité à ces questions pourrait s’interpréter, sans aucune polémique, comme une position d’éveil – traduction du verbe « wake », réveiller. La sensibilité serait un mot pour dire « l’attention à », « la concentration sur ». « Être woke » reviendrait à « donner du sens à », sans se réduire ni à une sensiblerie, ni à une catégorie surplombante intitulée wokisme.
Cette sensibilité n’est pas toute et automatiquement aspirée par des approches identitaristes (cela que le mot « wokisme » prend habituellement pour cible) mais peut tout autant (ou avec des ambiguïtés, des évolutions, des ouvertures, une place pour le dialogue, bref, une complexité et une conversation possible) relever d’un universalisme.
Cette interprétation des résultats de l’étude de l’Institut Montaigne – encore une fois très fouillée – laisserait à penser que les universalistes ne devraient pas trop vite s’enquiller dans des stratégies de clivage, mais plutôt s’adresser, dans une perspective dialogique, à ces « jeunes » qui accordent un sens vif, digne d’attention politique, aux questions évoquées. Sans, donc, voir le « wokisme » partout, tout de suite et sans examen plus attentif.
Il en résulterait une dédramatisation autour de l’enjeu du « wokisme » – ce que relève l’étude à sa façon, en mettant l’accent sur un chiffre plutôt que sur un autre – mais qui pourrait se poursuivre par la voie d’un universalisme de dialogue. Un universalisme qui ne camouflerait pas les divergences mais n’en fermerait pas pour autant la porte du dialogue. Qui chercherait, donc, plutôt à inclure la critique pour des approches à construire par l’échange de paroles. Ce qu’il y aurait alors à éviter serait les jugements à l’emporte-pièce, de quelque camp qu’ils viennent.
Enfin, toujours dans le tableau de la p. 44 de l’étude, une catégorie fusionne les « questions de religion et de laïcité ». Cette hybridation de deux thèmes assez différents en une seule question ne permet guère de distinguer, parmi les positions en circulation dans l’espace public et les mentalités, un identitarisme de principe et un universalisme de société laïque, et encore moins un repli communautaire et un universalisme de dialogue.
Un processus-clé de résolution collective des problèmes
Une société où une quasi-unanimité de citoyens et d’experts se rejoignent pour considérer tout débat impossible est structurellement mal préparée pour affronter les difficultés réelles qui se posent aujourd’hui à l’humanité. Ces problèmes sont systémiques, complexes et globaux – qu’il s’agisse du CO2 recraché dans l’atmosphère, de la chute des populations d’animaux, de la destruction des forêts et du plancton, du plastique et des pesticides dans l’eau, la terre et l’air, de l’épuisement des énergies fossiles, de l’exploitation des terres rares, de la place du travail humain, des inégalités et violences… Mais la conséquence n’en est pas tirée : nul dans son coin ne détient la clé des solutions à bâtir.
Pour construire les solutions et les mettre en œuvre, le dialogue des différences n’est plus optionnel, il est obligatoire, il devrait devenir une procédure régulière (un « due process » en anglais) entre les experts, les politiques, les entreprises et les populations.
La proposition se décline à plusieurs niveaux : tout d’abord, il s’agirait d’engager plus de citoyens dans le dialogue des différences : l’exercice renforce le lien social, entraîne à se forger une opinion par la discussion, construit un terrain commun. Cela peut avoir lieu dans des réunions et à l’école, mais devrait aussi se développer sur les médias en invitant plus souvent les citoyens à participer, pour que soit rendu sensible un effort partagé – et pourquoi pas un plaisir ? – à se mettre au dialogue.
En second lieu, il conviendrait de développer le dialogue entre des sphères tellement spécialisées qu’elles n’ont pas le même langage et ne se rencontrent jamais. À un moment, les expressions des décideurs, des experts, des scientifiques et des citoyens doivent se croiser, s’écouter, se répondre, se transformer mutuellement. L’inclusivité signifie ici que tout le monde est bienvenu avec son langage et ses intérêts, et pas seulement pour consultation, mais pour de vrais dialogues où les points de vue s’articulent. De telles rencontres, y compris sur les médias, permettrait d’engager une large partie de la population à se frotter au dialogue.
Enfin, il y a le domaine du dialogue des décideurs entre eux : entre les experts entre eux, entre les disciplines scientifiques entre elles, entre les échelons politiques de représentation, au sein des organisations… Les marges de progrès sont immenses pour intensifier le dialogue, vital pour la construction des solutions collectives. Les décideurs entre eux (experts entre eux, disciplines entre elles…) composent, dans leur ensemble, une mosaïque au sein de l’élite. Tous, d’une petite ou grande influence, ont, au premier chef, à montrer l’exemple, et, eux aussi, à s’exercer au dialogue.
Se mettre au dialogue, se frotter au dialogue, s’exercer au dialogue, et pas juste au côte à côte de prises de parole, les unes après les autres, et encore moins à l’anathème, au mépris ou à l’insulte. Au dialogue, c’est-à-dire à la franche explication, qui n’a pas peur des écarts, qui met les problèmes sur la table, mais crée les conditions d’une articulation entre les positions auprès du plus grand nombre.
Rien ne changera dans la société sans un travail de la relation autour d’enjeux transverses, sans une élaboration d’un terrain commun entre les champs d’expertise et avec les citoyens – ce qui avait pu transparaître dans les propos d’Emmanuel Macron quand il déclara « on ne fait rien bouger si on ne respecte pas assez les gens » (interview du 15 décembre 2021 sur TF1).
L’urgence pour la résolution des problèmes actuels n’est pas tant de courir après de nouvelles expertises : il y en a plein en circulation ; ni d’entraîner à pousser toujours plus loin ses positions : nos sociétés sont efficaces pour former à se vendre soi et promouvoir son groupe d’appartenance, à entreprendre, déployer des techniques et communiquer.
J’étudie la structure de ces comportements de réussite dans Le nouvel héroïsme (Presses des Mines, 2022), à partir d’un terrain de centaines de manuels de management, de développement personnel, de publicités, de portraits dans la presse et de films de fiction. Il en ressort une palette de compétences où il faut savoir de montrer très investi intérieurement, très à l’aise dans les jeux sociaux, très centré sur une zone d’excellence, capable de sortir des sentiers battus, très affûté en négociation et résistant dans le rapport de force.
L’urgence est plutôt à la mise en relation des compétences qui sont déjà là partout, dans tous les domaines, anciennes, présentes et en gestation. C’est le propre de l’époque actuelle d’être saturée de capacités dans les sciences, dans les technologies, dans les organisations, dans les administrations, mais de ne pas savoir les faire se rencontrer et dialoguer. Or, le dialogue entre experts de différents horizons ne se porte guère mieux que les dialogues dans l’espace public.
La société des scélérats
Qu’il me soit permis, ici, de raconter une anecdote qui me fournit le titre de cet article. Elle est significative de l’état du dialogue dans nos sociétés de controverses.
Pour répondre au manque de dialogue, nous avons monté avec Cyrille Bombard, à l’automne 2020, en plein confinement sanitaire, un protocole de dialogue sur sujets clivants que nous avons nommé ZigZagZoom. À début mars 2022, nous aurons organisé dix-neuf rencontres – la moitié d’entre elles en sessions citoyennes, l’autre moitié dans le cadre de cours délivrés à Telecom Paris/Institut Polytechnique de Paris.
Pour élargir le champ de l’expérimentation, j’ai été tenté, à un moment, de monter un groupe de dialogue avec des experts sur des questions où ils divergent. À cette fin, j’ai écrit à un militant écologiste médiatique, ultra-diplômé, directeur de laboratoire tout ce qu’il y a de plus haut perché, pour lui proposer, loin des caméras, dans un cadre de recherche, de mener un dialogue avec une personne avec qui il n’est pas d’accord.
Je lui soumets une liste, au choix, il n’avait qu’à piocher : un entrepreneur dans les technologies NBIC, un géologue spécialiste de l’enfouissement des déchets nucléaires, un industriel de droite, un exploitant de terres rares, un économiste libéral pariant sur la croissance pour sortir des crises, un ingénieur comptant sur l’innovation technologique pour résoudre les problèmes de la planète. Il refuse.
Il me donne d’abord une raison qui ne tient pas. Il m’écrit qu’il est « en retrait médiatique radical », alors que je l’ai découvert dans une vidéo Youtube fléchée par tous les réseaux, pour une conférence publique, devant un parterre prestigieux, datée de quelques semaines auparavant ; de surcroît, rien dans mon dispositif n’impose une diffusion publique. Il m’explique ensuite qu’il est « très opposé à ces faux débats qui tournent à la bataille de clash », alors que je lui propose précisément d’explorer d’autres voies, plus dialogiques.
Il me dit enfin, troisième raison, que « sous couvert de donner la parole à tout le monde, on fait de la publicité aux scélérats ». Voilà la raison qui l’emporte : l’autre est le scélérat. On ne va pas s’abaisser à le rencontrer. Ce serait lui faire trop d’honneur. On ne dialogue pas avec l’innommable. On ne dialogue pas avec le démon. C’est la raison pour laquelle, quand on vante le dialogue, on se retrouve vite face à l’argument des accords de Munich, pour ne pas dire le point Godwin : on ne dialogue pas avec Hitler.
Que dire face à cet argument ? Rien sur le principe. On ne peut qu’abonder. Simplement, la question délicate est de savoir quand, en 2022 (et pas rétrospectivement en 1938), rompre le dialogue ; quand et comment décider que le « scélérat », l’« innommable », le « démon » est à nos portes et que dialoguer avec lui est une traîtrise. La question est délicate car rompre le dialogue trop tôt revient à faire monter aux extrêmes l’escalade de la violence et à bloquer toute résolution collective des problèmes. Il vaut mieux ne pas se tromper sur le moment de la rupture, car rompre le dialogue trop tôt revient à entériner la logique de guerre – qui n’était peut-être pas encore là, à un tel degré de gravité, avec la sommation de choisir son camp de manière binaire.
Face aux problèmes intriqués qui sont ceux de l’humanité actuelle, il n’est pas sûr qu’il y ait d’autre voie que de mettre tout le monde autour de la table – tous épineux partenaires des problèmes – à moins, bien sûr, de verser vers la guerre, voie toujours ouverte. Se prépare-t-elle ? C’est possible. Mais alors, il faut bien reconnaître que l’ennemi est plus à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Il faut bien constater que le parallèle avec Hitler ne tient pas, puisque les « scélérats », pour l’écologiste médiatique que j’ai approché, ne sont pas tant chinois, russes, états-uniens ou turcs, ce sont des « scélérats » de l’intérieur. Et ça fait beaucoup de scélérats à bannir du dialogue : entrepreneurs dans les technologies, géologues réfléchissant au traitement des déchets nucléaires, industriels de droite, exploitants de minerais, économistes vantant la croissance. Tous infréquentables ? Tous indignes d’un dialogue ?
Tous scélérats sauf moi ?
Voilà bien l’héroïcomanie de nos sociétés hypermodernes que je diagnostique dans Le nouvel héroïsme. À force d’armer l’ego pour qu’il soit en supériorité pour réussir, autonome, en visibilité sur les réseaux, accédant au pouvoir et à l’argent, comblé de reconnaissance, il en vient à céder à une forme d’ivresse autocentrée et à ne plus se valoriser qu’au détriment des autres. Il y a là une logique dont on voit bien le versant positif – l’individuation par où l’humain se détermine existentiellement. Cependant, poussée à l’extrême, elle finit par accoucher de systèmes bloqués, inadaptés au réel, non résilients, faisant toujours plus du même, précipitant plus sûrement contre le mur à pleine volée. « L’héroïsme pour tous, figure du capitalisme tardif » débouche sur un monde où – pour reprendre les termes prémonitoires de Marcel Gauchet, prononcés il y a vingt-cinq ans – « les gens sont destinés à se supporter très mal les uns les autres » (« Essai de psychologie contemporaine », Le Débat, n° 99, 1998, p. 180).
Cette manière paranoïaque de voir des scélérats partout fait partie du problème. Refuser de rencontrer l’autre fait partie du problème, car, d’une part, cela empêche d’analyser collectivement les difficultés, le réel, les blocages, le vécu des acteurs sur le terrain qui vivent les problèmes, et d’autre part, cela donne une image désastreuse de la démocratie qui n’apparaît plus alors que comme la chambre d’enregistrement de rapports de force qui se jouent ailleurs que dans l’espace commun et autrement que par l’échange de paroles.
S’éteignent, alors, d’un coup, les capacités pragmatiques de résolution des problèmes et l’idéal démocratique. Ce qui déprime dans ces refus de dialogue, c’est que la guerre et les luttes de pouvoir s’installent comme horizon indépassable, alors même que, dans nos sociétés riches, relativement pacifiées, on pourrait imaginer ne pas avoir encore franchi l’infranchissable – le point Munich ou Godwin.
Dans les décennies à venir, il y aura peut-être un procès qui s’ouvrira, qui ne portera pas que sur l’inaction face au réchauffement climatique ou à la chute de la biodiversité, mais aussi sur l’inexplicable incapacité à coopérer dans des sociétés qui, pourtant, se singularisent pas leur richesse globale : comment la guerre aura-t-elle gagné l’ADN de chaque individu le rendant incapable d’entrer en relation avec la différence ? Et comment, face aux périls comme le réchauffement climatique et la chute de la biodiversité, il ne fut pas possible de se mettre autour de la terre pour en conférer et agir de concert ?
