Les océans au service de Prométhée
Avec l’inauguration prochaine du parc de Saint-Nazaire (480 MW), l’éolien en mer va sortir en France du registre de l’abstrait, de l’inconnu, en devenant une réalité technologique et paysagère bien concrète. Plus de vingt ans auront été nécessaires (un premier appel d’offres fut lancé en 2004 portant sur une puissance installée de 500 MW sur l’ensemble des façades maritimes) pour voir s’élever une forêt d’éoliennes sur le littoral métropolitain. Au moment où la Commission européenne annonce un ambitieux programme pour faire de la mer du Nord « la centrale électrique verte » du continent (l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique se sont engagés à installer 150 GW d’éoliennes offshore d’ici 2050), la France compte elle aussi sur une accélération des projets (avec l’objectif d’atteindre 40 GW d’éolien marin d’ici 2050) pour viser la neutralité carbone, tout en répondant aux enjeux de souveraineté énergétique attisés par le conflit russo-ukrainien. Le développement de l’éolien offshore s’inscrit dans un processus historique de marinisation généralisée des technologies de l’énergie, avec un attrait pour la mer qui gagnerait à être expliqué.
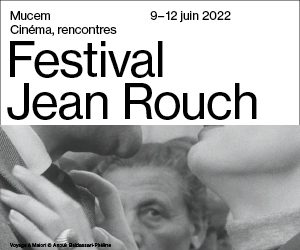
La marinisation du système technique des énergies fossiles
Comprendre l’intérêt pour l’éolien offshore nécessite de replacer cette technologie dans un phénomène historique plus vaste de marinisation de notre système énergétique.
L’océan n’est pas seulement mis à contribution pour le transport du pétrole et du gaz naturel entre pays producteurs et pays consommateurs (les combustibles fossiles et leurs dérivés représentent aujourd’hui à eux seuls 40 % des cargaisons maritimes). L’extraction des matières minérales sous l’eau existe depuis longtemps. Le risque de pénurie des combustibles fossiles terrestres (charbon, pétrole et gaz) hante les esprits des experts et des gouvernements depuis le XIXe siècle. Pensons ici à l’ouvrage The Coal Question (1865) de l’économiste et logicien britannique William Stanley Jevons qui préfigure l’analyse économique des ressources naturelles non renouvelables et la peur du déclin national.
Dans son ouvrage récent La civilisation du charbon : en Angleterre, du règne de Victoria à la Seconde Guerre mondiale (2021), l’historien Charles François-Mathis souligne que la peur de l’épuisement futur des réserves de charbon a poussé les ingénieurs britanniques à explorer des gisements de plus en plus profonds, dans des environnements de plus en plus hostiles. L’extraction des mines de Whitehaven situées en mer d’Irlande, dans le nord-ouest de l’Angleterre, sont ainsi décrites dès 1774 par Gabriel Jars dans ses Voyages métallurgiques. En associant le rôle providentiel du charbon pour l’économie européenne avec un monde océanique fantasmé par la technologie, Jules Verne imagine dans son roman Vingt Mille Lieues sous les mers (1869) des « houillères sous-marines » au milieu de l’Atlantique, où le charbon extrait alimente grassement en électricité le Nautilus, figure du progrès scientifique.
Exploiter les ressources pétrolières offshore est une réalité tout aussi ancienne, les premiers forages marins côtiers ayant été effectués en 1896 en Californie, à partir d’appontements en bois reliés au rivage. La première découverte en zone lagunaire a lieu en 1924 dans le lac Maracaibo, dans l’ouest du Venezuela. On trouve ensuite du pétrole en mer Caspienne. Une nouvelle étape est franchie à partir de 1947 dans le golfe du Mexique, puis dans le golfe Persique. Il s’agit alors d’une simple transposition des techniques employées à terre. La découverte en 1958 du gisement de gaz de Groningue dans le nord des Pays-Bas (un des plus importants gisements connus dans le monde à l’époque) lance les campagnes d’exploration des hydrocarbures dans toute la zone offshore au large des côtes hollandaises et anglaises, puis s’étendent vers le nord. Le Royaume-Uni raffine pour la première fois du pétrole le 18 juin 1975 et Aberdeen devient la capitale européenne portuaire du pétrole offshore.
La demande toujours plus forte de pétrole, portée par l’avènement de la société de consommation, oblige l’emploi de technologies de plus en plus sophistiquées pour l’exploiter, en utilisant des innovations propres au milieu marin (engin flottant avec une tête de puits sous-marine). D’abord sur le plateau continental où la profondeur ne dépasse pas les 250 mètres environ, les prospections et exploitations se font à partir des années 1970 sur le talus continental, sur cette pente qui descend vers les plaines abyssales entre 3 000 et 5 000 mètres de profondeur.
La production de pétrole offshore en mer profonde (plus de 300 mètres) est lancée en 1979 avec le champ de Cognac. La profondeur de 1 000 mètres est franchie au Brésil en 1994 (champ de Marlin Sud), puis les 2 000 mètres en 2002 dans le golfe du Mexique (projet Canyon Express dans le champ Aconcagua). En 2014, les supermajors Total et ExxonMobil annoncent le forage d’un puits d’exploration à 3 440 mètres sous la surface de l’océan au large de l’Uruguay. Repoussant les limites du gigantisme technologique, s’enfonçant de plus en plus profondément dans les entrailles de l’océan, la marinisation du système technique des énergies fossiles passe par un extractivisme toujours plus exacerbé sur les écosystèmes océaniques. Nous y reviendrons. Aujourd’hui, la production offshore correspond à 30 % de la production mondiale de pétrole et 27 % de la production de gaz.
Quand les énergies renouvelables électriques prennent le chemin de l’océan
Le processus de marinisation du système technique des énergies renouvelables électriques se réalise dès le début du XXe siècle.
La volonté politique « d’indépendance énergétique » de la France après la Première Guerre mondiale, ou plutôt de réduction de la dépendance aux importations énergétiques, passe alors par l’exploitation des ressources nationales disponibles (hydroélectricité) et par la recherche de nouvelles sources d’énergie. Au tournant des années 1920, période qui voit l’électrification à grande échelle, des réflexions autour des premiers projets marémoteurs électriques modernes (des études sont par exemple menées dans le Finistère pour construire une usine marémotrice dans l’Aber Wrac’h) se présentent alors comme une continuité technologique des barrages hydrauliques traditionnels.
L’énergie hydraulique se marinise ainsi dans le cadre des recherches sur la « houille bleue », et en particulier avec la mise au point des groupes bulbes pour le barrage de la Rance au nord de la Bretagne. Inaugurée par le général de Gaulle le 26 novembre 1966, l’usine marémotrice de la Rance se présente comme une vitrine, celle d’un « symbole du génie français », matérialisant une rupture technologique inédite à l’échelle mondiale. Pour le chef de l’État, « dans l’estuaire de la Rance, la mer sera bientôt domestiquée grâce aux travaux qui doivent aboutir à la centrale marémotrice ». Dans l’esprit des promoteurs des centrales marémotrices, marqué par la puissance des grands corps d’ingénieurs, l’usine de la Rance n’est alors qu’un premier essai pour mettre au point le vrai projet, celui prévoyant de barrer la baie du Mont-Saint-Michel de Granville à Cancale en prenant appui sur les îles Chausey. Ce projet, imaginé alors en dehors de toute considération environnementale, sera définitivement abandonné au milieu des années 1980.
Au tournant des années 1920, la géothermie se marinise elle aussi avec les premiers projets d’énergie thermique des mers (ETM) développés à Cuba par l’ingénieur français Georges Claude (ses initiatives n’aboutiront pas). Installée sur le Grand port maritime de Marseille et exploitant l’énergie calorifique de la Méditerranée, une première centrale de géothermie marine a été inaugurée en France métropolitaine en 2016. Les premières tentatives pour exploiter la puissance énergétique des vagues (énergie houlomotrice) se réalisent au début du XXe siècle.
L’idée de cultiver des algues marines pour produire de l’électricité grâce à la photosynthèse est proposée au début des années 1970 par l’américain Howard Wilcox. Ce dernier a été suffisamment persuasif pour que se constitue une collaboration entre la marine américaine et l’Institut de technologie de Californie. Le monde entrerait ainsi dans la ferme énergétique aquacole du futur ! La filière biomasse se voit ainsi marinisée. Notons d’ailleurs que d’importants projets autour de la valorisation de cette biomasse marine se poursuivent aujourd’hui, que ce soit pour produire des biocarburants de troisième génération ou de l’électricité renouvelable.
À la fin des années 1980, la mer du Nord offre des conditions idéales pour l’installation des premières éoliennes offshore. D’une part la profondeur d’eau ne dépasse pas une quinzaine de mètres sur des dizaines de kilomètres au large, et d’autre part, les conditions météo-océanographiques y sont favorables, à l’abri des houles et vagues de l’océan. Cette continuité terre-mer encourage la marinisation de l’éolien. Un premier parc (11 machines de 450 KW) est inauguré en 1991 au Danemark, au large de l’île de Lolland. La forte densité technologique du secteur du Oil & Gas de la mer du Nord facilite rapidement les transferts de savoir-faire et les synergies (cross-sector opportunitites) entre l’offshore pétrolier et celui des énergies marines renouvelables. Plus de 5 700 éoliennes en mer étaient installées en Europe fin 2021, soit environ 25 GW. Un objectif de 300 GW d’éolien en mer en 2050 (avec une première étape de 60 GW en 2030) fut acté par la Commission européenne en 2020, impliquant un changement d’échelle massif.
La conquête de la côte n’ayant toujours pas été achevée par l’éolien offshore posé, il est déjà nécessaire d’aller vers le large par des techniques de plus en plus pointues et sophistiquées. Aussi, si l’éolien posé (technologie mature et adaptée à des profondeurs ne dépassant pas 50 à 60 mètres environ) se présente dès les années 1990 d’abord comme une réponse anticipatrice à la future saturation des sites terrestres (notamment au Danemark), puis comme une réponse aux nuisances visuelles causées par l’éolien terrestre (notons d’ailleurs que l’État français a récemment revu à la baisse ses ambitions envers l’éolien terrestre au profit de l’éolien marin), l’éolien flottant (technologie émergente et adaptée à des profondeurs jusqu’à 200 mètres voire au-delà en théorie) se veut dès maintenant une réponse technologique aux nuisances causées par l’éolien offshore posé (notamment les conflits d’usage avec les activités maritimes traditionnelles comme la pêche). L’éloignement des plateformes du rivage permet de profiter de plus d’espace potentiel et de vents plus forts.
Au niveau mondial, 80 % du potentiel de l’éolien en mer reposerait sur des technologies flottantes selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Le premier parc éolien en mer français (technologie posée) se situe à 12 km au large du Croisic. En Écosse, un projet de parc éolien flottant situé à 67 km de la côte a été validé par les instances gouvernementales en début d’année. Cette liberté offerte par Neptune pousse aujourd’hui Éole vers un horizon marin qui ne cesse de reculer.
On attend aussi de la mer qu’elle soit l’un des principaux promoteurs et vecteurs de cette nouvelle « économie de l’hydrogène » (en reprenant le titre de l’ouvrage de l’américain Jeremy Rifkin) porteuse de nombreuses promesses. Le développement des parc éoliens offshore, et notamment flottants, doit ouvrir la voie à la production en masse d’hydrogène vert, celui-ci devant être produit par des électrolyseurs près des machines, puis acheminé par bateaux ou par pipelines vers les bassins de consommation les plus proches. Près de 2,4 milliards de personnes (environ 40 % de la population mondiale) vivent aujourd’hui dans la bande des 100 km le long des côtes.
En évitant la confiscation de surfaces fertiles au détriment de l’agriculture ou de l’exploitation forestière, l’énergie solaire se lance aussi dans ce processus de marinisation avec le développement de nombreux projets flottants à l’échelle internationale (Maldives, Singapour, Dubaï, Seychelles…). Un projet de construction d’une centrale photovoltaïque flottante en mer du Nord, à 15 km des côtes, est en cours aux Pays-Bas.
Combinant les imaginaires de puissance de la mer à celle de l’atome, la propulsion nucléaire est utilisée dès 1954 sur le sous-marin américain USS Nautilus. La première centrale nucléaire flottante fut le Sturgis, un navire de l’US Navy inauguré en 1967 et équipé d’un réacteur à eau sous pression de 10 MW, destiné à fournir de l’électricité à une base militaire dans la zone du canal de Panama. Aujourd’hui, avec la mise en service en 2020 de la centrale nucléaire flottante russe (équipée de 2 réacteurs de 35 MW chacun) dans la ville portuaire de Pevek, en mer de Sibérie, la filière électronucléaire se réinvente elle aussi à travers cette vague marinisante. La Chine devrait suivre et lancer dans les prochains mois son premier réacteur nucléaire flottant, le premier d’une flotte chinoise composée d’une vingtaine de navires nucléaires, afin de fournir de l’électricité aux plateformes de forage et à ses petits territoires insulaires.
Au final, après plus d’un siècle de progrès techniques porté par un modèle de développement toujours plus énergivore et dévoreur d’espace, la majorité des filières énergétiques, qu’elles soient fossiles ou renouvelables, ont pris le chemin de la mer en suivant leur propre agenda.
Exploiter les richesses de Neptune : solution ou fuite en avant ?
Depuis près de deux siècles, la mer est donc devenue progressivement un terrain libre et immense devant prendre le relais d’un espace terrestre en cours de saturation et d’épuisement des ressources naturelles. Ce que nous avons moins sur terre (les énergies fossiles), allons le chercher dans la mer. Ce que nous n’acceptons plus sur terre (les impacts visuels des énergies renouvelables), allons le mettre sur la mer. Cette dernière remarque témoigne d’ailleurs de notre difficulté à construire collectivement un paysage terrestre du XXIe siècle sous le prisme de la transition environnementale et énergétique. Installer des éoliennes offshore de plus en plus loin au large, loin des zones d’habitation, c’est d’une certaine façon poursuivre (et transposer) le processus d’invisibilisation de la production énergétique construit sous l’ère des fossiles (pétrole et nucléaire en tête).
Face à la crise systémique des 3E (environnement, énergie et économie) que nous traversons, la mer représente le territoire des possibles. Dans leur ouvrage La mer. Terreur et fascination (2011), Alain Corbin et Hélène Richard parlent ainsi de la mer comme un « sixième continent », celui de l’enchantement permanent et de l’espoir perpétuel, dont la littérature et les discours politiques n’ont pas manqué de vanter les vertus ces dernières années. En reprenant les mots du président de la République Emmanuel Macron lors de son déplacement aux Assises de l’économie de la mer en 2019, « Notre civilisation ne vit que grâce à l’océan, à ce que l’on appelle parfois l’or bleu ». Déjà en 1861, Jules Michelet exaltait les richesses de la mer, cette « mer de lait » où la vie s’inventa et prépara l’avènement de l’homme sur Terre : « La terre vous supplie de vivre. Elle vous offre ce qu’elle a de meilleur, la Mer, pour vous relever. »
Parallèlement, le secteur de l’énergie est historiquement marqué par des cycles de promesses de grande amplitude, caractérisés par des vagues de technologies présentées souvent comme salvatrices. Il est rare en effet qu’une innovation énergétique apparaisse sans qu’on proclame qu’elle sauvera la civilisation du déclin. En se présentant comme les porte-drapeaux d’une double transition, à la fois énergétique (une représentation de la société bas carbone) et maritime (une représentation de la nouvelle économie durable de la mer), l’éolien offshore couple imaginaire d’abondance énergétique et imaginaire d’abondance maritime. D’un côté, la mer est présentée comme la dernière frontière à conquérir avec l’espace. D’un autre côté, les énergies marines sont les dernières énergies renouvelables à maîtriser. S’inscrivant dans l’imaginaire de l’abondance pétrolière, le Premier ministre Boris Johnson n’hésita pas à qualifier le Royaume-Uni « d’Arabie saoudite de l’éolien offshore » en 2020. Les technologies changent mais les références restent les mêmes.
La marinisation du système technique des énergies fossiles poursuit le processus d’extractivisme prédateur du XXe siècle. Et à ce titre, l’exploitation minière des fonds marins ne serait qu’un de ses derniers avatars selon les historiens Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz (L’Evènement Anthropocène, la Terre, l’histoire et nous, 2013). Il reste en effet des millions de kilomètres carrés de terrain sédimentaire sous les océans susceptible de contenir du pétrole. 13 % des réserves de pétrole et 30 % du gaz naturel non découvert dans le monde se trouveraient sous la glace, dans la zone arctique où se dessine la géopolitique de l’énergie du XXIe siècle. Cet engouement pour le Grand Nord a pour origine la découverte en 1968 d’un important gisement dans la baie de Prudhoen, sur la plaine côtière de la mer de Beaufort, en Alaska. L’exploitation sera lancée en 1973/1975 pour répondre à la crise mondiale causée par le premier choc pétrolier. Les Russes suivront les Américains en exploitant les gisements gaziers de la péninsule du Kamchatka, en Sibérie orientale.
L’Académie chinoise d’ingénierie physique a annoncé récemment travailler sur une installation en mesure d’extraire à grande échelle l’uranium marin présent dans l’océan. Avec la peur de la raréfaction de l’uranium, la mer doit être domptée au profit de l’industrie nucléaire terrestre. Des recherches sont aussi menées sur les clathrates, également appelées hydrates de gaz ou de méthane, des structures glacées contenant du méthane, un combustible potentiel mais aussi un puissant gaz à effet de serre.
Et que penser de cette course internationale visant à récupérer les nodules polymétalliques marins et autres terres rares, aujourd’hui devenus indispensables au développement de produits de haute technologie, dont nos nouvelles technologies de l’énergie (à l’image des smartgrids par exemple) ? La marinisation du système technique des énergies fossiles poursuit donc son travail de grande dévoreuse en entrant dans une nouvelle phase des plus critiques. Elle a engendré une augmentation de la pollution des océans (pétrole et gaz sont essentiels pour produire nos nombreux plastiques) et elle est à l’origine de certaines des plus grandes catastrophes écologiques de l’histoire. En 2010, l’explosion de la plateforme pétrolière offshore Deepwater provoquait une marée noire historique dans le golfe du Mexique.
Dans la mythologie grecque, Prométhée vola le feu aux dieux pour le donner aux hommes, et le feu, c’est l’énergie, le moyen d’accroître le pouvoir de contrôle des hommes sur leur milieu naturel. Face à l’urgence environnementale, le réalisateur Jean-Robert Viallet remontait le fil de l’histoire dans son documentaire L’Homme a mangé la Terre, sorti en 2019. En revenant aux sources de la crise écologique actuelle, en décryptant les étapes de la course folle du progrès technique lancée au début du XIXe siècle, il montre comment l’industrialisation effrénée a eu des effets néfastes irrévocables sur notre planète. Rappelons ici que l’océan représente 96 % du volume offert à la vie sur Terre et que l’océan produit plus de 50 % de l’oxygène de l’air que nous respirons. Pour combien de temps encore ?
