« Je voudrais bien voir un film de vampires… » – sur La Maman et la putain de Jean Eustache
Le mardi 17 mai, au festival de Cannes, Françoise Lebrun et Jean-Pierre Léaud montaient les marches du théâtre Debussy pour présenter une seconde fois dans l’histoire La Maman et la putain. La première fois c’était quarante neuf ans auparavant, le 16 mai 1973, et le film de Jean Eustache avait non seulement remporté le Grand prix du jury, il avait surtout fait scandale. Maman comme putain ont été alors jugées uniformément obscènes. Les aveugles ont sifflé. Mais l’époque s’est trompée : La Maman… est un des plus beaux films qui soient. Pour une fois, ce n’est pas une exagération de notre part, une de plus, mais une certitude.
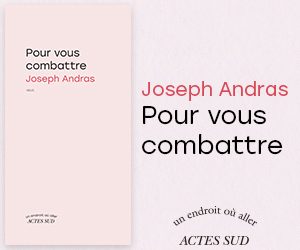
Un film de cendre soutenu par un « texte de feu » comme l’avait qualifié Bernadette Laffont, après qu’Eustache lui ait fait lire le scénario pour lui proposer le rôle de Marie. Léaud sera Alexandre, une sorte de double d’Eustache et Françoise Lebrun, qui n’avait jamais joué, mais qui avait vécu avec Eustache, quelques années auparavant, jouera Veronika – Veronika qu’elle n’est pas. La véritable Veronika apparait une fois dans une scène, dans un café : Léaud attend Lebrun, ne la voit pas. Il n’est pas certain de la reconnaitre, ils ne se sont parlés qu’une fois, en vitesse, plusieurs jours auparavant. Il dévisage sa voisine, une slave au look hippie. Un instant il doute : et si c’était elle? Le vrai devient une fois de plus le faux, et inversement. Tout le film va ainsi : marchant sur la tête.
La Maman et la putain est de toute façon ce genre d’objet qui ne fait rien comme il faut : un premier long-métrage mais d’une durée obèse de 3h40, en noir et blanc (en 1973, cela se perdait), par un cinéaste marginal qui depuis 1965 multipliait au contraire les œuvres courtes, s’arrêtait pudiquement au bout d’une heure, mais qui déjà subdivisait son œuvre en deux veines : une veine documentaire au long cours pénétrant les poches de la mémoire orale (Odette Robert, Une sale histoire) et des rituels vernaculaires (La Rosière de Pessac, Le Cochon), et un volet fiction aussi autobiographique que blessé (Mes petites amoureuses, son second et dernier long métrage en 1975, Le Père noël a les yeux bleus, merveille de récit court, avec Léaud déjà, tournée en 1966 avec les chutes de pellicule que lui avait offert Jean-Luc Godard), rabâchant la honte, les larmes, la rage, l’amour, ravalant la salive, les baisers, les humiliations et les peines, revenant sans cesse sur un motif, un seul : l’éducation sentimentale d’un jeune homme pauvre de province. Les traces qu’il en reste, à jamais. Le goût des femmes par consolation de n’avoir pas été aimé par sa mère. L’exclusion, dans tout, et son faux double : la difficulté de se faire accepter.
Et cela contamine tout : le jeu des acteurs, auquel il faut s’habituer, tellement il est soutenu par une haine du naturalisme, du cinéma comme un élément acceptable d’emblée. Non, le cinéma doit passer en nous et ce passage doit piquer. Dans La Maman…, rien ne va, ni n’a de d’évidence : pourquoi, Jean Eustache, s’inflige d’être le sismographe de ce monde qui vous rejette ? Quel paradoxe vous amène à être un cinéaste du cadre et de la durée, au cordeau, quand vous-même n’entrez dans rien : aucun cadre, aucun cercle, et que le présent vous est hostile ? Jean Eustache ne répondra pas : en novembre 1981, il s’est donné la mort, à 42 ans. En quinze années, il a offert au cinématographe plus que d’autres en douze vies. Au centre de cette œuvre maigre, inachevée, un monolithe noir ou blanc cassé : La Maman et la putain, sur qui on a dit tout et son contraire, depuis sa sortie en mai 1973. Film bilan de la génération 68, film réactionnaire, film moderne, film primitif, film pornographique, film pudique comme pas permis, film bavard, dernier ersatz du cinéma muet. Tout est vrai, donc faux. Tout s’annule – devant la puissance d’un film qu’il nous est toujours aussi difficile de comprendre, cinquante ans après. On écoute des voix, mais on met des siècles à les entendre. Cinquante ans c’est rien finalement, sur l’échelle du temps.
Donc, La Maman et la putain ressort, ce 8 juin. Dans sa version restaurée, enfin. Car on a vécu longtemps avec le spectre d’une seconde disparition d’Eustache, celle de son œuvre, dont il ne resterait à terme que le souvenir et des reproductions de basse qualité. Ses ayants-droits, pour des raisons qu’il ne nous appartient pas de commenter, refusant jusqu’ici toute exploitation de ce film, comme du reste de l’œuvre. Image-t-on qu’il ne reste de Picasso ou de Renoir père qu’un vieil album de reproduction format puzzle ? Eustache, pour le voir, il fallait depuis trop longtemps se transformer en pirate, s’échanger des fichiers, eux-mêmes copiés à partir d’un dvd japonais, d’une vhs américaine ou d’une diffusion télé lointaine.
On peut se réjouir que cette hantise soit derrière nous, pour de bon : les Films du Losange ont enfin trouvé un accord avec les héritiers, l’ensemble de l’œuvre ressortira en salle et ensuite en dvd au fur et à mesure de l’année.
Cette semaine, 50 ans après son premier jour du tournage (à Paris, le 3 juin 1972), La Maman et la putain revient en salle, dans une version restaurée et enfin complète : les eustachiens, bien entassés au fond du Select, ont tous entendu parler d’une séquence intégrée à l’époque dans une copie ou deux seulement, où Veronika et Alexandre vont au cinéma voir un film de Marc O’ : quelques minutes de cinéma dans le cinéma que l’on croyait perdue à jamais. Elle revient. C’est un premier présent mais ce n’est pas le seul. Désormais qu’on ne pourra plus passer nos articles à se plaindre de l’invisibilité de l’œuvre, il va bien falloir écouter mieux ce que l’on ne voyait pas bien. Car La Maman et la putain nous reparle enfin. On a rendez-vous avec elle ce soir, mais on ne sait plus, à force, de loin en loin, ce qu’elle a à nous dire de si essentiel. Tant de temps ont passé. Tant de silence emmuré. Tant de questions vives autrefois qui, à force, sont restées lettre morte. On répétait ce que l’on savait déjà, l’essentiel devait se taire, au nom d’un lien qu’il ne fallait pas perdre. Tant qu’elle était invisible, il était insurmontable de vouloir l’interroger sur le fonds même des choses, sur son dire.
De quelle vison de l’amour nous parle-t-elle ? De quelle vision que le temps n’aurait pas démentie ? De quel éternel amoureux se fait-elle la publicité ou la critique ? Et nous aussi, on a pris cinquante ans de plus dans la gueule, alors dans quelles oreilles, sous quels yeux, ses paroles, dégorgées sur quatre heures ou presque, vont-elles tomber ?
Et si La Maman… n’était plus qu’un fantôme? Après tout, en mai, le site francetvinfo.fr proposait dans la foulée de Cannes, une fiche technique du film au résumé un brin iconoclaste: « Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage. » Bon, si cela n’avait tenu qu’à nous, on ne l’aurait pas exactement raconté comme ça, le film qui hante le cinéma français depuis un demi siècle. On s’en serait tenu au résumé qu’en font les cinémathèques, en général : « Alexandre, qui vit avec Marie, rencontre une autre jeune femme, Veronika ».
Encore que dit comme ça, on s’aperçoit qu’on ne dit pas mieux.
Une fois encore, l’inconscient criminel frise le génie : en confondant le scénario de La Maman et la putain avec celui du (pittoresque mais super faiblard) Coupez! de Michel Hazavanicius (présenté le même jour à Cannes), le stagiaire de troisième du site se sera malgré tout rapproché au plus près du secret du film : La Maman et la putain est un film de vampire, au même tire que Nosferatu de Murnau ou Vampyr de Carl T. Dreyer, deux de ses principales influences plastiques. C’était déjà d’ailleurs un peu la thèse du grand Jérome Prieur, lorsqu’il rendit compte du film en 1973 dans les Cahiers du chemin, la revue poétique des éditions Gallimard dirigée par Georges Lambrichs.
Indéniablement, le film est maintenu sous un régime esthétique de mort vivant dans lequel les qualités de noir et de blanc de l’expressionnisme seraient passées sans prévenir dans la vie réelle, imposant un renversement des valeurs qui, depuis la nuit des temps, séparaient le monde réel du monde magique. Chez Eustache, on entre au cinéma pour réussir peut-être un jour à venir au monde, y trouver une place. Ou peut-être encore pour ne jamais prendre le risque d’en sortir. C’est que le cinéma nous a appris à faire et défaire son lit, ou celui d’une autre. Les figures spectrales de La Maman et la putain, un homme, deux femmes, quelques ami.es, ne se risquent pas entièrement dans le grand jour du réel. La magie de la nuit qui entoure leurs gestes, leur façon de parler, est ontologique : elle est accrochée à leur peur d’y trop y voir clair (quand le jour les éblouit, ou quand la vérité les fait pleurer, ils se cachent derrière des lunettes noires).
Pour autant, ils ne se trompent pas sur la valeur trompeuse des apparences, ils savent très bien qu’elles ne sont que surface, mensonge, mais ils ont pris le parti des puissances du faux, car le vrai ils y ont déjà gouté, non merci ça ira comme ça : enfant d’ouvriers, déclassés eux mêmes, mal aimés, arrivés à Paris trop tard déjà, quand la partie est finie, passant leur journée à occuper le vide, à lire dans les cafés, ne faisant même plus semblant de porter en eux une œuvre ou un projet qui leur ferait gravir l’escabeau du monde : le monde d’Eustache n’était déjà plus en 1973 celui de Balzac, ou alors un Balzac moderne fatigué, sans ambition, désœuvré, un Balzac chômage longue durée, spectateur passif d’une partie déjà perdue d’avance : la société n’attend plus qu’une dernière chute pour remettre Alexandre et Veronika à leur place. L’amour, la reconnaissance, la parole la nuit, quand ils sont seuls, leur permet de repousser un peu l’échéance, et tout cela évidement se négocie mieux là, en chambre à cinq heures du matin, dans les draps, que dans la clarté trop vive d’une après-midi.
Qu’il se lève ou qu’il se couche, La Maman est toujours un film groggy par ce qu’il vient d’encaisser ou ce qu’il va lui falloir supporter : la fabrication d’un amour, la déconstruction d’un autre. La contestation par ceux que l’on aime ou ceux que l’on a aimé de ce que l’on est ou ce que l’on n’a pas réussi à être. C’est au petit matin des premières minutes du film qu’Alexandre essaiera de parler une dernière fois devant les grilles du jardin de Luxembourg à Gilberte (Isabelle Weingarten), son ancienne amoureuse qui désormais le fuit. Elle le laissera en plan en lui disant qu’elle espère vivement qu’il « s’en sorte ». Après quoi, Alexandre, saccagé, passera devant les Deux Magots, remarquera comme une bouée le regard intrigué que porte sur lui Veronika, au point de revenir sur ses pas : mais il ne la voit plus, et en tournant la tête à gauche en direction du métro St Germain-des-près, au niveau des arbres qui, en ce mois de juin 1972, bougeaient beaucoup – il devait faire un vent ! – il l’apercevra de dos, flottant dans une longue tunique marocaine, il ira la rejoindre jusqu’à lui dire quelques mots que nous n’entendrons pas. Ce n’est pas que la caméra soit trop loin, c’est qu’il est encore trop tôt pour les mots : des mots, il y en aura bientôt tant, il y en aura bientôt trop – comme dans cette chanson d’Edith Piaf que Marguerite Duras aimait tellement.
Alexandre, à ce moment là, comme dans le Nosferatu de Murnau, est en train de franchir le pont de ce qui va devoir s’appeler à un moment ou un autre, une histoire. Quand d’ailleurs commencera-t-elle ? A l’instant même de cette rencontre, ou au deuxième ou au troisième rendrez-vous ? Ou le jour où il sera là au Flore à l’attendre, une fois encore, pas tout fait conscient de ce qu’écrira Barthes quelques années plus tard : c’est dans l’attente que se crée l’amour. C’est dire si une absence peut en délirer, des choses.
Faire du vide le corps de son symptôme. Divaguer, controuver, accoler les choses dans son discours même, avançant d’empreintes en empreintes, d’emprunt en emprunts : c’est tout le film qui est un cut up géant ou telle phrase de Bataille côtoie une idée de Baudelaire, ou des trucs piqués à Schuhl, un des deux meilleurs amis d’Eustache, ou dans le journal, ou à la radio, et quand les mots ne sortent pas, parce que l’amour a encore une fois ruiné la bouche, la langue, le cœur, les idées, il reste encore les disques, ceux de Damia, ceux de Frehel, ceux de Piaf, pour dire encore et toujours les mots d’amour.
Mais plus on entre dans les détails de cette histoire banale et terrible, plus les silhouettes semblent se détacher du réel pour venir coller à des représentations fantomatiques : les infirmières ont le teint pale. Elles ont le regard liquide (« ce beau regard de myope »), les lèvres noires et les yeux cernés de khôl. Elles font des piqures en intraveineuses à leurs amants. Après tout, quoi de plus logique dans un film où de toute façon les liquides ont sans cesse des transferts étranges, plus ou moins nobles : la salive, l’alcool, le vomi, la glaire, la bile, passent – et il fallait un film, de presque quatre heures, pour le rappeler une fois pour toutes – par les mêmes organes que la parole, que le film dégorge bientôt sans cesse, se vidant en cuvette davantage qu’elle ne communique.
Peu à peu, les lieux du récit eux-mêmes maigrissent : ils se font plus petits (ils n’étaient déjà pas bien grands). Ils se tenaient sur quelques cafés, ils ramèneront bientôt le monde à une chambre ou deux : l’une est la mienne, l’autre est la sienne. Chambres toutes d’une décoration spartiate, murs blancs comme des cachets d’aspirine, qui leur donne quelque chose de désaffecté. De l’une d’elle, ils sera dit qu’elle « sent l’hôpital ». Et pour cause, elle est attenante à l’hôpital Laënnec, dans son ancienne adresse, autrefois rue de Sèvres, où Veronika est infirmière.
Tout ça est hanté, à tous les endroits. Qu’on le veuille ou non, La Maman et la putain est un film qui a perpétuellement affaire avec la terreur.
Si tant est que, comme l’écrivait Rilke, « la beauté soit le commencement de la terreur que nous sommes capables de supporter. »
Là voilà cette beauté de film qui fait mal : un corps pas simple, un saint suaire en noir et blanc, d’une durée aride de trois heures quarante, une véritable traversée du fantasme, de trois personnages et d’une génération, celle qui fit mai 68 et gardienne d’au moins une révolution : la sexuelle. Rien que ça. Pourtant pas la plus simple à arracher : en 1973, à l’heure où les corps font la roue sous une bannière de liberté ou de libéralisme des mœurs, Eustache, peut être à la fois désirant, grand séducteur et réactionnaire, dandy canal préhistorique, nous rappelle cette réalité somme toute prolétaire, marchande, au sens du jeu même auquel se livrent les enfants pour apprendre la valeur d’échange et la valeur d’usage : on ne gagne rien sans perdre.
Ce n’est pas tout ce que le film a à nous dire sur l’amour, mais c’est de là qu’il part. Et il ne faut pas l’oublier, surtout quand il offre sur autant de minutes un visage de femme, Veronika, qui écoute un homme raconter des choses « grandiloquentes ou ridicules », parce qu’il hésite à avancer vers elle, ne sait plus s’il doit séduire ou aimer, et commence à se douter que ce n’est pas la même chose. Au moment même où il s’avancera de trop, dans ce qu’il estime être la mise à nue de sa douleur à lui, elle le clouera sur l’autel de la légèreté. Son lyrisme à lui l’encombre : ce n’est pas ça, l’amour. Ça n’est pas ce type de demande amoureuse.
Alexandre alors s’écrase, comme une mouche sur une glace parfaite. Le film aurait pu s’arrêter là. Il faisait déjà deux heures. Mais va alors commencer un second film, plus intense encore, plus complexe, toujours plus vampirique : un second film où Marie, la compagne d’Alexandre elle aussi fera les frais de l’écoute souvent muette de Veronika, cette façon de ne pas participer à la scène tout en la dirigeant, les amenant chacun à se brûler à la lumière de leur contradiction.
A trois heures de film, il lui restera quarante minutes encore pour le coup de grâce, pour leur montrer, à lui comme à elle, qu’ils n’ont rien compris, rien, à son idée de l’amour. Car c’est une idée inaudible pour beaucoup, quelques que soient les époques et les sexualités. C’est l’éternelle modernité de ce film, son désir utopique sans cesse repoussé : l’amour pour Veronika ne s’entend que dans un renoncement à la possession amoureuse.
C’est une opération en deux temps, tout aussi imposants et douloureux l’un comme l’autre : d’abord une distinction franche, entre la baise et l’amour, deux sphères qui pour Veronika n’ont rien à se dire, ne se rencontrent pas, l’un établis sur l’éphémère, la pulsion, le besoin, la distraction et s’effaçant de la mémoire aussitôt expurgé. Une voracité amnésique qui n’a « aucune importance » (cette expression que Veronika aime tant répéter). Sa distinction est, comme partout dans le film, une distinction d’organe : l’une sphère concerne le cœur, l’autre concerne les sexes. Elle ne voit pas pourquoi ces deux organes devraient avoir tant de choses à se dire. C’est le début de la logique Veronika, une logique propre à une réorganisation des sens, une dissociation de ce que l’histoire avait toujours, jusqu’ici, lié.
En retour, l’amour, que l’on pourrait croire évacué pour elle, soit parce qu’elle le fuirait ou soit qu’elle en soit incapable, elle qui depuis cinq ans vit une vie sexuelle sans relâche ni attention, une vie sexuelle « sans importance », l’amour fait retour. Mais à des conditions qui ne tiennent qu’à cette logique où les zones, les endroits, ne communiquent pas et ne font répercuter aucune douleur, dans des connexions que nous connaissons tous trop bien. Tous sauf elle, Veronika, pour qui, «L’amour c’est simple ».
C’est la grande beauté de ce film peut-être, après trois heures dix de déchirements, de pincements au cœur, c’est d’annoncer que l’amour ce n’est pas ça, pas cette chose merdique, c’est d’une évidence folle, d’une simplicité déconcertante, ça nait dans la séduction, cela nait inconsciemment, sur des traits que l’on ne saisit pas toujours, « chiure ou regard, voix ou tétine, qui refend le sujet et le grime en ce déchet qui, lui, au corps, ex-siste », disait Lacan à Rome, en 1974 (in La Troisième, Navarin, p. 18).
Toute personne sur terre sait qu’aimer est compliqué, le début de toutes les complications, de tous les cœurs et les corps fendus – mais pas Veronika, qui le tient haut et fort pour une chose « simple ». Peut-être est-ce elle, contre le reste du monde, qui a raison, ou peut-être est-ce l’obtention de cette simplicité qui est complexe : elle demande un grand laisser choir. Elle demande une capitulation. Elle demande que chacun suicide son narcissisme.
Quand elle dit cela, « saute Narcisse », son visage de cire soudain s’ouvre et ses yeux fusille toute parole de trop, chaque mot alors compte et ne peuvent plus s’en référer à soi mais doivent s’ouvrir tellement que la possession amoureuse, l’avoir à soi, pour soi et pour soi seul, devient une idée obscène, le contraire de l’amour et on son expression. Cette fin du narcissisme, elle le dit avec les mêmes armes que la psychanalyse (les infirmière sont-elles des psychanalystes ? Cette sorte de dureté devant la douleur, et cette volonté de soigner les gens quand même, par la dureté…). Personne n’appartient à personne, l’amour se fait, il s’attarde, il n’y a pas à le contrarier par des façons jalouses. De toute façon, il ne se retient pas. Veronika est venue en 1973 décrire une forme dépossédée de l’amour – rien à voir, ou si peu, avec la révolution sexuelle.
Non, Veronika n’est pas un un vampire. Elle est une Eve future. Elle annonce un demain qui ne viendra peut-être jamais, ou qui surgit toujours à titre de prototype, ce pourquoi ce film parle personnellement à chacun de ses spectateurs, un par un.
En face de l’hôpital Laënnec, où Veronika a sa chambre, il existe désormais un square que vous pouvez prendre par la rue de Babylone, le jardin Catherine Labouré. Il n’existait pas en 1973. Il a été ouvert en 1977. Mais Eustache, quand il se rendait chez celle qui a inspiré Veronika, pouvait voir l’endroit même où cette jeune religieuse, Catherine Labouré, affirma avoir vu trois fois la Vierge en 1830. Le monologue terminal de Veronika a cette même qualité de miracles : l’impalpable de sa vérité n’a de pair que la véracité de son émotion. La Maman et la putain, film à la fois en avance et en retard, jamais de son temps, film lyrique de 3h40 qui voudrait comprendre la légèreté a filmé une femme, ni une maman, ni une saine, ni une putain, parler, s’ouvrir, et dire une apparition, à en dégueuler.
La Maman et la putain, c’est Veronika canonisée !
NDLR : Philippe Azoury publiera en janvier 2023 un essai sur Jean Eustache aux éditions Capricci
