L’Afrique au diapason de Vladimir Poutine ?
Hormis la déclaration initiale de l’ambassadeur du Kenya aux Nations unies, rappelant les bienfaits de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine qui avait entériné l’irréversibilité des frontières héritées de la colonisation, la plupart des États africains se sont réfugiés dans une position de non alignement ou de neutralité face à la guerre russo-ukrainienne, quand ils n’ont pas laissé poindre une certaine indulgence, voire sympathie, à l’égard de l’agresseur. Pis encore, les opinions publiques du continent africain leur ont emboîté le pas, pour autant que l’on puisse le savoir à travers les articles de presse et les réseaux sociaux.
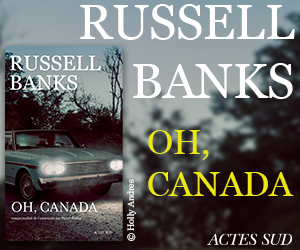
Les raisons de ce décalage entre les perceptions du conflit au sud du Sahara et celles qui prévalent en Europe ont vite été identifiées : indignation devant le « deux poids deux mesures » dont se seraient rendus coupables les Occidentaux supposés s’être montrés indifférents aux réfugiés d’Afrique et d’Asie et beaucoup plus généreux à l’égard des Ukrainiens (quitte à sous-estimer l’ampleur de la solidarité qu’ont déployée certains secteurs des sociétés européennes à l’égard des Syriens, des Afghans ou des migrants subsahariens, voire la chancelière allemande Angela Merkel) ; exaspération face à l’indéfectible soutien aux régimes autoritaires en place, nonobstant le prêchi-prêcha en faveur de la démocratie et de la « bonne gouvernance », et à la récurrence des interventions militaires ; sourde colère à l’encontre de la politique criminelle de prohibition de l’immigration mise en œuvre par l’Union européenne et le Royaume-Uni ; méconnaissance de la mémoire historique européenne et nord-américaine des Première et Seconde guerres mondiales ; présence, au sein des élites africaines, de générations de diplômés formés en Union soviétique, puis dans les Républiques post-soviétiques, et qui n’en gardent pas forcément un mauvais souvenir ; existence de liens anciens de coopération ou de luttes militantes anti-impérialistes remontant à la décolonisation ; virulence de la stratégie d’information (et de désinformation) du Kremlin sur les ondes et les réseaux sociaux ; souci de ménager un gros exportateur de céréales dont dépend le continent.
Mais au-delà de ces facteurs explicatifs immédiats et évidents interviennent des « affinités électives » plus profondes entre la Russie de Vladimir Poutine et les sociétés politiques africaines contemporaines : celles qui réunissent les « révolutions conservatrices » respectives dans ces différentes parties du monde.
L’idéal-type de la « révolution conservatrice »
On le sait, la notion de révolution conservatrice renvoie à l’histoire de la droite européenne de l’entre-deux guerres. Hugo von Hofmannsthal l’a avancée lors d’une conférence sur Les Lettres comme espace spirituel de la nation, donnée à Munich, en 1927. Si on la débarrasse de son sens normatif et prédictif appelant à l’émergence d’un « Homme nouveau » et de sa dimension idéologique, on peut la garder comme concept pour problématiser les moments de rupture intellectuelle, culturelle et politique qui offrent une réponse identitariste, d’orientation fondamentaliste, sur le mode de l’invention de la tradition, au changement social, voire à la menace révolutionnaire, et au passage d’un monde d’empires à un monde d’États-nations qui a marqué notre époque.
Ainsi entendue, la révolution conservatrice fait sienne la modernité technologique, éventuellement en la sublimant sur un plan artistique, littéraire ou philosophique à l’instar du futurisme italien. Elle offre des opportunités d’ascension à des segments subalternes de la population et apporte un sentiment d’égalitarisme par rapport aux hiérarchies des régimes précédents. Thomas Mann a avancé l’oxymore d’un « monde révolutionnaire et rétrograde » en ayant à l’esprit le national-socialisme, et sans doute aussi le fascisme[1]. Mais la dictature du comité Union et progrès [nom officiel des Jeunes-Turcs – ndlr], dans la dernière décennie de l’Empire ottoman, et son prolongement kémaliste, le nationalisme militariste japonais entre les deux guerres, ou le régime chinois du Guomindang entre 1925 et 1949, puis à Taiwan jusque dans les années 1980, en sont d’autres incarnations tout aussi probantes.
La plupart des régimes identitaristes contemporains paraissent également correspondre à ce modèle. Il en est ainsi, par exemple, du système que met en place Narendra Modi en Inde, des gouvernements successifs du PIS en Pologne, de Viktor Orbán en Hongrie ou de Recep Tayyip Erdoğan en Turquie, de l’administration de Donald Trump aux États-Unis.
Encore faut-il préciser l’idéal-type de la « révolution conservatrice » si l’on veut raisonner de manière comparative. Historiquement cette dernière apparaît, dans l’Europe de l’entre-deux guerres, comme une tentative : (a) de restauration de la dignité qu’ont bafouée la défaite militaire (ou, dans le cas italien, les frustrations d’une victoire « mutilée ») et l’abjection de la pauvreté de masse ; (b) de rédemption du peuple rétabli dans son authenticité ; (c) et d’imputation du malheur à un bouc émissaire (les Juifs, les Arabes, la franc-maçonnerie, les alliés félons, c’est selon), au fil de la dénonciation d’un complot ou d’une trahison, le fameux « coup de poignard dans le dos ».
La « révolution conservatrice » est une conscience du ressentiment tel que l’avait problématisé Nietzsche dans la Généalogie de la morale. Une expression que reprendra Max Scheler dans son célèbre L’Homme du ressentiment de 1912, récemment réédité en France chez Bartillat, en en donnant une interprétation différente. Le ressentiment porte « l’expérience et la rumination d’une certaine réaction affective dirigée contre un autre, qui donnent à ce sentiment de gagner en profondeur et de pénétrer peu à peu au cœur même de la personne, tout en abandonnant le terrain de l’expression et de l’activité[2] ». Frantz Fanon parlait pour sa part du ressentiment comme d’une « colonisation de l’être ». Ainsi appréhendée, la révolution conservatrice rejoint l’idée d’ « authenticité », celle d’un peuple supposé autochtone que l’on entend ramener à sa « tradition » quitte à les inventer l’une et l’autre[3].
À l’évidence le régime de Vladimir Poutine correspond au type-idéal. D’une part, il se nourrit du ressentiment qu’ont provoqué l’effondrement de l’Union soviétique – la « pire catastrophe du XXe siècle » au dire du maître du Kremlin, pace la Shoah –, le démantèlement de son système de protection sociale, la libéralisation effrénée de l’économie dans les années 1990 et l’accaparement sauvage des ressources par les oligarques. Une sourde rancœur qu’ont alimentée l’intervention de l’OTAN au Kosovo, l’élargissement progressif de cette dernière dans les anciennes marches de l’empire soviétique, l’invasion américaine de l’Irak, le renversement du colonel Kadhafi au prix du dévoiement d’une résolution de l’ONU.
D’autre part, le régime de Vladimir Poutine exalte et fantasme une « âme russe » éternelle, identifiée à l’orthodoxie, qu’il faut défendre contre l’Occident, les « révolutions de couleur », les homosexuels et les « nazis ». Compte tenu de sa prééminence dans l’exercice du pouvoir, le ressentiment personnel de Vladimir Poutine, ce petit agent du KGB humilié et meurtri par la débâcle de son univers, est central pour comprendre le cours des événements.
Mais ne nous leurrons pas. L’homme est le fondé de pouvoir d’une institution, le KGB devenu FSB, dont il incarne les intérêts et le style de domination, jusqu’au langage et aux méthodes. La révolution conservatrice survivra à son retrait ou à sa mort, car elle répond aux attentes d’une part non négligeable de la société, de la classe politique et de l’Église orthodoxe dont le patriarcat de Moscou, sous la houlette de Kyrill, est devenu l’« intellectuel organique », au sens gramscien du terme.
La révolution conservatrice en Afrique
La révolution conservatrice qui s’impose en Afrique, comme dans une grande partie du monde, se trouve en « affinités électives » avec celle que connaît la Russie depuis une vingtaine d’années. Sur fond de passage d’un monde d’empires à un système continental d’États-nations, au moment de la décolonisation, l’élite tenante des institutions politiques s’efforce de contrer la menace qu’ont fait peser sur elle, d’une part l’ajustement structurel d’inspiration néo-libérale des années 1980-1990, d’autre part la vague de revendication démocratique qui s’en est ensuivie. Elle a engagé un processus de restauration autoritaire qui, là aussi, a fait la part belle à l’« État profond » et qui a recouru à l’invocation de l’ « authenticité » culturelle de l’Afrique, tout autant fabriquée que celle de la Russie.
De ce point de vue des personnages comme feu Robert Mugabe (au Zimbabwe), Yoweri Museveni (en Ouganda), Paul Biya (au Cameroun) suivent (ou ont suivi) une stratégie assez similaire à celle d’un Vladimir Poutine dont ils partagent bien des tics idéologiques, à commencer par la phobie de la démocratie et des LGBTQ+, renvoyés à la même aliénation culturelle. Et, là aussi, des institutions religieuses mettent leurs idées, leur foi et leur appareil au service de l’autorité politique et de la rédemption du peuple : tantôt le catholicisme conservateur, avec par exemple le cardinal guinéen Robert Sarah, dont Vincent Bolloré vient d’imposer à la direction de Paris Match le portrait en couverture du célèbre hebdomadaire, au grand dam de sa rédaction ; tantôt l’islam salafiste ou confrérique, en particulier dans le Sahel ; ou encore, et surtout, le pentecôtisme lié à la Religious Right nord-américaine – notamment en Ouganda – ou à la nébuleuse évangélique brésilienne – comme au Mozambique.
Néanmoins, il serait erroné de limiter la révolution conservatrice à la seule stratégie de restauration autoritaire des tenants de l’État. Ces derniers savent surfer sur les attentes d’une partie au moins de la population, peut-être ou probablement majoritaire. Celles des croyants plus ou moins fondamentalistes de toute religion, en quête de rédemption, tels que les zélateurs de la Joseph Generation en Ouganda. Celles aussi des adeptes, en nombre grandissant, d’une conception musculaire du pouvoir et du virilisme politique qui s’épanouit dans les rangs des milices, du vigilantisme, des mouvements armés insurrectionnels ou d’autodéfense, voire de la délinquance pure et simple. Il est d’ailleurs révélateur que des figures de l’opposition adoptent ce positionnement de la révolution conservatrice, notamment en matière de mœurs, à l’instar d’Ousmane Sonko, chantre des « valeurs sénégalaises » et grand pourfendeur de l’homosexualité.
Autrement dit, la révolution conservatrice en Afrique a une vraie base sociale, tout comme le national-socialisme ou le fascisme dans l’Europe de l’entre-deux guerres. Elle se présente à son tour comme une conscience du ressentiment qui se repaît de la mémoire traumatique de l’esclavage – à la fois atlantique, arabe et interne –, de l’occupation coloniale, de la pauvreté de masse, du déclassement social et des frustrations qu’ont entraînés les politiques d’ajustement structurel. Elle met en forme la rancœur des « petits » – des cadets sociaux, dans le jargon de l’anthropologie – à l’encontre des « grands », des aînés sociaux qui se sont emparé des richesses de la nation. La révolution conservatrice en Afrique se réclame de la « jeunesse », à l’image des nationalistes des années 1950, sans lésiner sur le recours à la violence virile.
Elle traduit sur ce plan la rancœur sexuelle que produit l’exclusion du marché matrimonial d’un nombre grandissant de jeunes hommes, incapables d’honorer l’obligation de la dot. Le viol – en particulier en Afrique du Sud –, l’enlèvement de jeunes filles – sous les auspices de Boko Haram, au Nigeria – ou l’homophobie agressive sont les symptômes de cette confiscation de la libido par les riches, au même titre que la phobie de l’impuissance sexuelle, l’explosion de la prostitution ou le libertinage débridé, autant de signes d’un désordre généralisé qui alimente une panique morale et une insécurité religieuse auxquelles doit remédier l’avènement de l’Homme nouveau bien dans sa « culture ».
En bonne méthode wébérienne, il est hors de question d’exagérer la similitude de la révolution conservatrice en Afrique et de son pendant en Russie (ou ailleurs dans le monde). Cette configuration est dotée sur le continent d’une historicité propre que lui confèrent l’expérience dramatique de l’esclavage – dans ses diverses composantes – et l’occupation européenne à l’époque coloniale, dont la répétition des interventions militaires et la tragédie migratoire entretiennent l’humiliation.
Surtout, le ressentiment né de ces expériences historiques douloureuses se double, au cœur même de l’ordre intime des familles, du ressentiment sorcellaire qu’entretiennent les conflits affectifs, psychologiques ou économiques au sein de la parenté. Les anthropologues ont d’ailleurs démontré que l’imaginaire de la sorcellerie est indissociable de la mémoire traumatique de l’esclavage et de la colonisation.
En bref, le complotisme inhérent à la révolution conservatrice, qui prospère sur les réseaux sociaux, fait ses choux gras, au moins au sud du Sahara, de deux genres discursifs centraux dans les sociétés : le répertoire sorcellaire dans les familles, d’une part ; l’idéologie dépendantiste dans la conscience nationaliste, de l’autre. D’un même geste politique la révolution conservatrice entend dénoncer et étouffer le complot de l’impérialisme et celui des forces de l’invisible, lesquels se confondent souvent. Il y a là une singularité de la révolution conservatrice en Afrique qui n’a pas suffisamment retenu l’attention des politistes travaillant sur le continent.
D’autant plus que la formation asymétrique de l’État, sur un plan territorial – ce que l’on nomme à tort l’ethnicité ou le tribalisme – renvoie à des épisodes historiques liés à la conquête européenne et à l’esclavage qui demeurent sous-jacents à nombre de guerres civiles (Tchad, Angola, République centrafricaine, Liberia, Sierra-Leone), de coups d’État (Bénin, Togo) et de régimes autoritaires contemporains ou, plus banalement, aux relations politiques et économiques entre les groupes sociaux ou les régions.
De même la violence djihadiste au Mali, au Burkina Faso, dans le nord du Nigeria – expression de la révolution conservatrice, s’il en est ! – est agraire, autant que religieuse, et elle implique des rapports sociaux dont les racines sont souvent séculaires, voire pluriséculaires, même s’ils sont tributaires de dynamiques plus récentes, telles que la multiplication des sécheresses, la pression démographique, l’accaparement des terres par des projets agroindustriels ou miniers.
Les mobilisations religieuses fondamentalistes contemporaines, qui procèdent par invention de la tradition en promouvant le retour au christianisme supposé primitif ou à la Médine du Prophète et l’avènement de l’Homme nouveau, en synchronie avec les thématiques plus strictement politiques de la révolution conservatrice, traitent à leur façon de l’héritage servile en mettant sur un plan d’égalité tous les croyants, quels que soient leur origine sociale, leur âge et même leur genre, et elles inscrivent la lutte contre la sorcellerie (ou la superstition) en tête de leurs priorités.
De ce point de vue, le pentecôtisme est un cas d’école, mais on ne peut le comprendre que dans sa relation antagonique d’ « inimitié complémentaire » avec le salafisme, lui aussi hostile aux privilèges de la naissance, et notamment à l’ordre des dynasties confrériques de l’establishment religieux du nord du Nigeria, celles de la Tidjaniyya et de la Qadiriyya. À la limite Boko Haram, nourri dans le sein du salafisme et qui s’est finalement retourné contre lui, est d’abord une insurrection sociale des « captifs », ces descendants d’esclaves dont l’État colonial et postcolonial a reproduit et souvent aggravé la subalternité.
L’imbrication intercontinentale des révolutions conservatrices
Deux questions restent ouvertes à ce propos. Dans quelle mesure les expériences européennes de la révolution conservatrice ont-elles pesé sur l’imaginaire politique du continent africain ? On sait que certains idéologues des régimes de parti unique, au lendemain des indépendances, ont pu trouver quelque charme à l’ingénierie des mouvements de masse totalitaire de l’entre-deux guerres et à leur culte de la personnalité, encore que le maoïsme ait vite fourni une référence plus présentable.
Si l’on accepte l’hypothèse de l’historien indianiste Partha Chatterjee selon laquelle il y eut bel et bien une hégémonie coloniale qu’a reproduite le nationalisme, l’on comprend mieux que la « culture du chef », supposée caractériser l’Afrique dans ce qu’elle a de plus « authentique », est en réalité un avatar du style de commandement coercitif, à la fois bureaucratique et arbitraire, de l’administration coloniale. Le proverbe qui veut qu’il ne peut y avoir qu’un crocodile mâle dans le marigot est très certainement apocryphe. L’autoritarisme postcolonial n’est pas le retour du naturel au galop, la résurgence de la culture ou de la religion autochtones, mais la reconduction d’un mode de gouvernement européen au gré de la logique de l’invention de la tradition.
Cela vaut aussi pour l’Afrique du Nord. La Commanderie des croyants, au Maroc, est une création de constitutionnalistes français imbus de l’héritage du maréchal Lyautey, et Habib Bourguiba, en Tunisie, s’est inspiré des réformismes islamique et ottoman mais aussi du réformisme colonial et du centralisme démocratique communiste pour construire son régime de parti unique, sans doute le plus puissant du continent.
La seconde question que soulève la comparaison de la révolution conservatrice en Afrique avec l’entre-deux guerres européen a trait à la réverbération de la domination coloniale dans la mise en route des révolutions conservatrices de cette période. Elle est loin d’être négligeable. L’Homme nouveau de Salazar, au Portugal, était celui des caravelles : le saint, le conquérant, le colon. Mussolini confiait à l’occupation de l’Éthiopie, de la Libye et de la Somalie la même mission rédemptrice de l’Italien. Plus généralement la colonisation a été le haut lieu de la « brutalisation » de l’Europe – y compris par la pratique du génocide –, de l’adoption de formes plus ou moins déclarées d’eugénisme et de systématisation de cette représentation culturaliste du monde qui est inhérente aux révolutions conservatrices européennes, jusqu’à aujourd’hui.
On voit de la sorte que l’indulgence de l’Afrique à l’égard de l’aventurisme militaire de Vladimir Poutine revêt une profondeur de champ autrement plus problématique que l’irritation épidermique de la dégradation des relations avec l’Europe ou la recherche d’autres partenariats économiques, diplomatiques et militaires. Nous sommes en présence d’un vaste mouvement social et culturel comme le prouve la fréquence des motifs favoris de la révolution conservatrice – le rejet de l’Occident, la stigmatisation de l’homosexualité – dans les milieux universitaires, journalistiques et artistiques.
Cette vague est sous-jacente à une réorientation et une recomposition du processus de formation d’une classe dominante tenante de l’État, depuis la colonisation. Les coups d’État récents au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, de tonalité « populiste », en sont un symptôme parmi d’autres. Néanmoins, le régime plus policé – dans tous les sens du terme – de Paul Kagame, au Rwanda, dont Emmanuel Macron a fait l’un de ses interlocuteurs privilégiés au sud du Sahara, qui se pique de bonne gouvernance hautement technologique et qui se spécialise dans le recyclage de migrants expulsés d’Europe, en est un autre avatar. Dans le sillage de la privatisation radicale des économies africaines, au cours des années 1980-1990, la révolution conservatrice est susceptible de véhiculer un « libéralisme autoritaire » (Hermann Heller caractérisait de la sorte le soutien de Carl Schmitt au chancelier Heinrich Brüning, en 1933) propice à la « réforme » et à une intégration accrue du continent au nouvel ordre capitaliste mondial.
L’essentiel est de bien comprendre qu’elle n’a rien de passéiste, en dépit de ses obsessions traditionalistes et culturalistes d’un « retour » à l’authenticité africaine. Elle s’accomplit à travers les réseaux sociaux et par le truchement de la téléphonie mobile, omniprésente sur le continent plus encore qu’en Europe. De ce fait elle est bien un « romantisme technicisé », comme le disait Thomas Mann du national-socialisme. Elle s’exprime aussi par les répertoires culturels de la globalisation qui enflamment la jeunesse, tels que le rap, volontiers machiste et homophobe en même temps qu’anti-impérialiste.
Elle est étroitement associée à la révolution religieuse qui balaye le continent sous les visages divers du prophétisme, du pentecôtisme, du salafisme, voire du djihadisme, manifestations de la foi qui ont ceci de commun qu’elles récusent le traditionalisme, la coutume, l’ordre établi de la parenté et de ses usages, la notabilité des anciens en se réclamant paradoxalement de l’authenticité de la « culture africaine ». Sa propension à prendre pour argent comptant les explications complotistes de la marche du monde est de la même encre que celle des sociétés occidentales. Elle accompagne l’émergence de l’abstraction de l’État rationnel-légal depuis deux siècles[4].
Une fois de plus l’Afrique se révèle banale, à l’aune de la marche du monde. Foin d’exotisme si l’on veut saisir les messages qu’elle nous envoie. En la matière, la comparaison est raison. Elle nous permet de comprendre que Vladimir Poutine et le patriarche Kyrill parlent d’or sur le continent en dénonçant l’Occident décadent et son homosexualité récurrente, en stigmatisant son complot contre l’ « âme russe » éternelle, en en appelant à la spiritualité (et à la kalachnikov) pour la sauver. À bon entendeur le Salut…
