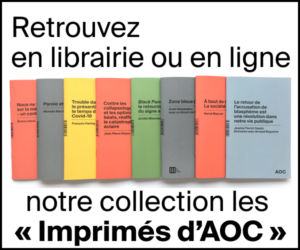« Méga-bassines » : réparer la fracture hydraulique
Les retenues d’eau pour l’irrigation, rebaptisés « méga-bassines » par leurs opposants, sèment un vent de contestation dont le conflit de Sainte-Soline semble être le point d’acmé. Planifiés en masse dans l’ex-région Poitou-Charentes (Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime), ces projets portés de longue date par les irrigants font l’objet de critiques virulentes, largement reprises à leur compte par les médias.
Cette crise est révélatrice de la politique laborieuse de l’État pour adapter nos usages, notamment l’agriculture, au changement climatique. Elle pose surtout la question plus fondamentale de la méthode permettant d’ajuster les besoins anthropiques à l’évolution de la ressource disponible.
Derrière la guerre de l’eau, celle des idées
Les soubassements du conflit sont profonds. Ils opposent deux visions tranchées, hélas imperméables, de l’agriculture et de la gestion de l’eau. La profession agricole majoritaire, qui se fait étonnamment discrète sur les ondes, défend une politique de l’offre d’eau reposant sur la création de nouvelles ressources artificielles pour pallier celles qui « naturellement » s’effondrent. Elle prêche pour une substitution des prélèvements estivaux par des captures hivernales en principe moins nocives pour le milieu car mieux loti. La profession rechigne en revanche à modifier ses pratiques autrement qu’à la marge, au nom de la sempiternelle liberté d’entreprendre et de la compétitivité des fermes françaises.
Aux antipodes, les contestataires axent tout leur discours sur la politique de la demande agricole d’eau. Il serait, selon eux, impensable à l’avenir de continuer à prélever dans le milieu naturel, l’été aussi bien que l’hiver : l’agriculture devrait produire, la plus belle partie de l’année, sans eau. Par quel miracle ? Celui de l’agroécologie et des solutions fondées sur la nature (couverts végétaux, engrais riches en matière humique, non-labour, haies, agroforesterie). Mais si la généralisation de ces pratiques s’avère absolument nécessaire, rien ne prouve qu’elle sera suffisante pour cultiver sous un climat beaucoup plus aride qu’aujourd’hui. L’agroécologie, par définition, est très liée au contexte pédoclimatique (type de sols…) et ne pourra se déployer qu’en brisant une multitude de verrous techniques, organisationnels et économiques.
S’ajoute que l’implantation de davantage de couverts végétaux peut être tributaire de la ressource en eau (germination, croissance de la plante) et installer une forme de concurrence hydrique avec les autres espèces cultivées selon le vieux diction jardinier « un binage vaut deux arrosages ». Même si on peut en rêver, il n’y a pas de substituabilité parfaite entre l’irrigation et des bonnes pratiques qui tentent de mieux retenir l’eau dans les sols. D’ailleurs la plupart des travaux sur la gestion adaptative de l’eau ne portent pas sur des alternatives aussi binaires, mais explorent un panel de solutions (réutilisation des eaux usées, variétés résistantes…)[1].
Entre des agriculteurs qui se précipitent aveuglément sur le stockage et leurs détracteurs qui l’excluent catégoriquement, l’impasse est totale, faisant courir le risque d’immobilisme face au changement climatique. Parce qu’on n’adaptera pas l’agriculture sans et contre les agriculteurs en place, ni sans l’assentiment de la société civile, la stratégie du stockage de l’eau doit être reprise à la base avec des questions naïves : comment retenir ? combien ? pour quoi faire ?
Reconception des retenues
Les critiques les plus saillantes portent sur les aspects techniques des projets de « méga-bassines ». La première vise le gigantisme des ouvrages et elle fait mouche. On ressasse ad nauseam l’image tapageuse de dizaines de terrains de football ou de piscines olympiques. Énormité qui évoque immédiatement la disproportion des installations et l’artificialisation exagérée du milieu. De nos jours, ce qui est grand est moche, ou pire industriel : en agriculture, c’est l’équivalent du point Godwin ! Sans nul doute des infrastructures plus modestes, fatalement plus nombreuses, pourraient rendre les projets plus acceptables aux yeux du public.
On vitupère également contre les réserves à ciel ouvert, d’où l’eau stagnante s’évapore en grande quantité, mais aussi se dégrade par eutrophisation en raison de la chaleur (développement de micro-organismes). Même si ces inconvénients existent pour tous les plans d’eau stagnante, ils doivent faire réfléchir à de nouvelles formes de stockage, notamment en milieu souterrain par la recharge artificielle des nappes. Prônée par l’ONU, et en cours d’expérimentation en France, cette technique présente plusieurs mérites parmi lesquels l’absence d’artificialisation en surface et le maintien de la qualité de l’eau[2].
On dénonce encore le pompage en nappes souterraines, parce que l’eau y est plus pure. Les pouvoirs publics voient ici l’avantage de contrôler la quantité exacte d’eau qui est prise (via des compteurs), mais aussi de pouvoir déconnecter l’ouvrage du milieu en période estivale. Il n’empêche que la captation souterraine a plus d’impact sur les aquifères et la qualité de l’eau qu’une simple récupération d’eaux de pluie. Aussi faudrait-il davantage privilégier les systèmes qui retiennent ou aspirent les eaux de surface lorsqu’elles surabondent (crues, inondations). Les prévisions de la direction de la climatologie de Météo France accréditeraient cette option : avec le réchauffement climatique, ce seront apparemment plus de précipitations l’hiver, avec des évènements extrêmes, mais des pluies moins efficaces pour la recharge des aquifères (du fait de températures plus élevées).
L’alimentation des retenues : quels volumes prélevables l’hiver ?
Aux critiques purement environnementales s’ajoute un argumentaire plus politique, avec sa grammaire militante. Il s’agit de la privatisation, pire de l’accaparement d’un bien commun par une minorité d’acteurs. Effectivement, les irrigants raccordés aux réserves sont actuellement en petit nombre. À ceci près qu’ils font profiter les volumes qu’ils ne prélèvent pas l’été aux autres agriculteurs qui n’auront pas d’autre choix que de poursuivre cette pratique. De plus, l’agriculture irriguée dans son ensemble représente des surfaces importantes des bassins concernés (de l’ordre de 20 %), de même qu’un poids substantiel dans l’économie agro-alimentaire locale.
Parler d’accaparement galvanise les troupes en laissant entendre que les irrigants s’arrogent la majeure partie de la ressource en en privant les autres usagers. La vérité est plus cruelle : c’est l’État, à travers le préfet, qui ouvre les vannes des prélèvements hivernaux (qui n’ont rien d’automatique) pour un certain volume. Les agriculteurs, quand bien même ils possèderaient le contenant (la bassine), ne disposent pas du contenu (l’eau) : une autorisation distincte est pour cela nécessaire. De plus, la hiérarchie entre les usagers est clairement établie par les textes de loi : l’agriculture, au même titre que les activités économiques, passe toujours après la salubrité publique, la sécurité et l’eau destinée à la consommation humaine.
Ainsi, la clé pour que les réserves agricoles n’assèchent pas davantage le milieu au détriment des autres usagers est qu’elles répondent à des conditions de remplissage strictes. Un récent décret du 29 juillet 2022 a eu l’audace de les poser. Ce texte subordonne l’octroi de volumes hivernaux par le préfet au fait qu’il s’assure qu’ils respectent le bon fonctionnement des milieux aquatiques sur la base de statistiques hydrologiques. Toute la difficulté sera d’évaluer scientifiquement ces volumes potentiels en période de hautes eaux, problématique qu’on connaît déjà avec la détermination des volumes prélevables l’été. Dans le bassin du Clain (Vienne), qui doit accueillir 30 infrastructures de stockage, une étude dite HMUC (hydrologie, milieu, usages, climat) est actuellement en cours pour déterminer si des quantités d’eau seront disponibles l’hiver (ce que les premiers résultats confirment) et quels seuils ne pas dépasser.
Cet élément, cardinal dans le débat, est régulièrement passé sous silence car il n’arrange, à vrai dire, aucune partie. Il dédiabolise les « bassines », dont l’alimentation obéit à des règles précises, loin de l’image du laisser-faire. Il interdit aussi d’en faire la panacée dans la mesure où les porteurs de projets ne sont pas assurés de leur remplissage tous les ans ; tout dépendra du niveau de précipitations en hiver et de la recharge préalable des aquifères. C’est donc un pari qui peut s’avérer perdant sur le long terme !
Le risque de non-remplissage doit être mesuré tant socialement (des retenues à moitié vides !) qu’économiquement (retour sur investissement d’argent privé comme public). L’exemple de l’Espagne, qui a mis en place une capacité de stockage des flux annuels de 48 % (contre 4,7 en France), donne à réfléchir : les taux moyens de remplissage des ouvrages sont maintenant inférieurs à 50 %[3]. En revanche, avec d’autres types d’infrastructures, notamment souterraines, il devient possible d’imaginer un stockage pluriannuel, comme en matière de production viticole, qui permette de lisser les mauvaises années…
Transformation du modèle agricole
Reste l’argument, voulu comme massue, que le stockage perpétuerait un modèle agricole intensif dépassé dont les produits seraient essentiellement destinés à l’exportation. Les préfets des territoires ont évidemment d’autres chiffres, parlant de 90 % de la production en cause qui reste dans l’hexagone. Quant à la critique du caractère intensif, elle appellerait une vraie discussion, dans un contexte où les surfaces agricoles utiles vont diminuer du fait de l’artificialisation, de la sanctuarisation des espaces naturels, de la montée des océans ou encore de terres (notamment à vignes) rendues incultivables par le climat. L’agriculture devra plus vraisemblablement être écologiquement intensive, pour parler comme l’agronome Michel Griffon.
Cela dit, il est clair que le stockage ne doit pas être un moyen de cultiver comme avant, de ne pas faire bouger les lignes productives. Ce ne sera pas aux ressources de continuellement s’adapter à nos besoins, mais bien le contraire. À l’homme incombe la responsabilité d’ajuster ses rapports au vivant, pour reprendre la belle formule de Baptiste Morizot[4]. Tant est si bien que si l’on décide collectivement de faire bénéficier nos agriculteurs d’un accès sécurisé à l’eau, des contreparties réciproques substantielles sont exigibles.
Actuellement la gestion quantitative de l’eau est dépourvue du moindre critère qualitatif. L’agriculteur fait ce que bon lui semble du quota d’eau que l’État lui a alloué. Ce qui est loin de conduire à des pratiques systématiquement vertueuses. Dans un contexte de raréfaction de la ressource et de transition écologique, avouons que c’est embêtant. Pour combler la lacune, et rendre subséquemment le stockage acceptable, une solution, simple mais courageuse, existe : assortir l’utilisation de l’eau stockée d’un cahier des charges agroécologique.
Celui-ci définirait quelles sont les cultures irrigables, les techniques d’arrosage efficientes (outils d’aide à la décision, goutte-à-goutte…), et la modification des pratiques agricoles nécessaire à l’amélioration du milieu (réduction des pesticides, amendements riches en humus, non-travail du sol, implantation de couverts…). De tels engagements de la part des usagers de l’eau devraient être précis, fermes et contrôlés sur la base d’une certification comme cela se fait déjà pour beaucoup de productions sous signe de qualité. Leur non-respect ferait perdre tout ou partie du droit d’accéder à l’eau.
Gouverner l’eau comme un commun
Dans l’esprit de ce qui est proposé ici, des protocoles d’accord ont été initiés par les services de l’État sur les territoires accueillant les projets de retenues : l’un dans les Deux-Sèvres conclu en 2018 et l’autre dans la Vienne (bassin du Clain) signé le 3 novembre 2022. Ce dernier a recueilli l’assentiment de 76 % des acteurs du territoire ayant participé aux négociations. Seules quelques associations environnementales avaient refusé d’y prendre part. C’est dire, à rebours de ce que laisse croire le traitement médiatique, le soutien que reçoit localement la trajectoire dessinée. L’acceptabilité sociale a décidément plusieurs visages…
Alors que valent ces feuilles de route ? On distinguera leur valeur intrinsèque de la perception que, de l’extérieur, la plupart en auront. Sur le fond, les deux protocoles – des Deux-Sèvres et de la Vienne – diffèrent par leur niveau d’exigence. Le second en date (bassin du Clain) contient des objectifs agroécologiques notablement plus substantiels, avec des obligations de résultat à atteindre pour les agriculteurs qui vont bien au-delà des standards actuels. Ici, les efforts de concertation ont été payés par des engagements fermes des irrigants à adopter un changement progressif de leurs pratiques pour améliorer la qualité du milieu (biodiversité, eau, zones humides). Même s’il n’est pas parlé de reconception totale du modèle agricole, très honnêtement nous n’avons pas connaissance d’un projet de territoire, en France, aussi ambitieux sur le plan écologique pour l’espace rural.
Pour autant, il est à craindre que ces protocoles ne parviennent pas à apaiser les tensions, ni à convaincre les récalcitrants. D’abord, ils interviennent trop tard, une fois que les projets de construction sont déjà actés. De sorte qu’ils sont perçus comme des démarches de communication visant uniquement à cautionner les projets en cours. De fait, il aurait fallu entamer ces discussions dès le départ, en mettant tout sur la table des négociations : nombre et type de retenues, volume global stocké, acteurs impliqués (producteurs, filières), évolution des systèmes agricoles…
Ensuite, ces protocoles se greffent sur une gouvernance de l’eau complexe et excessivement étatique. En effet, même si la planification de la gestion de l’eau est réalisée par des instances plurielles (Comité de bassin et Commission locale de l’eau), le pilotage concret des prélèvements et des infrastructures reste assuré par l’État. Or celui-ci, dans le débat qui nous occupe, n’est pas perçu comme neutre, accusé d’être trop lié aux intérêts économiques agricoles. Seule une véritable décentralisation de la gouvernance de l’eau pourrait pallier ce déficit de transparence et de représentativité.
À cet égard, le protocole du bassin du Clain fait œuvre innovante en proposant la création d’un établissement unique, sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP), présenté comme une « maison commune de l’eau » : cette instance réunira l’ensemble des parties prenantes du territoire (collège des personnes publiques, collège des agriculteurs, collège des acteurs de l’eau) et servira de cadre de discussion, de décision quant à la gestion adaptative du milieu, de réalisation d’études scientifiques, et de contrôle des engagements agroécologiques. Si cette gouvernance venait à être pérenne, ce serait un tournant majeur dans la manière de concevoir l’administration des communs.
Le dernier écueil de tels projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) est sûrement l’incertitude concernant leur portée juridique. Jusqu’à présent, l’État les encourageait, mais ne se mouillait pas au point de les reconnaître officiellement. De sorte que leur contenu n’engageait pas vraiment les signataires (autrement que symboliquement), ni ne pouvait être opposé à l’administration !
L’adoption de protocoles nouvelles générations (bassin du Clain) pourrait à cet égard changer la donne en prévoyant expressément une force juridique contraignante du projet, avec des effets tant sur la police de l’eau (ex. volumes) que sur les pratiques au champ (obligations de résultats, certification, contrôle et sanctions). Il n’empêche que les contrats, même les mieux ficelés, sont des promesses d’avenir qui peuvent toujours être trahies. D’où la tentation de penser qu’ils sont du vent comparé aux ouvrages qui vont physiquement et durablement consteller nos rases campagnes. Toutefois, l’essentiel n’est-il pas invisible pour les yeux ?
L’accès à la ressource en eau, parce qu’il est le point de convergence d’intérêts contraires, peut constituer un levier puissant de la transition écologique du modèle agricole et une expérience de gestion innovante des communs. Cette voie exigeante nécessiterait cependant de sortir des postures idéologiques qui se renforcent les unes au contact des autres et bloquent tout progrès. Sur cette problématique de l’ajustement des besoins et des ressources naturelles, ce sont moins les solutions techniques qui feront défaut que notre intelligence sociale collective. Si la bataille des « bassines » paraît pour certains gagnée dans l’opinion, le combat du changement climatique sera d’une toute autre envergure.