Le « refus du travail » : une idée reçue qui fait diversion
Le travail, au sens d’emploi salarié, a une place centrale dans les sociétés post-industrielles comme la France. Il est ainsi au cœur de l’action publique et des discours politico-médiatiques. À ce titre, différentes « notions » se sont succédées dans l’actualité récente du travail, suscitant de vifs débats. Au moins trois méritent attention, en ce qu’elles marquent une certaine convergence idéologique.
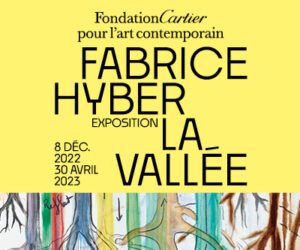
D’abord, en début d’année 2022, ce fut la « grande démission ». Venue des États-Unis, cette expression traduit les démissions en masse de la part des salarié.es post Covid-19. Ce phénomène menacerait de se produire en France et nécessiterait de redonner du « sens au travail », qui serait en perdition. À l’approche de l’été, c’était ensuite au tour de la « pénurie de main d’œuvre » de faire l’actualité, continuant à alimenter les discours sur les emplois « vacants » ou « non pourvus ». Depuis la rentrée, c’est enfin le « quiet quitting » (« démission silencieuse »), désignant des « mercenaires » ou « désengagé[e]s » au travail (plus exactement ne souhaitant pas travailler au-delà de ce qui est inscrit dans leur fiche de poste).
Faire du bruit à partir de (presque) rien
Il est remarquable que ces trois notions ne soient pas objectivées scientifiquement. D’une part, la « grande démission » n’a pas eu lieu en France. Et la hausse relative des démissions observées est un phénomène classique, car cyclique sur le marché de l’emploi, observable à l’occasion des reprises économiques. D’autre part, la « démission silencieuse » n’a rien de nouveau – pensons aux « freinages » dans l’industrie du XIXème siècle. Elle est également très difficilement quantifiable, si tant est qu’elle puisse l’être. Et pour cause : elle recouvre une diversité de pratiques et d’interprétations qui ne renvoient pas forcément à des personnes en désamour avec le travail. Par exemple, elles peuvent être très investies mais vouloir récupérer leur enfant à 18h et faire leur part de travail domestique.
Quant au terme de « pénurie » de main d’œuvre, il est usurpé ou excessif. Certains secteurs d’activité, comme l’hôtellerie-restauration ou l’agriculture, rencontrent effectivement des difficultés de recrutement ; mais elles sont en général localisées, momentanées et ne sauraient s’expliquer que par un individu qui voudrait ou non travailler. Une diversité de facteurs entre en jeu, comme la conciliation de l’emploi avec la garde d’enfants, la distance et l’offre de transports entre le travail et le domicile, ou encore les conditions de logement sur place des saisonnières et saisonniers. Au demeurant, le nombre d’emplois qui, au final, n’est pas pourvu ou ne fait l’objet d’aucune candidature est très résiduel[1]. Difficile sinon impossible d’en déduire quelque chose du rapport au travail de manière générale.
Mais cela n’empêche pas ces trois notions d’avoir été reprises et commentées à l’envi, mobilisant responsables médiatiques, politiques et patronaux. Une interprétation majeure est présente à chaque fois, qu’il s’agisse de la déplorer ou de la saluer : les françaises et français ne voudraient pas, plus ou moins travailler, en tous cas pas à n’importe quel prix. Et de s’interroger sur une perte de sens du travail qui serait elle aussi massive. Si les prises de position sont hétérogènes, les débats n’en demeurent pas moins définis et cadrés de façon à produire l’idée – reçue – d’un désengagement généralisé. Ainsi une émission de France Culture titre-t-elle : « Qui a encore envie de travailler ? »
Une certaine définition de l’emploi comme problème public paraît ainsi s’être imposée, entendu par « problème » qu’un certain nombre d’emplois ne trouveraient pas preneurs. Dans un ouvrage au titre évocateur, Gouverner par l’emploi (Paris, PUF, 2022), Camille Dupuy et François Sarfati expliquent que l’emploi est devenu un « totem », le leimotiv des politiques néolibérales : mieux vaut l’emploi que le chômage ; et peu importe si pour cela vous devez composer avec l’incertitude prolongée, de faibles niveaux de salaire (quand le travail n’est pas gratuit) et des conditions dégradées.
Comme en écho à Deux siècles de rhétorique réactionnaire, de l’ouvrage d’Albert Hirschman (1991) analysant les discours conservateurs résistant à la mise en place de l’État-Providence, le « vent de réaction » qui souffle actuellement sur la société française et au-delà n’est ainsi pas sans conséquence sur les politiques de l’emploi.
Sous cet aspect, la dernière réforme de l’assurance chômage, votée au parlement fin novembre dernier, fournit un concentré des tendances à l’œuvre. Les conditions d’accès à l’allocation sont réduites. Il faut travailler plus longtemps pour pouvoir ouvrir ses droits : 6 mois sur les 28 derniers mois, contre 4 mois sur les 24 derniers mois auparavant. La modulation de la durée d’indemnisation en fonction du marché de l’emploi (le principe de « contracyclicité ») permet de durcir encore plus les règles lorsque la situation économique est bonne (et vice-versa). C’est aujourd’hui le cas par exemple pour le rechargement des droits, quand un allocataire est à nouveau en emploi durant sa période d’indemnisation. Il devra alors avoir travaillé au moins 6 mois contre 1 avant la réforme pour recharger ses droits. Enfin, les jours non-travaillés seront pris en compte dans le calcul du montant de l’allocation, ce qui la fera diminuer de fait pour les personnes en emplois courts.
Ces mesures sont donc pénalisantes pour les précaires. Et ce n’est pas le « bonus-malus » sur les cotisations patronales, pénalisant les embauches en emploi court et récompensant celles en emploi long, qui va sensiblement changer la donne, tant son périmètre d’application et ses effets s’annoncent limités. Alors que la hausse des prix du carburant et de l’électricité ampute une part croissante des budgets des ménages, et que le nombre de personnes sans domicile fixe a augmenté de moitié en 10 ans, on mesure ainsi le choix politique opéré : tout semble bon pour faire diminuer les chiffres du chômage et les dépenses publiques afférentes, dans un contexte où le « traverser la rue » pour trouver un emploi cohabite avec le « pognon de dingue » des aides sociales.
Le mythe de l’individu calculateur et réticent au travail
Plus profondément, tout ceci incarne l’idéologie dominante associant « valeur travail », mérite et responsabilité individuelle. En l’espèce, la réforme de l’assurance chômage, comme les précédentes, est fondée sur une image toute particulière de l’individu appliquée aux allocataires : l’« homo economicus ». Base de la théorie économique néoclassique, elle représente un individu informé, calculateur et stratège, maximisateur de ses ressources, qui orienterait ses comportements en fonction d’un calcul coût/avantages ou bénéfices. Dans cette logique, cet individu ferait, dans certains cas (suffisamment nombreux aux yeux des pouvoirs publics pour justifier le caractère impérieux des réformes), le « choix » ne pas reprendre un emploi.
De ce point de vue, pour pallier à ce type de comportement, il faudrait ainsi que le montant de l’allocation chômage soit davantage « incitatif », c’est-à-dire pas trop élevé pour amener l’individu en question à ne pas rester au chômage. C’est l’« activation » des dépenses sociales, censée servir le retour en emploi – et éviter d’être dans « le « curatif » pour reprendre une expression d’Emmanuel Macron prononcée en 2018. On est pleinement dans cette logique avec la mise en place, dans le cadre du plan France Travail du gouvernement, d’un RSA conditionné à 15 à 20h d’activité hebdomadaire dans des régions volontaires.
Les sciences économiques et sociales ont montré que de telles représentations (alimentant la culture du soupçon et la stigmatisation à l’égard des allocataires et bénéficiaires des minimas sociaux) et de telles mesures sont basées sur des prénotions et des présupposés erronés. En plus de réduire les droits sociaux des plus précaires et de renforcer leur contrôle, elles produisent de la pauvreté et – c’est intimement lié – du non-recours au droit[2] (au moins 40% pour le RSA). Mais aussi et surtout, l’image de l’individu calculateur et potentiellement réticent au travail est fausse. Des études sur les allocataires du RMI avaient déjà montré les limites des dispositifs d’incitation financière à la reprise d’emploi, au cœur de la logique des réformes de l’Unédic. Moins de 1% des allocataires évoquaient « la non-rentabilité financière du travail comme une raison empêchant de trouver un emploi »[3] ; et 40% de celles et ceux qui ont repris un emploi n’ont pas vu leur situation financière s’améliorer[4].
En résumé, le fait de retrouver un emploi est une motivation suffisante dans presque tous les cas, indépendamment du montant de l’allocation. Une recherche récente sur les salariées et salariés en contrats courts va dans le même sens. On y lit que l’emploi est leur principale source de revenus et préoccupation, et que le postulat infondé d’usages stratégiques de l’indemnisation par les allocataires cache un impensé des réformes : les différentes formes de non-recours aux droits[5].
Au final, idées reçues, associées à des enjeux gestionnaires (contrôle des dépenses) et moraux (« mériter » l’allocation et les aides sociales et montrer que l’on veut réellement un emploi), guident les politiques néolibérales « pour l’emploi ». Comme tout problème public, sa définition est donc partielle et partiale, et écarte d’autres alternatives. Le solidarisme, philosophie politique qui a inspiré les États-providence et qui pourrait par exemple s’incarner dans un revenu minimum pour les moins de 25 ans, perd ainsi du terrain.
Mais un second effet notable des récits récurrents sur le refus du travail – une « histoire vielle comme le capitalisme »[6] – est de faire écran sur d’autres réalités socioéconomiques cette fois-ci bien massives et coercitives. Ainsi du non-recours, mais aussi d’une intensification du travail générale à l’ensemble des secteurs d’activité qui s’accompagne d’accidents, de maladies professionnelles, de pratiques de harcèlement et de suicides[7]. Ainsi aussi d’une loi du marché de l’emploi de plus en plus sélective et concurrentielle, spécialement pour les jeunes et les moins diplômé.es, qui peuvent envoyer des dizaines de candidatures sans avoir de réponse, même négative ; et qui, quand ils et elles sont présélectionnées, doivent ensuite passer les épreuves parfois violentes de recrutement sans toujours comprendre les raisons de leur non embauche finale[8].
Une précarité durable
Car, de façon structurelle, ce qui conduit massivement au chômage, et de façon répétée ou prolongée, c’est le « précariat ». Celui-ci n’est pas à la Une de l’agenda politique. Il pose pourtant des questions qui touchent au cœur des mécanismes d’intégration et de cohésion sociale. Le précariat regroupe les nombreuses personnes en quête d’un emploi et celles installées dans ce que nous appelons la précarité durable. Comme les saisonniers et saisonnières agricoles et les artistes du spectacle auprès desquels nous avons enquêté dans le cadre d’un récent ouvrage[9] – pensons aussi aux intérimaires du bâtiment, aux autres intermittent.es, aux vacataires, aux saisonnières et saisonniers de l’hôtellerie-restauration, entre autres –, un pan important de la population active est maintenu dans une zone intermédiaire entre emploi et chômage, entre activité professionnelle et assistance publique, et ce sur le long terme.
La part des personnes n’ayant pas de contrat à durée indéterminée (CDI) diminue depuis plusieurs décennies (un peu moins de 14% en 2018). Les emplois sont en de plus en plus courts. Les CDD de moins d’un mois sont une norme d’embauche. Et il est de plus en plus difficile d’accéder au CDI dans un avenir proche. Selon France Stratégie, en 1982, presque la moitié des salariés en CDD obtenaient un CDI trois ans après ; un sur cinq en 2014. Ajoutons à cela les « faux indépendant.es », comme les livreuses et livreurs à vélo des plateformes, œuvrant souvent dans des formes d’emploi hybrides à l’écart des collectifs et des régulations du salariat[10].
Autrement dit, la précarité ne se réduit pas à une chute sociale (l’image du cadre licencié sombrant dans la pauvreté) ou à un sas vers le CDI (le « passage obligé » des jeunes enchaînant apprentissage, stages, CDD) : elle renvoie plus globalement à une « condition d’insécurité sociale durable »[11]. Et les stables ne sont pas épargné.es, déstabilisé.es par des politiques de flexibilité qui font varier les niveaux de rémunération « au mérite »[12] ou qui favorisent les licenciements même quand vous êtes performant.e[13]. Cela, d’autant plus qu’une « armée de réserve » peut récupérer votre poste si vous n’êtes pas satisfait.e ; ce qui peut conduire à rester dans un travail qui menace sa santé par crainte de se retrouver sans emploi[14].
La dernière réforme de l’assurance chômage n’est pas seulement à contre-courant de ces contraintes sur le marché de l’emploi. Elle ajoute aussi des difficultés supplémentaires dans l’accès à l’allocation en appuyant les attentes et intérêts du pôle employeur. Il sera possible de supprimer son versement après avoir refusé deux CDI. Deuxièmement, il n’est plus possible d’ouvrir des droits au chômage après un abandon de poste. On enlève ainsi la possibilité à celles et ceux qui, ne pouvant négocier de rupture conventionnelle avec leur employeur, se retrouvent enfermés dans un travail qui met leur santé en danger par crainte de se retrouver sans revenus en cas de démission.
Ironie, ou comble selon les points de vue : alors que l’accès à l’emploi et à l’emploi stable est de plus en plus difficile, on sanctionne de plus en plus les précaires, coupables, dans un marché pourtant censé être « libre », de le refuser. C’est aussi un cas exemplaire d’individualisation – au détriment des salarié.es : nous aurions affaire non pas à un problème structurel construit de longue date, à un manque d’emploi (une « pénurie » ?), mais à un problème personnel de « motivation » ou d’« intérêt » à travailler.
Le précariat et ses effets fragilisants constituent autant d’angles morts, ou en tous cas secondaires, de l’agenda politique du moment. Au plus fort de la crise du Covid, Emmanuel Macron avait appelé, pour construire le « monde d’après », à « tirer les leçons du moment que nous traversons » et à prendre des « décisions de rupture ». Sur l’emploi au moins, il fait tout le contraire, aggravant un fait social qui ne doit rien au hasard ou à la fatalité, mais relève de décisions politiques.
NDLR : Nicolas Roux a récemment publié La précarité durable. Vivre en emploi discontinu, aux Presses universitaires de France
