D’un long fleuve intranquille – sur « Al río / To the River » de Zoe Leonard
Avec « Al río / To the River », l’artiste new-yorkaise Zoe Leonard invite à un parcours singulier, dans l’exposition et dans la géographie de l’Amérique, un parcours au fil d’un flux photographique paradoxal, et du flot d’un fleuve légendaire. Dans le Musée d’Art moderne de Paris, les salles de l’Arc, leur enfilade et le grand méandre qu’elles dessinent se voient traversées par la ligne têtue tracée par quelques 300 tirages photographiques presque exclusivement en noir et blanc.
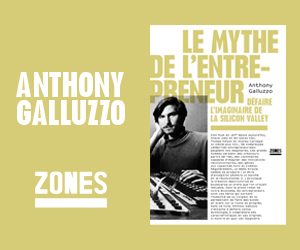
D’un format régulier et plutôt modeste, les photographies sont regroupées souvent en séquences, composées de 4, 5 ou 6 images paysagères, séquences qui offrent l’esquisse d’une narration minimale. Toutes s’attachent à une figure centrale, celle du fleuve, dans un regard à la fois très ancré et descriptif, mais surtout métaphorique et mental. La double identité de celui-ci fait titre de l’exposition et annonce une dualité portée par les langues : « Al río / To the River ». Fleuve bilingue, fleuve frontière, on aura appris à l’entrée qu’il s’agit du Río Grande, ou du Rio Bravo, selon la rive où l’on se tient.
Un fleuve associé à cet espace sensible, qui apparaît régulièrement dans l’actualité du monde comme ce site où se frottent deux Amériques, deux mondes que l’histoire a faits confrontationnels au point d’y voir pousser un monument, de ce genre de monuments d’une nature dirimante dont la planète se couvre : un mur. À l’âge des migrations, nouvelles et anciennes, des circulations marchandes, légales et illégales, aux échelles planétaires, la frontière entre les États-Unis d’Amérique et les États–Unis mexicains est une zone hyper-sensible, enjeux de réalités humaines, politiques, diplomatiques, écologiques massives.
C’est pour vivre une partie de l’année à une centaine de kilomètres du Rio Grande, à Marfa, petite ville du Texas devenue repère pour le monde de l’art contemporain depuis l’installation de sa fondation dans les années 1970 par Don Judd, que Zoe Leonard s’est déterminée à engager, en 2016 et pour quatre ans, une expérience vécue sur le terrain. L’administration Trump ne manquait pas alors de tisonner ce contexte déjà brûlant.
Comme pour nombre d’œuvres précédentes de l’artiste, l’expérience est vécue avec et au travers un appareil photographique. Inscrite dans un héritage conceptuel et un engagement toujours politique et souvent militant, la vision ouverte par l’artiste s’en tient ici à une position réfléchie et articulée, dans la suite d’une démarche qui porte le style documentaire bien loin, et simultanément à un doigt du photojournalisme.
Le choix technique, un boitier Nikon avec un objectif 35 mm, « comme les journalistes du XXe siècle » précisera-t-elle, est affirmé et revendiqué, comme celui du film argentique, avec ses qualités et contraintes, dont la retenue sur la fréquence du déclencheur et l’exigence de cadrage, dont témoigne le liseré noir sur la marge blanche des tirages. La matérialité du tirage photographique est manifeste aussi dans le mode d’accroche choisi, rudimentaire et efficace, simple vitrage tenu par quatre crochets vissés qui laissent son mouvement au papier sensible.
Loin cependant d’un fétichisme nostalgique ou d’une coquetterie technique, ces choix contribuent à une recherche de distance propre qui traverse le projet, et trace le contour ouvert d’une démarche rigoureuse. Une rigueur qui refroidira le regard hâtif ou impatient du visiteur, trop vite lassé par la linéarité de l’exposition : on peut le comprendre. Mais suivre plus loin Zoe Leonard donne une toute autre épaisseur au point de vue qu’elle entend partager en exposant les images, qui se dédouble encore dans le livre qui, plus qu’un catalogue, est une version complémentaire du projet[1].
L’objet éditorial est ambitieux : d’un côté, en quelque trois cent pages, une sélection élargie des séries photographiques, album composé mais aussi muet que l’exposition. Les images n’y sont pas plus légendées, et le parcours du regard n’est guidé par aucun indice de localisation : dans le livre comme dans l’exposition, le cours du fleuve n’est pas un itinéraire linéaire qui suivrait le flot selon les réalités naturelles ou humaines identifiées, localisées. Son unité d’album tient avant tout dans l’opération de sélection et de montage d’un ensemble de plus de cinq cent clichés.
Unifié par le noir et blanc, par les angles de vue et les grosseurs de plan, le fleuve est un, dans une continuité héraclitéenne, ni impétueux ni même spectaculaire, et moins encore pittoresque. Des 3 000 kilomètres de son cours, dont 2 000 tracent la frontière politique entre les deux états fédéraux, l’artiste constitue une entité abstraite qu’elle incarne par l’accumulation de détails saisis dans des plans larges, de fragments, dans un paysage sans ici identifié, suspendu dans un temps figé, dans une lumière étale et forte, que renforce le contraste du noir et blanc. Une lumière du midi, qui fait peu d’ombre mais fait percevoir la chaleur.
Zoe Leonard n’a rien perdu de l’exigence conceptuelle ni de sa vigilance d’activiste.
Quant aux figures humaines, elles sont toujours des détails dans le champ de vision. La photographe s’en explique sans ambages : plus de visage, plus de présence, ce serait participer à la saturation d’images inquisitrices qui truffent l’ordinaire de frontière sous surveillance ; ce serait participer de la dramatisation que l’image médiatique entretient. Les vivants sont des silhouettes, hommes et bêtes, car de cet espace du fleuve, c’est sa nature profondément hétérotopique de lieu de passage, tout à la fois habité et traversé, que scrute l’objectif : tout y est fait pour contraindre et contrôler le passage, déterminant un no man’s land occupé.
Le fleuve est au centre, bien sûr, dans sa qualité de frontière naturelle, si l’on peut s’autoriser un tel oxymore, qui superpose géologie et fait politique. L’objectif s’attache aux éléments construits, architectures de connexion, ponts, routes ; aux vides, très relatifs, aux zones intermédiaires, tant urbaines que rurales, aux constructions, ici habitations, là infrastructures techniques. Les silhouettes, de dos, de loin, sont dispersées dans l’espace. Ce seront là celles des baigneurs, surtout des enfants, dans des zones pourtant bien peu balnéaires ; ce seront celles d’animaux, vaches, chèvres, chevaux, oiseaux ; ou celles d’un cavalier solitaire, de quelques groupes d’hommes et de femmes, dans leur mouvement ou leur attente ; et souvent celles de policiers, douaniers et gardes de tous grade, eux aussi anonymes, réduits à leur costume et aux outils du contrôle.
Ainsi, à tout instant dans les paysages, les véhicules de police, postés non loin du fleuve, en surveillance, comme autant d’épouvantails, marquent la frontière comme des bornes flottantes, détails inscrits dans le champ élargi du paysage. Zoe Leonard se consacre ainsi surtout à ce qui n’est pas de l’ordre de l’événement, de l’incident, de l’anecdote, mais à ce qui, au contraire, relève de la banalité du suspend frontalier et de ses activités, de ses structures, de son organisation.
Mais au travers de sa description par le visible, c’est l’intensité des flux qui sourd des images ; c’est le non-visible de l’interdit, c’est le non-dit de la tension de l’attente fondue dans la trame de l’espace. Les signes pourtant ne manquent pas : barbelés, grillages, palissades et autres murs, chantier permanent, prouesses de construction pharaoniques et dérisoires, qui découpent des espaces vides de routes, de points de passage, de zones désertiques, laissés à la nature mais traversés de chemins. C’est dans ce vide très plein, très dense, que le regard s’inscrit, ce vide résolument politique, que balisent ces miradors mobiles, tours de guet connectées qui renvoient avant tout à ce que l’on ne voit pas forcément, mais que l’on sait. Une invisibilité faite concrète, faite matière : le champ du contrôle contient toutes les possibilités de ce sur quoi il veille.
Zoe Leonard n’a rien perdu de l’exigence conceptuelle ni de sa vigilance d’activiste. En inscrivant sa démarche le champ de l’image de terrain, elle s’inscrit aussi dans cet héritage du paysage américain, entre photographie et géographie, ce qu’après John Brinckerhoff Jackson on désigne comme le paysage vernaculaire. L’auteur de À la découverte du paysage vernaculaire[2] entendait se consacrer à la recherche de « l’homme habitant », par une exploration à la fois pratique et théorique des paysages. Pour Jackson comme pour Zoe Leonard, l’appareil photographique est un opérateur de terrain et une notation pour une mémoire critique, et pour nourrir par l’accumulation, par la série, un regard analytique. Un regard qui se retrouve dans d’autres séries de l’artiste.
Ainsi, l’ensemble de quatre cent douze photographies intitulé Analogue[3] capte d’abord les transformations du Lower East Side de Manhattan qu’habite l’artiste, qu’elle élargit ensuite à une aire plus grande, en passant par l’Afrique et le vieux continent. La boucle du local au global qu’entretiennent les nouvelles formes de colonialisme s’inscrit dans le spectacle de la rue, ou plutôt son décor. Les quatre cent douze façades de boutiques frontalement cadrées en portent les symptômes, par les sigles et marques, de la circulation des produits et des pratiques du commerce de rue.
Avec Al río / To the River, Zoe Leonard touche aussi à l’hodologie, cette pratique du paysage qui s’attache à l’observation des voies, routes et chemins, de leur conception, leur représentation et leur expérience. Une expérience qui pour l’artiste prend forme de parcours et d’itinéraires, exerçant à l’envi sa liberté, celle de circuler. Elle traversera souvent la frontière, pendant les quatre années de son projet, prenant des vues des deux côtés, se situant elle-même dans le passage.
L’aspect analytique de la démarche n’entache jamais la nature des images, qui s’en tiennent à autant de positions précisément choisies, sans velléité d’épuisement dénotatif du réel par la captation, pour nourrir par le regard et l’intuition fragmentaire une production de savoirs situés. Situés très concrètement, non au sens cartographique, mais en termes de distance, de hauteur, d’angle de vue, de perspective. Mais situés aussi comme position dans les champs de savoirs, positions portées par une exigence réflexive quant au point de vue.
On empruntera d’autant plus volontiers ce terme de savoirs situés en pensant à ses ancrages du côté de la théorie féministe, familière à l’artiste ; en pensant au déplacement de point de vue que requérait Donna Haraway dans les champs scientifiques d’abord, à partir du regard féministe. Zoe Leonard y répond précisément, mais non sous les formes directes, comme c’était le cas pour l’artiste dans les années 1980-1990, avec l’engagement contre le SIDA, avec l’activisme queer et lesbien, avec la vigilance sur les discriminations de toutes natures. Le rôle accordé au cadre dans le geste photographique, à la fois affirmation de présence et limite affirmée de celle-ci, relève d’une éthique, tout autant que d’une pragmatique politique.
Situés, les savoirs sont aussi partagés, et le projet Al río / To the River est le fruit d’un tel partage de points de vue : ceux des experts, chercheurs et essayistes ; ceux des témoins, au travers des récits de vie. Le second tome de la publication déjà mentionnée l’affirme clairement. Conçu par un poète et écrivain, Tim Johnson, complice de la démarche de l’artiste, ce volume-là ne contient que du texte, par une vingtaine d’auteurs.
Ceux-ci apportent leurs savoirs spécifiques ou leur écriture : ce sont des pans entiers de l’imaginaire du fleuve que les auteurs tressent, de ce fleuve-ci, déjà double, et Grande et Bravo, et plus loin de ce que font les fleuves à ceux qui les vivent, qui vivent autour d’eux. Le plus souvent sans référence directe au regard de la photographe mais plutôt en parallèle à celui-ci, les auteurs parlent ce que la photographe inscrit dans le silence de l’image photographique.
Sur le mode descriptif ici, allégorique là, forts des croisements de méthode des études culturelles à l’américaine, les textes nourrissent cette figure multiple du fleuve et des fleuves, même si la plupart des auteurs restent ancrés dans leur réalité géologique, en particulier dans la proximité avec le fleuve. Les voix croisées des textes mettent des mots et des savoirs multiples sur la manière dont le fleuve opère dans l’espace-temps des vivants ; ils manifestent la monumentalité invisible du fleuve, monumentalité dont Zoe Leonard évite tous les signes manifestes : elle construit ainsi bien plus, non un anti-monument, mais peut-être un contre-monument.
Au travers des entrées du sommaire, le monument invisible est traversé de personnages et de lieux, d’événements et de gens, d’histoire et d’Histoire. C. J. Alvarez, enseignant chercheur au Texas (Mexican American and Latina/o Studies), dans sa « Brève histoire du fleuve », retrace l’histoire longue du fleuve et constate son devenir accéléré d’entité géologique singulière. Il note : « Les Américains l’appellent Rio Grande, “grand fleuve” ; les Mexicains, Río Bravo, “fleuve sauvage”. À présent il n’est ni l’un, ni l’autre. » Il précise plus loin : « Il a suffi de deux générations ayant connu les grands jours du génie hydraulique moderne pour déclarer la guerre à presque tous les cours d’eau du continent. »
Un génie en effet qui, sur les quelque 3 060 kilomètres du fleuve, s’est échiné à le faire démériter de ses noms, puisque « bon nombre des projets de constructions le long du fleuve furent conçus pour le maintenir en place, contrer son imprévisibilité, et l’assimiler à une frontière terrestre ». L’ampleur de l’entreprise laisse songeur en effet.
La domestication du fleuve, coupable d’un cours dispersé et méandreux, lui a valu, à coups de grands travaux débutés dès les années 1930, coupant certains de ses méandres, d’être à ce point rectifié qu’il s’en trouve raccourci de 106 kilomètres. Alvarez rappelle comment, après la guerre de conquête de 1846, les USA déplacèrent la frontière du Mexique. Il fut alors décidé qu’à partir d’El Paso, en venant de l’Ouest, jusqu’à la mer, la frontière théorique suivrait le lit le plus profond du fleuve.
Dès lors, ses berges, pour le contenir, pour l’exploiter, se sont profondément transformées, sacrifiant les modes de vie et de subsistance y compris dans les zones désertiques qu’il irrigue, aux dépens des populations d’origine. Retenues, réservoirs, barrages, dérivations ont alors formé un paysage humain, agricole, industriel et bien sûr politique unique. Alvarez dit encore : « La frontière fluviale […] est désormais aussi une zone militarisée. Clôtures, caméras, radars et policier.ères peuplent ses rives états-uniennes ».
Analyses, témoignages et références documentent et articulent, là où Zoe Leonard cerne par l’image et attire le regard sur l’impensé de la violence paysagère ordinaire.
Dans sa contribution intitulée « Cours, tracé, flux », Darby English relève que Zoe Leonard « s’est attachée à observer et à photographier autant qu’elle le pouvait une région où, contre toute logique, fleuve et frontière partagent une même fonction et sont envisagés comme une seule et même chose, alors que l’un multiplie et divise continuellement les réalités de l’autre ». Le projet de l’artiste, précise le professeur d’histoire de l’art contemporain, est traversé par « l’interaction fleuve/frontière – une fiction juridique, théâtre de flux et de forces qui incommode les juristes tout autant qu’elle dénature l’essence du fleuve ».
Les auteurs choisis par Tim Johnson sont pour la plupart tantôt acteurs tantôt témoins de la condition de frontalier sur cette scène élargie que l’on a fait dessiner au fleuve. La circulation des corps, des biens, des informations met en œuvre partout la confrontation des langues.
Elisabeth Lebovici, historienne et critique française, relit l’œuvre de Gloria E. Anzaldúa, théoricienne engagée, essayiste et poète, auteure de Borderlands/La Frontera: The New Mestiza[4]. Anzaldúa y travaille sur ce que construisent au regard des questions féministes, queer, de genre et d’identité, l’expérience des zones frontières, celle du Río Bravo en particulier. Elle s’est ainsi appuyée sur son expérience personnelle de chicana dans le monde universitaire et la société des États-Unis.
Elle a soutenu l’ambition très débattue d’une « new mestiza », d’une nouvelle métis. Elisabeth Lebovici précise : « Si l’actualité de la mestiza apparaît ainsi comme capitale sur ce continent [l’Amérique] qui, comme les autres, dresse des frontières contre l’immigration, c’est parce que sa méthodologie du langage est celle du lien, opérant au contact, dans un bord à bord des idiomes. La border-langue est un travail de couture d’une mestiza conçue comme une texture commune. » Et de mesurer combien cette frontière produit des barrières dans la langue et dans les réalités sociales ; mais aussi qu’elle nourrit, en invitant « à traverser de multiples frontières de langage […], la conscience de la mestiza ». Elisabeth Lebovici précise encore : « La langue d’Anzaldúa se dérobe à toute appartenance, toute affiliation. Avec elle, nous apprenons, en tant qu’Européen·nes, que les frontières entre États-nations sont une invention, une imposition. »
Au fil du volume, d’autres analyses, témoignages, références documentent et articulent là où Zoe Leonard cerne par l’image et attire le regard sur l’impensé de la violence paysagère ordinaire. Elle rend sensible des confrontations éminemment locales tout autant que globales. Le rôle de l’image et l’exigence des choix visuels de l’artiste s’imposent dans la construction d’un récit nécessairement fragmentaire.
L’écriture photographique en noir et blanc prend pour le visiteur une nouvelle dimension en se confrontant à trois moments du parcours qui s’imposent par la couleur. Une série de sept gros plans de plantes sauvages, offrant au désert la résistance des couleurs de la fleur ; une autre série de vingt images dans l’accrochage parisien, là encore en gros plan, plongeant sur la surface tumultueuse d’une eau tourbillonnante, la matière même du fleuve, qui offre l’apparence d’une peau blessée et de cicatrices vives, en mouvement. La série, presque abstraite, impose une sensibilité organique dans le paysage, douce et menaçante : celle du trouble, de ceux avec lesquels « on vit », pour paraphraser Haraway.
Un trouble que fige, en forme de clôture dans le déroulement de l’exposition le dernier groupe d’images imprimées en couleur, intitulé Coda : une petite vingtaine d’images fixes extraites du flux accessible sur Internet d’une caméra de contrôle postée sur le cheminement d’un passage piétonnier d’un poste-frontière. Cette série boucle le parcours, non sans amertume, sur la diversité des enjeux et des usages de l’image, des regards sur cet espace, si prégnant si fuyant, du fleuve.
Zoe Leonard, « Al río / To the River », du 15 octobre au 29 janvier au musée d’Art moderne de Paris. Exposition conçue en partenariat avec le Mudam Luxembourg où elle a été présentée au printemps 2022.
