Produire des sondages dans un monde marchand
Les sondages d’opinion sont un objet ambivalent. D’un côté, leur omniprésence permet de les comparer aux « prévisions météorologiques[1]», devenues tellement banales qu’elles font partie du quotidien, sans que personne n’y prête vraiment attention. Dans le même temps ces chiffres occupent une place essentielle dans l’actualité politique et médiatique. Une littérature abondante en sociologie et science politique s’est attachée à pointer les limites et les biais de cet instrument ainsi que ses effets sur le monde social. Nous proposons ici un regard nouveau sur les sondages en nous tournant vers les coulisses de leur fabrication. Être en mesure de comprendre les sondages, de les utiliser mais aussi les critiquer implique de cerner l’univers dans lequel ils sont produits et de les réencastrer dans un ensemble de relations économiques. Les sondeurs et sondeuses ont une longue histoire, à la jonction des mondes scientifique, économique et politique.
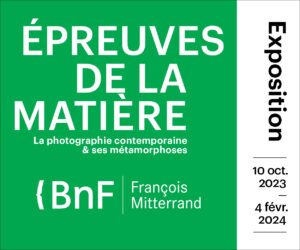
En s’appuyant sur les progrès de la théorie statistique et sur des travaux académiques issus de la sociologie et de la psychologie sociale du début du XXe siècle, les premiers entrepreneurs de la profession sont parvenus, à partir des années 1930, à imposer un instrument nouveau. Celui-ci répondait d’abord au besoin croissant d’un capitalisme en pleine transformation d’ouvrir de nouveaux marchés et de mieux connaitre le profil des consommateurs et consommatrices. Habilement, les sondeur·se·s ont parallèlement développé un discours présentant le sondage comme un atout pour la démocratie : grâce à lui il était désormais possible de connaitre l’opinion du plus grand nombre, sur tous les sujets, sans devoir attendre la tenue de scrutins très espacés dans le temps.
Cette promesse de fournir à la société des données fiables, issues d’un procédé scientifiquement établi et visant à stimuler et renforcer la pratique démocratique, se trouve profondément ancrée dans le profil des sondeur·se·s et la structuration progressive de la profession. Aux États-Unis comme en France, les premiers sondeurs sont certes des chefs d’entreprises, mais ils sont d’abord des universitaires, bien intégrés dans le champ académique. Certains projettent d’ailleurs de fonder une science de l’opinion publique, même si cette aspiration n’a finalement jamais été menée à son terme. La culture professionnelle des sondeur·se·s d’opinion repose donc en grande partie sur deux piliers : l’utilisation de méthodes scientifiquement établies et une utilité sociale revendiquée (production de données « utiles à la démocratie »).
Aujourd’hui, le secteur des sondages s’est grandement autonomisé du monde académique. Si des collaborations persistent entre sondeur·se·s et sociologues ou politistes – réalisation d’enquêtes, participation à des colloques, co-rédaction d’ouvrages, etc. – elles sont relativement marginales. Produire des sondages et quantifier l’opinion publique s’inscrit ainsi avant tout pour ces professionnel·le·s dans une perspective commerciale.
Habilement présentés comme des « instituts », les organismes de sondages sont en réalité des sociétés appartenant au secteur privé. À ce titre ils font face à un ensemble de contraintes propres à ce secteur : objectifs de rentabilité, recherche de débouchés commerciaux, gestion de la concurrence, etc. Cette réalité confronte les sondeur·se·s à des injonctions qui peuvent être opposées à celles dictées par la profession elle-même. Être un·e « bon·ne sondeur·se·s » et un·e « bon·ne salarié·e d’un institut de sondage » peut ainsi relever de logiques antinomiques.
Avant d’aller plus loin, il n’est pas inutile d’essayer de répondre à une question simple : qu’appelle-t-on un « institut de sondage » ? Le terme « institut » évoque évidemment un lien avec l’univers académique et une proximité avec des activités de recherche. Les représentations collectives l’assimilent ainsi à des organismes agissant dans le domaine des sciences dites « dures » – on pense par exemple à l’Institut Curie ou l’Institut Pasteur – ou à des institutions publiques prestigieuses – l’Institut national de la statistique et des études économique, l’Institut national des études démographiques, etc. Enfin, le terme « institut » renvoie aussi à des associations de réflexion de type think tank : l’Institut Montaigne, l’Institut Rousseau, l’Institut La Boétie, etc.
Pourtant, il ne correspond à aucune réalité juridique : les instituts de sondage sont des entreprises privées, évoluant dans le secteur plus large des « Études de marché et sondages », qui regroupe, en 2017, quelques 2 300 entreprises pour un chiffre d’affaires avoisinant les 2 milliards d’euros. On dénombre en France une dizaine d’instituts de sondage.
Si peu d’instituts se partagent le marché, il existe de grandes disparités entre ces entreprises. On peut d’abord distinguer les instituts « historiques » de ceux, plus récents, qui ont vu le jour avec le développement des sondages par internet. Ainsi, alors qu’Ipsos, Kantar (ex-TNS-Sofres), l’Ifop, CSA, BVA et Harris interactive sont plus anciens, Opinionway, Viavoice, Elabe et Odoxa sont tous nés dans les années 2000. Cette modalité de classement en recoupe une seconde – en partie du moins – plus pertinente pour la description du secteur. Il s’agit de classer les instituts en fonction de leur poids et de l’écosystème dans lequel ils s’insèrent. Ainsi, alors que certains appartiennent à de puissants trusts internationaux diversifiés, comptant des milliers de salarié·e·s à l’échelle mondiale, d’autres sont des PME voire des TPE de bien moindre envergure.
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, au sein de ce secteur, les sondages d’opinion représentent une faible part du résultat des instituts. En recoupant les sources et les informations, on peut estimer que ces sondages participent, en moyenne, à hauteur de 5 % à 15 % au chiffre d’affaires total de leur entreprise.
Le secteur des sondages est marqué par une importante division du travail, qui prend forme à plusieurs niveaux. Elle est d’abord interne aux instituts. Elle se traduit en premier lieu entre départements, correspondant aux différents secteurs de l’économie auxquels appartiennent les client·e·s potentiels (santé, luxe, services, numérique, etc.). Au sein de ces départements, on retrouve une nouvelle division du travail en « pôles » (ou « expertises ») qui correspondent à des sous-spécialisations, permettant de couvrir diverses thématiques. Enfin, les activités et la position hiérarchique constituent un dernier critère de division du travail. Si elle peut légèrement varier d’un institut à l’autre, cette hiérarchie s’étend généralement des stagiaires aux directeurs / directrices de département, en passant par les chargé·e·s d’études et les directeurs et directrices d’études, de pôle ou de clientèle.
La considérable baisse des coûts et du temps de fabrication d’un sondage conduisent à une explosion du nombre d’études commandées et à une éventuelle baisse de qualité de l’information donnée.
Il existe également une division externe, entre les instituts et d’autres entreprises, sur le modèle de la sous-traitance. Les sondages sont aujourd’hui principalement le produit de réponses par internet. Cette évolution a permis de passer une étape supplémentaire dans l’industrialisation de leur fabrication. La principale raison est évidemment une réduction très importante des prix mais également une forte diminution du temps de production. Quand il fallait auparavant plusieurs dizaines d’intérimaires pour passer des milliers d’appels téléphoniques afin d’obtenir les 1 000 ou 2 000 réponses nécessaires à l’établissement de l’échantillon souhaité, il suffit dorénavant d’envoyer un e-mail à un panel préalablement constitué. Commander un sondage devient dès lors beaucoup plus accessible et de nombreux médias, entreprises, associations ou partis politiques développent leur usage de l’outil. Apparaissent alors sur le marché des « panélistes », c’est-à-dire des entreprises spécialisées dans les panels pour les études en ligne dont l’activité consiste à fournir des « access panels » (fichiers qualifiés d’individus volontaires qui peuvent être rapidement interrogés) à leurs client·e·s, ces derniers étant essentiellement des instituts d’études.
À titre d’illustration, la plus importante de ces entreprises, Bilendi & Respondi, possède un panel de 2,5 millions de personnes et connait un développement considérable depuis plusieurs années. Si certains instituts de sondages possèdent leur propre panel, beaucoup externalisent la passation auprès de ces entreprises. Tout comme les instituts, ces dernières se prêtent à une rude concurrence qui les pousse à baisser les coûts. Cette pression à la baisse se répercute là encore souvent sur la qualité du travail (taux de sollicitation des enquêté·e·s élevés, moindre entretien des panels, etc.) et, in fine, sur celle des données produites.
Au sein des instituts de sondage, le travail est marqué par une relative autonomie des salarié·e·s[2]. En contrepartie, comme c’est souvent le cas dans ce type d’organisations dites « distribuées » ou « flexibles », le rythme de travail est particulièrement intense. La considérable baisse des coûts et du temps de fabrication d’un sondage conduisent à une explosion du nombre d’études commandées. Les sondeur·se·s doivent alors affronter un travail à flux tendu et gérer de nombreuses études simultanément. Ils et elles sont également soumis à des objectifs chiffrés qui conditionnent primes et promotions.
Sans s’aventurer ici dans le détail de l’histoire du secteur des sondages, on peut identifier une bascule importante au cours des années 1970-1980. Cette période correspond à la mise au centre de l’activité des études de marché, et à la perte de centralité des enquêtes d’opinion. Progressivement, ce mouvement s’est accompagné d’une croissance du contrôle managérial et, pour les instituts les plus importants, actionnarial. Ce phénomène n’est d’ailleurs pas spécifique aux entreprises de sondages mais se constate également dans de nombreux autres univers professionnels. Les sondeur·se·s d’opinion sont alors face à un choix. Certain·e·s – à l’image de Jean Stoetzel[3] et plusieurs de ses proches collaborateurs – décident de quitter une industrie qui ne leur convient plus. D’autres acceptent les évolutions du marché, intègrent ses contraintes et se plient (en partie du moins) aux nouvelles exigences que cela implique. Sur le long terme, ces évolutions semblent néanmoins bousculer les pratiques professionnelles.
Parfois les injonctions gestionnaires et managériales limitent directement les capacités des sondeur·se·s à être de « bon·ne·s professionnel·lle·s ». Un directeur d’études d’un institut de taille intermédiaire me raconte ainsi qu’il aurait eu des opportunités de progression de carrière « ailleurs », « dans de plus gros instituts », mais qu’il lui est impossible d’y être recruté en raison de sa mauvaise maitrise de l’anglais dans un contexte de standardisation et d’internationalisation de l’activité. Un directeur de pôle, également dans un institut de taille moyenne me détaille « l’enfer » vécu dans son ancien poste (au sein de l’un des plus gros instituts) où le temps passé pour chaque étude devait être scrupuleusement rapporté sur un tableur, dans un logiciel dédié. Un temps trop important (en fonction du montant du contrat) était sanctionné. Parfois c’est la taille de l’échantillon qui est réduite pour finaliser une étude dans des délais particulièrement contraints.
La capacité à faire son travail selon les canons de la profession se heurte donc à des injonctions qui émanent des employeurs, pour qui la principale préoccupation est de survire au sein de l’univers marchand et capitaliste dans lequel ils évoluent.
Mais il ne s’agit pas ici d’affirmer que ces injonctions abiment voire disqualifient de manière systématique et homogène la production des données de sondages d’opinion.
L’étude des réalités concrètes de travail permet en effet d’identifier les réponses qu’apportent les sondeur·se·s à ces situations de tension. On peut ainsi mettre en lumière le rôle de la culture professionnelle comme ressource essentielle pour arbitrer favorablement cette tension, lutter contre les injonctions des client·e·s et les réformes gestionnaires ou « encaisser » les moments vécus comme des échecs.
Cette approche invite également à mettre en lien la valeur des données d’opinion (au sens de leur qualité) avec leur valeur marchande, économique. Or les évolutions les plus récentes du secteur semblent plutôt s’orienter vers une diminution continue du coût des sondages, entrainant la dégradation de leurs conditions de production et, par suite, de leur qualité.
Pour finir, il me semble que l’analyse de ce secteur de la sociologie appliquée au domaine privé n’est pas sans fournir quelques enseignements pour d’autres univers professionnels. Ainsi pour proposer simplement deux parallèles, elle invite d’abord à se pencher sur le rapport entre qualité de l’information et conditions objectives de travail des journalistes, dans un cadre où la volonté de bien faire son travail (c’est-à-dire fournir une information de qualité) se heurte bien souvent à des politiques éditoriales et des pratiques gestionnaires imposées par les directions des médias qui, rappelons-le, sont dans leur immense majorité la propriété de chefs d’entreprises fortunés.
Mais cette grille de lecture nous conduit également à nous interroger sur le modèle contemporain de la production scientifique, dans un univers académique de plus en plus marqué par le manque de financement, la recherche par projet et la précarité qui en découle. Si l’on défend qu’on ne peut évaluer la qualité des données d’opinion sans prendre en compte leur contexte de production, il nous faut alors tirer le fil, et appliquer cette grille d’analyse au secteur public, qui n’est nullement exempt d’enjeux et de contraintes strictement économiques.
