Le Pakistan post-Imran Khan, entre vieux démons et populisme
L’une des tensions qui structurent la vie politique pakistanaise (à côté de celle qui oppose les tenants d’un pouvoir central fort aux adeptes du fédéralisme et les partisans du sécularisme aux hérauts d’un régime islamique voire islamiste) tient au conflit latent qui oppose l’armée et les leaders des partis politiques depuis au moins soixante ans. Cette lutte a récemment changé de forme après que les militaires – auteurs de trois coups d’État – aient renoncé à gérer le pays. Depuis les années 2010, ils préfèrent en effet laisser les civils s’en charger, tout en gouvernant à travers eux de manière à s’épargner l’administration du pays au quotidien – tout en défendant leurs intérêts en coulisses[1].
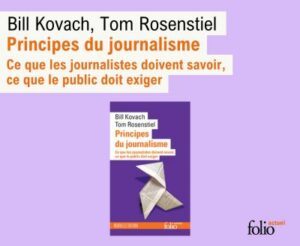
Ce mode de gouvernance a été inauguré sous la présidence d’Asif Ali Zardari (2008-2013) dont la relative docilité vis-à-vis des militaires a assuré à ce modèle une certaine pérennité. Mais ce dispositif n’empêche pas des phases d’instabilité politique lorsque le représentant du pouvoir civil – qui occupe en général le poste de Premier ministre – cherche à s’émanciper de la tutelle de l’armée. Celle-ci se considère alors trahie par l’homme qu’elle a aidé à conquérir le pouvoir – pour l’emporter sur ses rivaux des autres partis – et la tension entre le pôle civil et le pôle militaire montent alors très vite.
Ces tensions étaient restées modérées lorsqu’il s’était agi pour l’état-major d’évincer Nawaz Sharif. Celui-ci avait été soutenu avec succès par les militaires contre Zardari lors du scrutin de 2013, mais il avait ensuite cherché à négocier avec l’Inde de Narendra Modi en 2014-15, ce qui avait indisposé l’armée. Celle-ci avait alors décidé de laisser monter en gamme la campagne déclenchée contre lui après la publication opportune des « Panama papers » attestant ses pratiques corrompues. Sharif avait donc été condamné et destitué par la Cour suprême en 2017.
En 2019, il avait été autorisé à se faire soigner en Grande-Bretagne où il avait préféré resté plutôt que de retourner en prison – une option déjà éprouvée par nombre de ses prédécesseurs : au Pakistan, nombre de dirigeants déchus, qu’ils soient civils ou militaires ont connu un exil temporaire.
Pour le remplacer, l’armée avait soutenu un homme neuf, Imran Khan, l’ancien champion de cricket qui devait alors sa popularité croissante à son image de probité et à son nationalisme obsidional. En 2018, son parti, le PTI, remporta les élections pour la première fois de l’histoire du Pakistan, rejetant dans l’opposition les formations qui, depuis les années 1990 alternaient au pouvoir : le PPP de la famille Bhutto/Zardari et la PML(N) de Nawaz Sharif.
Mais Imran Khan, chercha à son tour à s’émanciper de la tutelle des militaires. Il se mit notamment en tête de reconduire le chef des services secrets, la toute puissante Inter-Services Intelligence (ISI), le général Faiz Hameed Chaudhry, au terme de son mandat en 2021, alors que ce genre de décision fait partie des prérogatives de l’état-major. En outre, les revers enregistrés par Khan sur le front de l’économie inquiétaient fortement les militaires dont le budget – colossal – se trouvait du coup menacé.
Les tensions opposant le Premier ministre au Chief of Army Staff, le général Bajwa, s’intensifièrent à l’approche du départ à la retraite de ce dernier, l’institution militaire craignant qu’Imran Khan ne la consulte pas au moment de nommer son successeur – comme la Constitution l’y autorise. L’état-major décida donc, à nouveau, de se débarrasser d’un encombrant chef de l’exécutif.
Un dispositif inédit
La formule politique adoptée pour remplacer Imran Khan tranche sur les expériences passées du même genre dans la mesure où, cette fois, l’armée n’a pas coopté un mais deux partis d’opposition pour faire pièces au Premier ministre. Si le PPP et la PML(N) avaient fait cause commune en 2008 pour évincer le général Musharraf du pouvoir, jamais encore ils n’avaient joint leurs forces contre un civil et convergé au point de gouverner ensemble, les deux partis se partageant les portefeuilles ministériels.
La PML(N) étant plus puissante que le PPP en raison de la base électorale qu’elle conservait au Punjab (alors que le PPP ne reste fort que dans le Sind), il lui revenait d’occuper le poste de Premier ministre. Mais le leader historique du parti, Nawaz Sharif étant en exil à Londres, c’est à son frère, Shahbaz, qui avait déjà gouverné le Punjab, que revint cet honneur.
La coalition formée par ces partis – baptisée Pakistan Democratic Movement – avait à cœur de reprendre le pouvoir et n’avait aucun scrupule à s’associer aux militaires pour cela. Il faut dire que la violence des propos d’Imran Khan vis-à-vis des Bhutto/Zardari et des Sharif a laissé des traces profondes. Le 10 avril 2022 Imran Khan devint donc le premier Premier ministre à devoir démissionner suite à un vote de défiance au parlement. Le 22 août la police l’arrêta ensuite en vertu d’une longue liste de chefs d’accusation, y compris ce qu’on appelle le « Toshakhana case » qui renvoie aux présents reçus par le Premier ministre (de la part de chefs d’État étrangers, de magistrats et de hauts fonctionnaires notamment).
La Commission électorale, chargée de l’enquête conclut à sa culpabilité et le disqualifia de toute fonction publique le 21 octobre 2022. Si ce scénario était assez classique, ce qui l’était moins, c’était le consensus entourant ce verdict, tant du côté de l’armée que de la PML(N) et du PPP, pour une fois à l’unisson. Le système judiciaire qui, au Pakistan, met un point d’honneur à affirmer son indépendance, fit toutefois relâcher Imran Khan en considérant que les charges pesant contre lui ne reposaient pas sur des preuves suffisantes.
Seul contre tous : le Pakistan face au syndrome populiste
En réaction, à cette décision, Imran Khan lança un grand mouvement de protestation qui fit la preuve de sa popularité, à l’instar des élections partielles que le PTI remporta haut la main. A l’automne 2022, Khan s’opposa à la nomination du général Munir à la tête des forces armée, comme Chief Of Army Staff, alors que ce dernier avait le soutien de l’institution militaire. Devenu COAS, Munir n’eut ensuite de cesse d’affaiblir un ancien Premier ministre dont la popularité l’inquiétait.
Résultat : Khan fut arrêté le 9 mai 2023 sous de nouveaux chefs d’accusation tout aussi spécieux que les précédents, mais les manifestations de soutien qui s’ensuivirent témoignèrent de l’hostilité que suscitait l’armée dans la population. Des bâtiments militaires furent en effet pris d’assaut et pillés, une première dans l’histoire des mouvements sociaux au Pakistan.
L’ampleur de la crise politique que connaît alors le Pakistan et la nature hétéroclite de la coalition qui fait face à Imran Khan ne s’expliquent que par cette donnée nouvelle : l’ascension d’un homme seul-contre-tous dans une logique populiste. C’est à cause d’elle que la vieille grille de lecture civils vs. militaires ne suffit pas à rendre compte de la situation actuelle.
Imran Khan incarne le répertoire national-populiste au même titre qu’Erdogan ou Modi (pour ne citer que deux représentants de ce registre politique aujourd’hui au pouvoir). Il a construit sa popularité sur sa prétention à défendre le peuple contre l’establishment corrompu qui l’opprime – et ce en tant que personnalité extérieure au jeu politique, une image que ses activités philanthropiques l’ont aidé à cultiver. Populiste, Imran Khan l’est aussi par son style consistant à systématiquement entrer en relation avec les Pakistanais sur le mode plus direct, voire intime, possible, généralement du haut d’une tribune à ciel ouvert.
Mais Imran Khan n’est pas un populiste comme Zulfikar Ali Bhutto qui avait utilisé ce répertoire sur le mode socialiste : c’est un populiste de droite, un national-populiste qui invoque sans cesse la religion et la patrie dont il se veut un défendeur acharné contre les puissances étrangères (à commencer par les États-Unis contre lesquels il avait fait campagne dès les années 2009-2010, au début de son ascension politique, alors qu’Obama multipliait les attaques de drones en territoire pakistanais). Son discours conservateur au plan culturel et social – assez déroutant étant donné ce que l’on sait de sa vie privée agitée – plaît à la classe moyenne urbaine, qui est bien sûr également séduite par son rejet de la classe politique et de ses méthodes corrompues.
Si cette catégorie sociale constitue le cœur de son électorat, la base électorale d’Imran Khan s’étend bien au-delà, comme dans le cas de bien d’autres national-populistes qui transcendent les clivages à la fois sociaux et ethniques. C’est d’ailleurs cette popularité tous azimuts qui effraye les partis traditionnels qu’Imran Khan vient concurrencer dans leurs chasses gardées.
Celui-ci souffre tout de même d’une faiblesse : dans un pays où le clientélisme reste une technique de mobilisation des électeurs à bien des égards incontournables, Imran Khan a été obligé de solliciter le soutien de nombreux notables pour permettre au PTI de prendre pied dans les campagnes. Or ces notables ont, dans bien des cas, cédé aux pressions de l’armée et déserté Imran Khan au cours des derniers mois.
Deux scénarios électoraux
Le scénario aujourd’hui le plus probable a de fausses allures de « remake », au sens où le PPP et la PML(N) s’apprêtent à rééditer le « moment 2008 » lorsque Benazir Bhutto et Nawaz Sharif s’étaient entendus pour se partager le pouvoir suite à l’annonce d’élections concurrentielles par Musharraf. Zardari et son fils, Bilawal ont en effet retrouvé Nawaz à Dubaï au mois de juin dernier pour finaliser le calendrier des élections, s’entendre sur l’identité d’un Premier ministre par intérim et se répartir les postes de responsabilité en cas de victoire.
Cette victoire est rendue plausible par l’affaiblissement du PTI et le soutien que la communauté internationale a apporté au gouvernement de Shahbaz Sharif. Celui-ci est en effet parvenu à décrocher un prêt de trois milliards de dollars auprès du FMI, une bouffée d’oxygène dont le Pakistan avait un besoin vital. Par contraste, Imran Khan apparaît isolé sur la scène internationale, non seulement du fait de ses saillies anti-américaines, mais aussi de son manque de crédibilité auprès des Chinois, des Saoudiens et des Émiratis, des acteurs de la vie politique pakistanaise qui sont en relation directe avec l’armée pakistanaise.
Ce scénario postule que le PTI sera mis hors d’état de nuire, une perspective raisonnable étant donné l’hémorragie qui continue de frapper le parti que désertent les lieutenants d’Imran Khan les uns après les autres, ses fidèles, eux, se retrouvant en prison.
La coalition formée par la PML(N) et le PPP se sont en outre donné du temps pour mieux faire pièces au PTI : juste avant que le mandat de l’assemblée nationale n’arrive à expiration, ils ont validé les statistiques du dernier recensement, obligeant la commission électorale à redécouper les circonscriptions électorales, un exercice qui devrait prendre des mois et reporter à 2024 les élections qui devaient avoir lieu à l’automne 2023.
Un autre scénario reste néanmoins possible : si Imran Khan est en position de faire campagne – sans nécessairement être candidat car la Commission électorale l’a déclaré inéligible pour 5 ans à l’automne 2022 –, il pourrait contrer les plans des partis « mainstream ». D’une part, certains caciques du PTI pourraient choisir d’y rester plutôt que de le quitter (comme Chaudhry Pervaiz Elahi, le président du parti qui, en prison, fait de la résistance) ; d’autre part – et surtout – Imran Khan pourrait perturber les calculs politiques de l’establishment civilo-militaire s’il appelait ses partisans à manifester, troublant ainsi le déroulement du scrutin, voire la légitimité des gouvernants – surtout en cas d’abstention massive.
La PML(N) et le PPP vont tout faire pour réduire ce risque. Non contents de rendre Imran Khan inéligible, ils vont s’efforcer de disqualifier le PTI. L’issue de ce bras de fer dépendra en grande partie de l’attitude du pouvoir judiciaire. À plusieurs reprises, Khan a bénéficié du soutien – relatif – de la Cour suprême. Celle-ci a ainsi décidé sa libération sous caution en mai dernier, alors qu’il venait d’être arrêté dans l’enceinte même du Tribunal d’Islamabad. La Cour rééditera-t-elle ce genre de décision après la nouvelle arrestation dont Imran Khan a fait l’objet le 5 août dernier ?
Dans le passé, le chef de la Cour a déjà affirmé son pouvoir aux dépens des leaders civils comme militaires. Dans les années 2000-2010, Iftikhar Chaudhry a mené la vie dure au général Musharraf puis à Zardari qu’il a accusés, respectivement, d’abus de pouvoir et de corruption. Les juges actuels auront-ils à cœur de jouer les troubles fêtes de la même manière ?
Dans ce cas, le Pakistan boirait le calice populiste jusqu’à la lie car Imran Khan jetterait ses dernières forces dans la bataille. Il faut souligner ici que cet homme se croit désigné par Dieu pour accomplir son destin, celui de Sauveur du Pakistan – et que sa détermination conforte encore ses partisans dans le soutien qu’ils lui apportent.
En outre, il pourrait être porté par les circonstances : au plan politique, les manigances d’un establishment désormais constitué de toutes les forces civilo-militaires – ou presque – ferait de lui, plus que jamais, le seul défenseur du peuple ; au plan économique et social, Imran Khan peut tirer parti de l’approfondissement de la crise qu’il a contribué à créer mais dont il ne sera pas tenu pour responsable au moment du scrutin faute d’être encore au pouvoir…
Implications intérieures et extérieures
Si le Pakistan est peut-être en train de tourner la page Imran Khan, la mise hors d’état de nuire de celui que la classe politique « mainstream » redoute tant aura eu un coût très élevé pour le régime. La PML(N) et le PPP se sont montrés tellement dépendants de l’armée pour parvenir à leurs fins que, dans ces conditions, ils ont dû faire des concessions lourdes de conséquences aux militaires – qui s’efforcent en permanence de gagner de nouvelles prérogatives.
De nouvelles lois – que les défenseurs de la démocratie qualifient de « scélérates » – reflètent l’immense pouvoir de négociation dont les militaires ont joui à la faveur de la crise récente. Premièrement, l’Official Secrets Act de 1923 a été amendé de telle sorte que les services du renseignement militaire (y compris l’ISI) peuvent maintenant, en toute légalité, sur la base d’un simple soupçon d’entorse au droit et sans mandat d’arrêt, non seulement mener des perquisitions étendues au domicile des intéressés, mais aussi recourir à la force et surtout les arrêter pour une période indéterminée.
Deuxièmement, l’Army Act de 1952 a été amendé de manière à formaliser le rôle de l’armée dans l’économie pakistanaise où les fondations de la marine, de l’armée de l’air et de l’armée de terre se sont taillées des prébendes en créant des entreprises en tous genres (y compris des banques). La loi énonce désormais :
« Pakistan Army may, upon direction or with the concurrence of relevant authorities of the appropriate government in the prescribed manner, directly or indirectly, carry out activities related to, inter alia, national development and advancement of national or strategic interest »[2].
Troisièmement, le parlement a voté le Board of Investment Act (2023) qui donne un rôle clé aux militaires au sein du Special Investment Facilitation Council, une institution destinée à attirer les investisseurs étrangers. Le COAS siégera aux côtés du Premier ministre dans l’instance dirigeante de ce SIFC, tandis que des hauts gradés peupleront toutes les instances exécutives.
Aucun gouvernement civil n’avait accordé une telle reconnaissance officielle aux militaires dans la gestion du pays et de son économie.
Les implications de la crise et de la sortie de crise en cours sur la politique étrangère du Pakistan sont moins significatives. Les civils n’ayant plus accès aux grands leviers de la politique étrangère depuis les années 1980, la continuité l’emporte toujours sur le changement tant que les militaires restent influents – et c’est ce que l’on a pu observer sous Imran Khan. Le COAS, Bajwa est ainsi demeuré un interlocuteur majeur des partenaires traditionnels du Pakistan, et en particulier des Chinois, des Saoudiens et des Émiratis.
Vis-à-vis des États-Unis, l’éviction d’Imran Khan introduit toutefois une certaine inflexion. L’anti-américanisme virulent dont il faisait preuve nuisait en effet aux relations entre les deux pays – d’autant plus que Washington ne pouvait pas ignorer les civils aussi facilement que Pékin et Riyad. Aujourd’hui encore, Imran Khan clame qu’il a été écarté du pouvoir suite aux manœuvres des États-Unis.
Le départ d’Imran Khan permettra peut-être aussi de continuer à détendre les relations du Pakistan avec certains de ses partenaires visés par les islamistes. Ceux-ci sont toujours prompts à s’en prendre aux pays accusés de blasphème ou de menées anti-musulmanes. Le Danemark et la France ont ainsi été la cible de groupes qui dénonçaient les caricatures du Prophète réalisées par des dessinateurs de ces pays. Imran Khan, qui a bien des affinités avec les fondamentalistes, a tendu à laisser ces groupes s’exprimer.
Le gouvernement qui a succédé au sien et, depuis août 2023, celui qui fait l’intérim jusqu’aux élections, ne partagent pas ses vues. Cela ne garantit toutefois pas qu’ils pourraient faire taire la rue si les islamistes cherchaient à mobiliser sur un enjeu sensible à l’occasion de ce qu’ils prendraient pour une provocation.
•
Le Pakistan ne sortira pas indemne de la zone de turbulences qu’il traverse encore. D’ores et déjà, l’armée en a profité pour accentuer le contrôle qu’elle exerce sur la société, l’économie et les civils qui gèrent le pays. De fait, les gagnants sont du côté de l’institution militaire qui, une fois de plus, aura réussi à utiliser des civils contre un autre civil en capitalisant – et c’est une première – sur le rapprochement de la PML(N) et du PPP contre un national-populiste.
Le Pakistan devrait donc voter en 2024 pour désigner un gouvernement civil davantage dominé par l’armée que ses prédécesseurs. De retour au pays le 23 octobre dernier après quatre années d’exil, Nawaz Sharif, qui, depuis Londres, pilotait déjà les négociations de son parti avec l’institution militaire, n’a pas saisi l’occasion de l’accueil triomphal que lui ont réservé ses partisans pour prendre ses distances avec l’armée : la façon dont celle-ci a orchestré sa mise à l’écart il y a six ans lui a sans doute servi de leçon, le futur homme fort du Pakistan, qui pourrait retrouver le poste de Premier ministre pour la quatrième fois sera probablement moins indocile que lors de son dernier mandat.
