Les assistants des magistrats, travailleurs de l’ombre
En novembre 2021, magistrats et fonctionnaires de greffe dénonçaient, dans une tribune signée par plus de 7 550 professionnels de la justice en trois semaines[1], des conditions de travail ne leur permettant pas de rendre une justice de qualité ni de trouver un sens à leur métier.
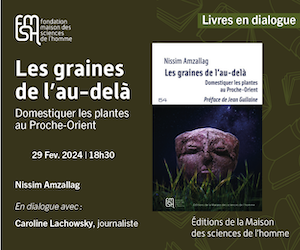
Cela a été l’élément déclencheur d’une « mobilisation générale de la justice » à l’appel des principaux syndicats de magistrats, greffiers et avocats – le syndicat majoritaire de magistrats judiciaires, l’Union syndicale des magistrats (USM), a même déposé pour la première fois un préavis de grève.
Cette mobilisation largement suivie est révélatrice d’un sentiment diffus de « crise de la justice » chez ces professionnels. Cette perception, si elle n’est pas nouvelle, se centre aujourd’hui autour de la question des conditions de travail au sein des juridictions, en particulier celles des magistrats de l’ordre judiciaire[2].
Face à ces protestations et afin de pallier rapidement les manques d’effectifs qui sont notamment tenus pour responsables de ces conditions de travail dégradées, le ministère de la Justice a renforcé la présence d’assistants des magistrats dans les cours et tribunaux. Ces personnels, qui soutiennent l’activité juridictionnelle en effectuant des tâches d’aide à la décision pour les magistrats et existent pour certains depuis les années 1990, constituent aujourd’hui selon le garde des Sceaux des éléments « indispensables » au bon fonctionnement des juridictions[3]. Il semble que l’image d’Épinal de magistrats travaillant de manière solitaire sur leurs dossiers ait ainsi vocation à être remplacée par celle de magistrats managers supervisant une « équipe juridictionnelle ».
Assistant des magistrats, une fonction en plein essor
La présence d’employés effectuant des missions d’aide à la décision n’est pas nouvelle au sein des palais de justice français. Le poste d’assistant de justice, créé en 1995 et étendu ensuite aux juridictions administratives en 2002, permet ainsi à des étudiants ou de jeunes actifs de travailler en juridiction deux à trois jours par semaine tout en préparant, souvent, des concours de la fonction publique. Les juridictions judiciaires s’attachent aussi les services d’assistants spécialisés, aux profils plus qualifiés, depuis 1998. Du côté des juridictions administratives, la Cour nationale du droit d’asile recrute des rapporteurs pour instruire les dossiers depuis le tournant des années 1990 (cette tâche étant jusqu’alors confiée aux auditeurs du Conseil d’État).
Mais c’est à partir des années 2010, dans un contexte de managérialisation de la justice[4], que l’intérêt pour ces personnels majoritairement contractuels se développe : ne nécessitant pas de longue période de formation comme les magistrats et les greffiers, ils sont envisagés comme un moyen de contribuer rapidement à la baisse des délais de jugement. Les effectifs des postes d’assistants existants augmentent donc et d’autres types de postes, à temps plein, sont créés (ou formalisés) : les assistants du contentieux dans les juridictions administratives ; les juristes assistants dans les juridictions des deux ordres ; et des contractuels de catégorie A, au sein des juridictions judiciaires, dans le cadre de la « justice de proximité ».
Malgré cette diversité de types de postes – à laquelle on pourrait encore ajouter les stagiaires –, ces personnels présentent plusieurs points communs qui justifient leur analyse conjointe. D’abord, ils effectuent le même type de tâches : ils trient, ordonnent et instruisent des dossiers, effectuent des recherches juridiques, écrivent des notes, synthèses et tableaux, préparent des audiences, et rédigent des projets de réquisitions ou de jugements qui sont ensuite utilisés, relus et corrigés par un magistrat. Ce sont ces missions communes qui permettent de les regrouper sous le vocable d’assistants des magistrats.
Un second point de convergence majeur concerne le profil de ces personnes : ce sont principalement de jeunes juristes qui sont encore en cours d’études, viennent d’être diplômés, ou disposent de quelques années d’expérience professionnelle. Ces postes sont en effet majoritairement temporaires (limités à six ans), et accessibles en sortie d’études (pour les assistants de justice, rapporteurs, contractuels « justice de proximité ») ou après un faible nombre d’années de travail (pour les juristes assistants). À ce titre, ils constituent souvent pour ces personnes un premier ou second emploi avant de transiter vers des postes pérennes – et plus prestigieux – du domaine de la justice.
Les effectifs de ces assistants des magistrats sont aujourd’hui en forte croissance. L’exemple le plus révélateur est celui des juristes assistants : créés en 2016, ceux-ci sont aujourd’hui plus de 1 100 (soit la deuxième cohorte la plus importante parmi les assistants des magistrats), et devraient être plus de 2 000 à la fin du quinquennat actuel[5].
Mais comment ces nouveaux acteurs professionnels du monde de la justice s’insèrent-ils dans des collectifs de travail jusqu’à maintenant composés de magistrats et greffiers ? Quels conflits de territoires, c’est-à-dire quelles luttes pour le contrôle de certaines connaissances et de leurs applications[6], se déploient-ils entre les différents membres de ces nouveaux collectifs de travail ? Comment, dans ce contexte, les assistants des magistrats tentent-ils d’assoir leur position ?
Une enquête menée actuellement auprès d’assistants, magistrats et personnels de greffe dans le cadre d’une thèse de sociologie permet de proposer certaines pistes de réflexion. Ce travail montre que l’essor des assistants des magistrats dans les juridictions françaises mène à des conflits de territoire entre plusieurs acteurs du monde de la justice : des magistrats qui veulent conserver la maîtrise de leur « cœur de métier », un personnel de greffe qui peut avoir le sentiment de se faire déposséder d’une partie de ses attributions, et des assistants qui cherchent à s’affirmer en tant qu’experts et futurs magistrats eux-mêmes. La mise en place de cette « équipe juridictionnelle » bouleverse ainsi les rapports que ces différents acteurs entretiennent avec leurs interlocuteurs et la vision qu’ils ont de leur propre travail.
Les magistrats ou la sauvegarde du « cœur de métier »
Le garde des Sceaux, dans sa présentation en janvier 2023 du plan d’action issu des récents États généraux de la Justice, expose les assistants comme le moyen, pour les magistrats, de « se recentrer sur [leur] cœur de métier, celui de décider après avoir écouté toutes les parties au litige »[7]. En suivant cette logique, les tâches confiées aux assistants semblent annexes, externes même, à la fonction de juge.
Mais si de nombreux magistrats estiment qu’ils ne pourraient plus se passer de ces assistants aujourd’hui, la présence de ces personnels est également critiquée. Certains magistrats regrettent ainsi, par manque de temps, de devoir leur déléguer des tâches qu’ils considèrent pourtant intéressantes, ou tout autant constituantes de leur « cœur de métier ». Marie, magistrate dans une chambre civile en cour d’appel, adore ainsi faire de la rédaction, qui constitue la majeure partie de son travail. À l’arrivée de juristes assistantes dans son service, elle a eu le sentiment de changer de métier, puisqu’elle n’avait rien d’autre à leur confier que la rédaction de ses jugements – au point même de se sentir destituée de son travail et de perdre la main.
La nécessité d’encadrer les assistants des magistrats – de devenir chef d’équipe – est aussi critiquée par certains magistrats qui estiment qu’ils n’ont pas choisi ce métier dans ce but. D’autant plus que si la question de l’animation des collectifs de travail commence à être abordée lors de la formation des magistrats judiciaires à l’École nationale de la magistrature (ENM), les magistrats ne sont en général « pas formés à travailler en équipe », selon Anne, jeune magistrate judiciaire.
En outre, l’essor des assistants fait craindre à certains magistrats de perdre le contrôle de leur prérogative, ce « cœur de métier » qu’est la prise de décision sur les affaires. Malgré la délégation aux assistants d’une part parfois très extensive du travail sur les dossiers, les magistrats cherchent ainsi souvent à mettre en avant leur propre responsabilité dans la prise de décision, et à minimiser le rôle des assistants en insistant sur le caractère uniquement « technique » de leur intervention. Le travail des assistants se trouve donc la plupart du temps invisibilisé – y compris de manière formelle, puisque leur nom n’apparaît que très peu au bas des actes qu’ils rédigent.
Le greffe ou le sentiment de dépossession
De prime abord, l’activité des personnels de greffe peut apparaître suffisamment éloignée de celle des assistants des magistrats pour ne pas susciter chez eux de craintes ou de ressentiment vis-à-vis de l’essor de ces nouveaux acteurs.
Certains assistants des magistrats effectuent pourtant bien, en pratique, des tâches de greffe (enregistrement des requêtes, communication entre les parties, rédaction des procès-verbaux, contrôle des délais et du formalisme des actes juridictionnels…). La plupart du temps, il s’agit de missions subsidiaires, réalisées en cas d’urgence : une audience dont la date est proche, un membre du greffe absent. 12% des juristes assistants font ainsi « ponctuellement du travail de greffe », selon un sondage réalisé par l’Association des juristes assistants de magistrats (AJAM) auprès de ses membres en 2022.
Si cette activité peut être vue positivement par le personnel de greffe qui est, tout comme les magistrats, en sous-effectif chronique, certains greffiers ont cependant le sentiment de se faire déposséder d’une partie de leurs attributions[8]. Alice, ancienne assistante de justice en cour d’appel, raconte ainsi s’être fait « taper sur les doigts » par une directrice de greffe pour avoir réalisé des statistiques à la demande de son magistrat encadrant – une tâche habituellement dévolue aux directeurs de greffe.
À ces craintes de voir certaines tâches de greffe reportées sur les assistants des magistrats s’ajoutent des critiques au sujet du statut plus avantageux de ces derniers. Alors que greffiers et assistants ont en pratique souvent le même niveau d’études, les postes de juristes assistants et de chargés de mission offrent en effet une rémunération et un niveau hiérarchique (catégorie A) supérieurs.
Ces inquiétudes ont en outre été exacerbées dernièrement par la récente loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice, qui prévoit la création d’un nouveau poste en remplacement des juristes assistants dans les juridictions de l’ordre judiciaire : les attachés de justice. Ces derniers, indépendamment des missions actuelles d’aide à la décision, pourront en effet également réaliser des tâches de soutien à l’activité administrative et d’appui organisationnel auprès des chefs de juridiction – ce qui pourrait englober des fonctions aujourd’hui dévolues au personnel de greffe.
Les assistants : des experts ?
Acteurs relativement nouveaux dans les juridictions françaises, les assistants des magistrats tentent d’y trouver leur place vis-à-vis d’interlocuteurs qui peuvent donc se montrer réticents, voire hostiles, à leur présence. Il s’agit alors pour eux d’assoir leur position en tant qu’interlocuteurs de valeur, voire d’experts, dans les dossiers et contentieux qu’ils traitent.
Si les magistrats et les acteurs institutionnels considèrent généralement que les assistants ont une fonction uniquement « technique », ces derniers jouent en réalité un rôle majeur dans le processus de traduction des faits en droit. L’utilisation du terme « technique » elle-même est à discuter : en travaillant sur les dossiers, même si ce n’est qu’en triant des pièces de procédure ou en remplissant des tableaux, les assistants participent bien au processus de production du droit.
Une part conséquente des assistants paraît d’ailleurs être incluse par les magistrats dans la prise de décision sur les affaires. Ils peuvent ainsi être invités à donner leur point de vue sur les dossiers traités lors de discussions informelles, et même à présenter leur analyse en séance d’instruction dans les juridictions administratives. Il est également très fréquent que les assistants rédigent eux-mêmes les actes (réquisitoires, jugements…) en autonomie, en proposant un sens de décision sans que le magistrat leur ait indiqué au préalable la direction à prendre. Enfin, certains assistants assistent et participent même aux délibérés. À titre d’exemple, lors d’une récente journée de formation organisée à l’ENM pour les juristes assistants de l’ordre judiciaire, les deux tiers des participants ont indiqué contribuer à la prise de décision sur les dossiers qu’ils traitent.
Cette situation ne correspond pour autant pas à tous les assistants des magistrats rencontrés. Beaucoup travaillent en effet sur des contentieux et des dossiers jugés répétitifs, rédigent seulement certaines parties préliminaires des actes, ou détiennent peu d’autonomie dans leur analyse des dossiers.
Le type de poste influe sur les tâches qui sont confiées à un assistant : les juristes assistants, qui travaillent à temps plein et détiennent au moins un an d’expérience professionnelle, sont par exemple globalement pensés comme plus compétents que les assistants de justice (étudiants ou jeunes diplômés employés à temps partiel). Mais d’autres paramètres entrent également en jeu.
Les assistants recrutés au sein de chambres traitant des contentieux jugés complexes, comme en matière fiscale, paraissent ainsi être fréquemment déjà spécialisés au moment de leur arrivée, et c’est même alors parfois l’assistant qui devient une source d’expertise pour les magistrats de la chambre. Ensuite, selon la taille de la juridiction, l’organisation du travail diffère : dans les petits tribunaux, la plus grande proximité avec les magistrats paraît favoriser une certaine montée en puissance des tâches confiées.
Si certains assistants se disent gênés lorsque les magistrats leur demandent leur avis sur les dossiers traités, estimant que cela les amène à outrepasser leurs fonctions, d’autres cherchent au contraire à mettre en avant leur propre rôle dans la prise de décision sur les affaires. Certains insistent par exemple sur le caractère succinct de la relecture de leurs projets de réquisitions ou de décisions par les magistrats.
Dans le même esprit, l’horizontalité des relations professionnelles entre magistrats et assistants est mise en avant par certains de ces derniers : pour Simon, juriste assistant au parquet du tribunal judiciaire d’une grande métropole, c’est « un travail collaboratif plus que d’assistance ». Cette posture peut enfin être associée à une critique des décisions rendues par les magistrats, comme à la Cour nationale du droit d’asile où les rapporteurs fustigent fréquemment des membres de formation de jugement « au ras des pâquerettes », pour reprendre une expression employée par l’une d’entre eux.
Les assistants : de futurs magistrats ?
Cette volonté, chez certains assistants, de gommer toute différence d’aptitude entre les magistrats et eux apparaît corrélée à leur ambition d’accéder à la magistrature.
De nombreux assistants souhaitent en effet intégrer cette profession : la quasi-totalité des assistants de justice préparent les concours externes de la magistrature administrative ou judiciaire, et une proportion importante des juristes assistants candidatent aux concours internes et recrutements sur titre à côté de leur emploi. Les postes d’assistants des magistrats sont même fréquemment promus, auprès des étudiants, comme un tremplin vers la magistrature ; et ce critère constitue d’ailleurs souvent la raison principale d’entrée dans ce type d’emploi.
Ces postes d’assistant semblent cumuler plusieurs qualités pour qui souhaite accéder à la profession de magistrat. Outre les contrats d’assistants de justice à temps partiel qui facilitent la préparation du concours en parallèle, ces différents postes permettent, selon les assistants interrogés, d’acquérir des connaissances et savoir-faire valorisés lors des écrits et oraux d’admission. Les places d’assistant de justice, voire de stagiaire, sont même très recherchées dans certaines juridictions d’où proviennent chaque année un grand nombre de candidats sélectionnés.
Être assistant semble effectivement pouvoir constituer un tremplin : ces personnels sont présentés comme un « vivier de recrutement important » pour les écoles de la magistrature et du greffe par le ministre de la Justice[9]. Les statistiques de l’ENM paraissent confirmer cette déclaration, une grande partie des admis, ces dernières années, ayant été assistants auparavant (en 2023, 54 % des admis au premier concours de la magistrature judiciaire étaient d’anciens assistants de justice[10]).
Il existe cependant un décalage entre ce qui constitue un bon assistant des magistrats et un bon candidat à la magistrature. Alors que les juridictions souhaitent avant tout bénéficier d’assistants efficaces, et donc spécialisés dans le ou les contentieux qu’ils pratiquent, les jurys de recrutement des futurs magistrats privilégient les candidatures de juristes ayant une expérience et des compétences diversifiées, puisqu’un magistrat se doit d’être généraliste.
En conséquence, les assistants cherchent à diversifier leur profil afin de maximiser leurs chances d’entrer dans la magistrature. Certains enchaînent ainsi différents emplois au sein des juridictions au fur et à mesure que leurs contrats se terminent. Le schéma classique est d’évoluer d’un poste de stagiaire vers celui d’assistant de justice, puis, dans les juridictions de l’ordre judiciaire, vers celui de juriste assistant. Mais lorsque certains de ces postes ne sont pas accessibles ou disponibles, ces juristes se tournent également – souvent par défaut – vers des postes qui ne relèvent pas de la prise de décisions de justice, mais des relations partenariales des juridictions (poste de chargé de mission), ou qui sont affiliés au greffe.
D’autres assistants tentent de changer de service ou de juridiction en cours de contrat pour diversifier les contentieux traités ; ils peuvent alors se heurter à des obstacles administratifs puisque les contrats sont fléchés pour une juridiction et un service donné.
Les frustrations engendrées par le décalage entre les envies d’intégrer la magistrature, les difficultés d’accès à cette profession, et les tâches confiées au quotidien contribuent à expliquer la prégnance chez les assistants d’une sensation d’effectuer le « sale boulot » des magistrats, c’est-à-dire des tâches considérées comme désagréables et dévalorisées[11]. Certains assistants interrogés, en particulier ceux ayant échoué aux concours de la magistrature, expriment ainsi leur sentiment d’être « frustrés », traités comme une « petite main », un « domestique », ou même un « chien ». Avec comme conséquence un turn-over important, causé donc non seulement par ceux qui intègrent la magistrature, mais également par les déconvenues, burn-out et bore-out.
Conflits de territoire chez les assistants
Pour assoir leur position au sein des collectifs de travail, à la fois en tant qu’experts sur les dossiers et futurs magistrats, les différents types d’assistants cherchent souvent à se démarquer les uns des autres.
Les juristes assistants, par exemple, regrettent souvent d’être pris pour des assistants de justice par certains magistrats ou greffiers, et considèrent, comme Anne, jeune magistrate auparavant juriste assistante, qu’ils se trouvent à un « palier supplémentaire » en termes de « réflexion ». À l’inverse, certains stagiaires et assistants de justice cherchent à mettre en avant leurs compétences en soutenant qu’ils effectuent les mêmes types de tâches que les juristes assistants.
Si ces deux postes semblent bien distincts dans leurs statuts, puisque les assistants de justice doivent réaliser des travaux « préparatoires » quand les juristes assistants « contribuent par leur expertise » à des dossiers « complexes »[12], les différences entre les types d’assistants des magistrats sont en pratique parfois minimes. D’un service ou d’une juridiction à l’autre, une même tâche paraît ainsi pouvoir être confiée à la plupart des types d’assistants, voire à certains contractuels de greffe, en fonction des postes ouverts dans les juridictions et des besoins au quotidien.
Là où les assistants des magistrats semblent se considérer comme un groupe uni, en revanche, c’est dans la différenciation qu’ils opèrent entre leurs missions et celles du personnel de greffe. Alors que la notion d’« équipe juridictionnelle » englobe parfois ces derniers, les assistants, généralement, les en excluent. Pour Lise, assistante de justice dans un tribunal judiciaire de grande taille, « si on veut vraiment parler d’une équipe autour du magistrat, alors moi je ne mettrais pas le greffe dedans, mais seulement les deux postes d’assistant de justice et de juriste assistant. Parce que les greffiers font tout le côté administratif, mais ils n’aident pas les magistrats en fait. » C’est ainsi un conflit autour de la plus grande « aide » apportée aux magistrats, comme preuve de compétences et de capacité à accéder, in fine, à cette profession, qui semble se dessiner dans les juridictions françaises.
Une évolution des métiers de la justice
Avec la pérennisation prochaine des juristes assistants des juridictions de l’ordre judiciaire sous l’appellation d’attachés de justice, c’est une période significative de mutation des collectifs de travail au sein des juridictions françaises qui semble s’annoncer. Jusqu’à maintenant, en effet, à part les rapporteurs de la Cour nationale du droit d’asile, aucun des postes contractuels d’assistants des magistrats n’était reconductible en CDI. À présent, les discours institutionnels présentent ces personnels comme des acteurs destinés à rester dans la durée. Comme l’exprime Julie, magistrate de l’ordre judiciaire, « là, on entre dans une nouvelle ère, on sait qu’il y a vraiment besoin d’une équipe, et donc ces acteurs ne sont plus là uniquement pour pallier un manque de magistrats comme c’était au début ».
Dans les années qui viennent, il s’agira d’analyser comment les acteurs professionnels du monde de la justice s’adaptent à ces volontés de faire évoluer le travail en juridiction vers une activité davantage pensée de manière collective. D’autant qu’avec la pérennisation des attachés de justice, il est plausible d’imaginer des cas où ceux-ci, travaillant au même poste depuis des années, seront en position d’experts et de formateurs auprès de magistrats en mobilité constante[13].
Cette plus grande coopération entre des acteurs qui diffèrent par leur statut et par le stade atteint dans leur parcours professionnel, tout comme les conflits susceptibles d’émaner de cette collaboration, seront ainsi à considérer comme des facteurs, et indices, d’évolution des métiers de la justice.
