Grèves à Emmaüs : derrière le sens du travail associatif, sa matérialité
Depuis l’été 2023, des grèves ont éclaté dans plusieurs communautés d’Emmaüs dans le Nord de la France. Ce n’est pas la première fois que l’association, fondée il y a maintenant 70 ans par l’Abbé Pierre, est le théâtre d’une mobilisation et d’un arrêt de la production par ses travailleur.ses. De la grève des salarié.es de 2009 à celles des compagnes et compagnons de 2023, ces conflits interpellent sur le traitement du travail dans ce cadre associatif et le déni qu’il y subi, au nom de la cause et des valeurs portées par ces entreprises engagées. Ils nous invitent, plus largement, à prendre en compte les liens entre monde associatif et néolibéralisme et à prendre au sérieux le statut politique et matériel du travail dans les associations, bien au-delà de la question du « sens » à laquelle il est souvent limité.
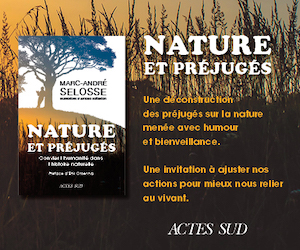
De la grève de 2009 à celle de 2023, des brèches dans le déni de travail associatif
En 2009 déjà – entre le 3 juin 2009 et le 15 mars 2010 plus exactement – une grève de plusieurs mois avait secoué l’associations Emmaüs[1]. Les revendications des salarié.es portaient notamment sur le non respect du droit du travail par l’association – absence de négociations annuelles obligatoires – et dénonçaient plus largement leurs conditions de travail, de rémunération et le type de management appliqué depuis la restructuration de l’association deux ans plus tôt. Cette grève à Emmaüs était loin d’être la première grève dans le monde associatif. La Cimade avait déjà connu en 1977 une « grève étrange dans une entreprise association » pour reprendre le titre de l’article de Libération qui l’avait alors documentée. À la même époque, Amnesty International avait également été secouée par des conflits entre personnels et direction. Et en 2000, c’était au tour de France Terre d’Asile.
Ce qui frappe toutefois avec la grève d’Emmaüs de 2009 et qui la distingue de ces autres mobilisations, c’est sa forte médiatisation. Celle-ci résulte en grande partie d’une stratégie de publicisation du conflit, délibérément choisie par les salarié.es mobilisé.es et notamment par la meneuse du conflit, déléguée CGT fraichement issue du secteur privé lucratif. Les grévistes rompent ainsi à dessein avec une tendance structurelle des travailleur.ses associatif.ves à ne pas visibiliser les conflits du travail pour ne pas « nuire à la cause ».
Cette visibilité de la grève associative et même de la dimension associative de la grève se heurtera néanmoins à une certaine invisibilité sociale des salarié.es associatif.ves. En 2009, ces salarié.es, à l’éthos du public mais aux conditions de travail du privé, échappaient encore aux statistiques et aux représentations communes du salariat et même du travail. Le beau lapsus de Claire Chazal qui annonce au journal de 20h ce 9 mars 2010 « Grève à l’association Emmaüs, nos journalistes ont été à la rencontre des bénévoles de l’association » est à ce titre révélateur. Ce ne sont pas des bénévoles mais bien des salarié.es qui sont en grève et sont interviewé.es dans le reportage. Mais c’est comme si le terme d’« association » appelait nécessairement avec lui celui de « bénévoles », comme si le monde associatif – qui comptait déjà à l’époque plus de salarié.es que dans la fonction publique territoriale – était avant toute chose un monde de l’engagement. Et c’est bien cet engagement que les salarié.es d’Emmaüs ont alors le sentiment de payer le prix fort en terme de conditions de travail, de rémunération et de dialogue social et dont ielles cherchent à dénoncer l’instrumentalisation.
Treize ans plus tard c’est un autre déni de travail associatif qui semble se fissurer par la grève. À la différence de 2009, ce sont aujourd’hui des compagnes et compagnons d’Emmaüs, et non des salarié.es de l’association, qui se sont mis.es en grève.
Les « compagnons » sont consubstantiels à la naissance des premières communautés du mouvement Emmaüs. S’appuyant sur les données d’une enquête réalisée pour la période allant entre le 1er janvier 1964 et le 1er avril 1965 à partir du fichier central de l’Union centrale des communautés d’Emmaüs, Axelle Brodiez[2] rappelle que les compagnons représentaient environ 1 460 personnes. Doté d’un cadre juridique par l’ancien président d’Emmaüs France Martin Hirsch alors haut-commissaire aux solidarités actives, le statut de compagnon voit le jour en 2008 dans le cadre de la loi généralisant le RSA qui insère, dans le code de l’action sociale et des familles, un chapitre relatif « au statut des personnes accueillies dans des organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires » (OACAS). Cette disposition a pour conséquence d’instituer, dans la loi, un statut de « travailleur solidaire », non salarié[3], pour les compagnons d’Emmaüs, ce qui suscitera à l’époque des débats au Sénat.
Dans une question écrite, une sénatrice de la Loire s’interrogeait par exemple sur le fait que « les compagnons se retrouvent exclus des droits protecteurs que peuvent leur apporter le code du travail et le statut de travailleur alors même qu’une bonne partie d’entre eux exercent une réelle tâche professionnelle à finalité économique »[4]. Ce que fixe uniquement la loi, pour ces « travailleurs solidaires » des OACAS, c’est la garantie d’un hébergement, un accompagnement social, et une « allocation communautaire » (le montant conseillé par Emmaüs France est aujourd’hui d’environ 390 euros par mois). Les Communautés Emmaüs agréées OACAS cotisent à l’Urssaf sur la base de 40% du SMIC et les compagnons déclarent leurs ressources sur la base de cette assiette forfaitaire.
Selon certaines estimations plus de la moitié des 7000 compagnons et compagnes d’Emmaüs aujourd’hui seraient des personnes sans papiers. Or, depuis la circulaire Valls de 2012 mais plus encore depuis la loi 2018, le statut de compagnon peut jouer dans le processus de régularisation. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) fait, en effet « pour la première fois, référence aux personnes accueillies dans des structures agréées OACAS et prévoit qu’une carte “vie privée et familiale” (VPF), “salarié” ou “travailleur temporaire” puisse être délivrée aux personnes en mesure de justifier de trois années d’activité ininterrompue au sein d’un OACAS, du “caractère réel et sérieux” de cette activité et de “perspectives d’intégration” »[5].
Ce que dénoncent entre autres les compagnes et compagnons d’Emmaüs entré.es en grève au printemps dernier c’est que les communautés ou iels étaient engagé.es n’aient pas renouvelé, pour certaines depuis assez longtemps, leur statut d’OACAS ce qui les prive de leur statut de travailleur solidaire, des quelques droits sociaux mais aussi et surtout des espoirs de régularisation qui lui sont associés. Outre les accusations de violences psychologiques, de racisme et de mauvais traitements[6] de la direction de la communauté du Nord de la France d’où est partie la grève, c’est cette invisibilisation du travail et cette manipulation de l’espoir au cœur du fonctionnement productif des communautés qui sont mis en cause par les grévistes. La situation en jeu ici est certes extrême mais elle est loin d’être unique. Elle rappelle plus largement ces mécanismes du « hope labor »[7] – je travaille gratuitement aujourd’hui dans l’espoir de décrocher demain le boulot de mes rêves – et plus largement l’économie de la promesse qui, comme de nombreux travaux l’ont déjà documenté, régit le marché du travail néolibéral aujourd’hui[8].
Travail associatif et nouvel esprit (néolibéral) du capitalisme
C’est donc plus largement la question de la participation du monde associatif à la précarisation, à la dérégulation et même à la « gratuitisation » du travail aujourd’hui qui est posée par ces grèves. Et derrière elle, celle de ses liens avec le néolibéralisme, cette forme de capitalisme « postfordien, désorganisé et transnational »[9], ce « régime postnational de workfare schumpéterien »[10] qui, succédant à une forme nationale et étatique de capitalisme, n’a de cesse de s’attaquer aux institutions du travail (droit du travail, sécurité sociale, syndicalisme, statut de la fonction publique, etc) qui, à travers les dynamiques conflictuelles du salariat[11], ont pu s’y élaborer.
Longtemps le monde associatif, assimilé aux forces progressives d’engagement et de mouvement social, a été spontanément désigné comme un refuge – sinon un lieu de résistance – contre le néolibéralisme. Et quand le travail dans les associations ne fait pas l’objet d’un déni, invisibilisé par l’engagement dont il est (généralement mais peut-être pas toujours) le support, il est aujourd’hui appréhendé principalement à travers le prisme du « sens ».
À l’heure de la critique des bullshit jobs et des violences de la managérialisation, on imagine aisément que les associations puissent apparaître comme un monde à part. Guidées par des valeurs et tournées vers la production d’une utilité sociale, elles font alors figure de modèle, ou au moins d’inspiration, pour repenser le travail. Or, comme en témoignent les deux mobilisations évoquées à Emmaüs, mais aussi de nombreux conflits, tensions ou dilemmes du travail associatif, bien au-delà de cette seule association, les choses sont en réalité plus complexes, et mériteraient d’être appréhendées de façon plus nuancée, voire plus ambivalente.
En se centrant uniquement sur les dimensions symboliques du travail dans les associations, sur le sens, les valeurs et l’utilité sociale, on risque fort de passer à côté des enjeux matériels auxquels ce travail et ces travailleur.ses sont aujourd’hui confronté.es. En négligeant la matérialité du travail associatif, on ferme les yeux sur les modalités spécifiques – et notamment symboliques – par lesquelles le monde associatif, sans doute en partie malgré lui, peut contribuer au projet néolibéral de dérégulation et de précarisation du travail aujourd’hui.
Ainsi de ces aides à domicile étudiées par Anne Le Roy et Emmanuelle Puissant dont le temps de travail est de plus en plus soumis à des protocoles standardisés qui ne reconnaissent plus comme « productives » que les tâches fonctionnelles (aide au repas, toilette, ménage, etc.) au détriment de la dimension relationnelle du travail avec la personne, qui donnait pourtant, pour certaines d’entre elles en tous cas, tout son sens à leur activité. Elles sont alors nombreuses, nous disent les chercheuses, celles qui reviennent finir leur travail au-delà des prescriptions temporelles qui leur sont imposées, au nom du travail bien fait et du bien-être des personnes dont elles s’occupent. Par exemple, « elles reviennent pendant leur temps de pause chez les personnes pour terminer ce qu’elles n’ont pas eu le temps de réaliser dans le temps imparti pendant leurs interventions de la journée ». Plusieurs salariées, ajoutent les chercheuses, leur ont « dit « badger » pour faire croire qu’elles partent à l’heure prévue, pour être sûres que le coût engendré par le dépassement de l’heure n’incombe pas aux usagers et usagères, mais restent chez les personnes pour terminer ce qu’elles doivent faire, sans les brusquer, et donc sans respecter les référentiels de temps qui leur sont imposés ».
Bien sûr on peut – et on doit- lire dans ces pratiques la résistance du « travail vivant » aux injonctions déshumanisantes de la rationalisation du travail. Mais, comme le pointent à juste titre Anne Le Roy et Emmanuelle Puissant, « il s’agit là de stratégies individuelles dangereuses pour les salariées (et les usagers et usagères) en cas de problème, et du développement d’un travail hors temps d’emploi rémunéré, dans des métiers qui se caractérisent déjà par une part importante de travailleuses pauvres ». On ajoutera que se rejouent ici des assignations genrées qui méritent à ce titre d’être interrogées dans leur visée émancipatrice. Last but not least, ce sont ces stratégies individuelles qui « permettent au système de tenir malgré tout »[12]. Ces travailleuses relativement précaires paient donc – littéralement – le prix de cette résistance symbolique, de cette préservation du « sens » … et avec lui du maintien du système.
Quelles conditions de travail, de rémunération, de statut faudrait-il ainsi sacrifier pour un travail qui ait du « sens » ? Et de quel sens in fine parle-t-on quand la formalité du travail se détache ainsi si fortement du fond ? L’exemple des aides à domiciles enquêtées ci-dessus comme celui des conflictualités ouvertes par les salarié.es et par les compagnes et compagnons d’Emmaüs nous invitent à ne pas sanctifier à outrance ce « sens du travail associatif ». Pour comprendre les enjeux du travail associatif aujourd’hui dans toute leur complexité, il est indispensable de réaliser que les associations ne sont pas émancipées « par nature » du capitalisme néolibéral. Il nous faut accepter de penser tout ce que la néolibéralisation fait aux associations, du financement par projet et de la « politique de la présence »[13] qu’elle induit, à la rationalisation, voire à la « bénévolisation » du travail et à sa rémunération en espoir et en promesses. De même nous faut-il en retour prendre acte de tout ce que le monde associatif fait au capitalisme aujourd’hui, capitalisme qui, devenu « cannibale »[14], n’hésite pas à se prévaloir de la prise en charge de l’intérêt général, sinon d’être un « caring capitalism »[15].
Comme nous le rappellent avec force les travailleur.ses solidaires invisibles d’Emmaüs, en grève aujourd’hui dans leur communauté, penser le sens du travail sans en penser la matérialité, c’est prendre le risque de perpétuer voire de renouveler des formes de domination et d’exploitation dont s’accommode parfaitement la néolibéralisation du monde. Face à l’autoritarisme croissant de l’État qui, à coup de menaces de dissolutions, de suppressions de financement et autres rappels à l’ordre[16], cherche indiscutablement à imposer sa propre définition du sens politique du travail associatif, sortir la matérialité du travail associatif du déni est plus que jamais d’actualité.
NDLR : Mathieu Hély et Maud Simonet ont récemment dirigé le volume collectif Monde associatif et néolibéralisme dans la collection La Vie des Idées aux PUF
