Beauvoir-Fanon : comment une réconciliation impossible suscite l’imagination
Fin juillet 1961, pour la première et dernière fois, Simone de Beauvoir et Frantz Fanon se rencontrent quelques jours à Rome aux côtés de Jean-Paul Sartre et de Claude Lanzmann, peu avant que Sartre ne rédige sa Préface aux Damnés de la terre.
Sartre et Beauvoir, signataires du Manifeste des 121 (« Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie ») étaient alors régulièrement menacés de mort par l’OAS, organisation terroriste d’extrême-droite, et cherchaient à s’éloigner de Paris ; le 19 juillet, quelques jours avant d’arriver à Rome, une bombe explosa dans l’entrée de l’appartement que Sartre avait déserté. Le séjour de Fanon à Rome avait, lui, pour motif la rencontre avec Sartre et des soins en station thermale relatifs aux suites d’une blessure à la colonne vertébrale. Il revenait dans la ville où il avait dû, par le passé, déjouer une menace d’assassinat et craignait un nouvel attentat contre sa vie.
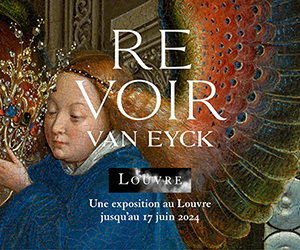
Entre Fanon et Beauvoir, nul dialogue véritable ne se noua à ce moment-là, en dépit d’une sympathie et d’un respect mutuels. Les conversations se tinrent essentiellement entre Sartre et Fanon autour de la Critique de la raison dialectique (1960) dont la lecture avait nourri nombres d’analyses des Damnés de la terre. Fanon jugea Beauvoir un peu trop pusillanime (« je n’aime pas les gens qui s’économisent » aurait-il confié à Lanzmann), celle-ci interrompant souvent les discussions nocturnes et menant à Rome un style de vie (restaurants, visites des ruines etc.) en rupture totale avec ses propres préoccupations[1].
De ricochet en ricochet, l’anecdote révèle une discordance d’expériences de vie : l’entrechoquement des choix qui donnent aux existences leur pli et les embarquent dans des directions divergentes. Celle, pour Fanon, d’une pratique psychiatrique résolument émancipatrice, d’un engagement au sein de la résistance nationale en Algérie dès 1954 puis aux côtés du FLN en Tunisie (via le journal El Moudjahid), et de l’élaboration d’une pensée révolutionnaire sur la constitution du peuple en lutte contre l’oppression coloniale. Celle, pour Beauvoir, d’une absence d’engagement véritable au sein de la Résistance durant l’Occupation et de sa participation à Radio-Vichy à l’été 1943 pour y animer une émission de divertissement musical ; de la persistance de clichés orientalistes-racistes qui imprègnent son imaginaire philosophique ; d’un positionnement politique relativement tardif eu égard à son écrit majeur, Le Deuxième Sexe, quand, en 1960, celle-ci apporte aux côtés de Gisèle Halimi son soutien à Djamila Boupacha (militante au sein du FLN) lors de son procès, puis, dans les années 1970, au Mouvement de Libération des Femmes.
Mais ce dialogue impossible met au jour davantage qu’une divergence de positionnements politiques et théoriques : l’absence de scène commune, en 1961, entre une pensée forte du patriarcat tel qu’il est vécu par les femmes blanches au sein du cadre conjugal et une autre pensée, non moins forte, du racisme à l’encontre des Antillais et Arabes exercé dans les métropoles françaises à la fin des années 1940, puis du racisme colonial et de l’exploitation mis en place en Algérie. Une absence qu’on ne saurait simplement regretter dans un geste anachronique en forçant la réunion des pensées et des perspectives d’émancipation ; ou euphémiser par la tentation de déceler, chez Fanon, un souci féministe et, corrélativement, chez Beauvoir, une analyse approfondie du racisme – même si l’un et l’autre ont nourri leurs pensées respectives d’emprunts : Fanon avait lu attentivement Le Deuxième Sexe dont il possédait le 1er tome dans sa bibliothèque et celui-ci imprègne certaines analyses de Peau noire, masques blancs[2] ; Beauvoir puise chez Richard Wright une compréhension du racisme anti-Noirs états-unien l’aidant à affiner certains aspects de son analyse du patriarcat.
Cette absence de jonction entre pensées/luttes/oppressions distinctes se retrouve dans le travail analogique mis en œuvre dans leurs écrits (du moins chez Beauvoir ; Fanon s’est efforcé de penser les formes entrecroisées de racialisation de la sexualité dans une tentative parfois malheureuse, souvent sexiste). Le geste analogique vise à éclairer par le biais d’un rapport social (à valeur d’exemple) un autre rapport social (investigué), afin de faire ressortir ce qui, indépendamment d’un changement de point de vue et d’un déplacement de situation, demeurerait obscur. L’analyse des parentés entre plusieurs oppressions se réalise grâce à une opération de désunion, par l’approfondissement des écarts et un jeu d’éclairage ponctuel (par exemple le rapport Blancs/Noirs venant illuminer certains aspects des dimensions du rapport hommes/femmes). L’analogie – en dépit des impasses qu’elle charrie et des difficultés supplémentaires à penser les expériences où les oppressions s’enchevêtrent[3] – autorise une circulation des points de vue et des descriptions (fût-ce sur le mode de la friction) laquelle, si elle ne donne aucune image simple des résistances à venir, vivifie les contradictions. Car la rencontre « manquée » entre Beauvoir et Fanon est fondamentalement un conflit de perceptions : un conflit de mondes vécus qui n’étaient peut-être pas destinés à tenir ensemble. Pour cette raison, elle relance la problématisation politique et ouvre l’imagination.
Un diagnostic politique
L’anecdote a valeur de diagnostic. Elle pose de manière indirecte la question des alliances, des coalitions, autrement dit de la construction d’un espace commun – travaillé par des tensions – depuis lequel lutter contre l’oppression. Car si l’oppression ne saurait être une structure universelle, un invariant transcendant les différentes formations historiques et positions d’énonciation qui lui donnent sens et contenu, comment envisager la possibilité même d’une rencontre politique ou la formation d’une expérience collective ?
L’idée même d’une « lutte contre l’oppression » ne saurait aisément rassembler des vécus hétérogènes, ancrés dans des lieux et histoires spécifiques, c’est-à-dire non voués à se réconcilier sous le sceau d’une empathie hâtive ou la projection fantasmée d’une communauté. Car « l’oppression », au sein de la pensée existentielle des années 1950, ne désigne plus prioritairement (telle qu’elle a pu être théorisée dans l’histoire des idées, notamment durant la Révolution française[4]) ce qui s’exerce sur un peuple, une ethnie ou un groupe social, soit une collectivité constituée dans un acte de résistance à l’autorité despotique ou à la violence (d’un tyran, gouvernement ou État).
L’oppression est en premier lieu ce que l’on sent en soi : ce qui, dans sa dimension d’insupportable, n’est pas tout à fait partageable ou communicable. Elle n’a pas de définition simple qui la distinguerait objectivement de la domination ou de l’exploitation : elle est le nom d’une mise en scène du pouvoir, l’indice d’une position d’énonciation où s’affirme un point de vue et une parole, au moment même où l’effort pour exister se trouve contrarié par la violence. L’oppression se vit et se dit au je : elle prend sens, réalité et importance à partir d’une configuration singulière où les logiques d’exploitation, de domination ou d’aliénation atrophient les prétentions existentielles et en appellent à la nécessité d’un refus.
Dans la perspective existentielle, la résistance n’est pas l’autre de l’oppression : un état qui lui succèderait dans un horizon lointain. Elle en est corrélative en ce qu’elle présuppose (et réaffirme) le désir de liberté placé au cœur de l’existence. L’oppression est paradoxale : elle s’applique à cela-même qui signera son effritement : une incarnation de dignité et d’égalité, la puissance d’une voix ou d’un corps, un regard qui ne faiblit pas, y compris dans les circonstances les plus difficiles.
Cela ne signifie aucunement que cette expérience serait évidente ou intrinsèquement détentrice de vérité : de la même manière que toute expression de souffrance n’est pas porteuse d’une qualité politique, parvenir à dire « je », soit à penser et parler en son nom en défaisant les rapports de subordination, ne réussit pas à chaque coup.
L’expression de l’oppression n’est pas à chercher dans les profondeurs d’une intimité ou d’un passé enfoui dont on pourrait reconstituer la trame cohérente par un geste nostalgique : elle dépend de la force de rupture réalisée avec le bruissement ambiant des mots (des voix et cadres discursifs-idéologiques) les plus partagés et des images qu’ils convoquent. Et elle est tributaire de conditions sociales, subjectives et affectives depuis lesquelles un certain rapport à soi tissé au travers de rapports égalitaires aux autres peut advenir. « Voir d’en bas ne s’apprend pas si facilement et n’est pas sans problème[5] » souligne Donna Haraway ; « il n’existe pas de garantie politique déjà inscrite dans une identité[6] » précise Stuart Hall. Pour qu’une expérience singulière parvienne à exprimer une vérité apte à dissiper les mensonges-confusions sciemment entretenus par celles et ceux qui ont le plus de pouvoir, elle doit être animée par une force collective qui la déplace et la dépersonnalise.
C’est précisément parce qu’il n’y a pas de politique sans expérience mais que cette expérience a des conditions politiques (et historiques) de possibilité, que Sartre, Beauvoir, Fanon ou Wright n’ont cessé de tracer des lignes de rencontre depuis lesquelles envisager le nouage de solidarités. Les expériences peuvent être résolument différentes (ne jamais parfaitement communiquer ni coïncider) mais résonner en certains points de commensurabilité – des points instables, surprenants, ouvrant un partage (par définition difficile et périlleux) de la parole ou des fragments du vécu. La résonance, au creux d’une expérience propre, interpelle depuis un autre lieu : elle défait le rêve de fusion ou d’appartenance en déplaçant ce qui, des corps, affects et sensibilités, apparaît le moins figé et donc le plus ouvert à la transversalité élaborée autour de problèmes communs.
Les résistances à l’oppression sont toujours localisées : elles se définissent autour de problèmes précis et souvent in-anticipables et portent une part de contingence rétive à une stratégie politique nettement définie. Car l’intelligence politique n’est pas seulement affaire de raison froide, calculante, mais requiert (surtout) une raison sensible[7] : une certaine manière de voir la réalité des violences, de juger le moment opportun de construction des alliances, de faire résonner ses rêves ou émotions avec ceux des autres ; elle autorise une sortie de soi afin de se lier au collectif, à un peuple en lutte ou au monde entier.
Cette raison sensible est, aux yeux de Merleau-Ponty, un « processus moléculaire (…) et mûrit dans la coexistence avant d’éclater en paroles et de se rapporter à des fins objectives[8] » ; elle est moins affaire de représentation ou d’une prise de conscience irruptive (le « cogito révolutionnaire » dont Bourdieu pointera, à sa suite, les limites) que d’une transformation de la perception. Elle exige d’assumer l’imprévisibilité du processus révolutionnaire en renonçant aux prédictions infaillibles, c’est-à-dire de « naviguer à vue » : se rendre attentif aux changements (parfois peu manifestes) des rapports de force en assumant une tâche de déchiffrement permanent : l’histoire « est terreur parce qu’il nous faut y avancer non pas selon une ligne droite, toujours facile à tracer, mais en nous relevant à chaque moment sur une situation générale qui change, comme un voyageur qui progresserait dans un paysage instable[9] ». C’est seulement en s’enfonçant dans les tensions et complexités d’expériences ancrées, que l’élaboration de leur connexion devient possible. Critiquant « l’internationalisme ascétique » de certaines interprétations marxistes, Merleau-Ponty cherche à penser « la rencontre au même carrefour des prolétariats de fait, tels qu’ils existent dans différents pays », et dont « les raisons les plus fortes » de lutter contre l’oppression ne sont pas destinées à s’effacer sous l’aplanissement homogénéisant des vécus. Approfondir ces raisons (intimes, troubles, irréductibles entre elles) de lutter contre l’oppression, c’est alors « rejoindre l’universel, mais sans quitter ce que nous sommes[10] », depuis des lieux que l’idée seule du « pays » ne peut résumer (comme le pensait Merleau-Ponty après la Guerre) mais se pluralisent plutôt en collectifs, groupes politiques, espaces de créations ou solidarités inattendues.
Tel est le sens de l’universel singulier réfléchi par Sartre et de façon plus discrète mais non moins décisive, par Beauvoir. Aussi « l’affirmation des solidarités singulières » ouvre-t-elle inéluctablement sur « la totalité des hommes[11] » et Beauvoir loue le courage de Richard Wright d’avoir quitté le Parti communiste en 1942 lorsque celui-ci était enjoint de renoncer aux revendications spécifiquement liées au racisme ségrégationniste, soupçonnées de détourner les intérêts du prolétariat (supposé blanc) durant la Guerre. Refuser de présupposer une définition univoque de l’oppression (et, dans le même temps, sa réduction aux seules logiques d’exploitation) ou refuser une appartenance de principe à une expérience collective (par exemple, la classe), c’est porter attention à la construction progressive d’une commensurabilité depuis les affirmations singulières d’émancipation ; c’est percevoir les résonances dispersées des manières de parler, de créer ou d’aimer – étant entendu qu’« au niveau de l’expérience vécue il ne faut pas s’attendre à une rationalisation des attitudes et des choix[12] ».
Universel singulier ou singularité universelle ?
Il n’empêche : Beauvoir ne perçoit pas que la singularité n’a pas nécessairement à être subordonnée à une exigence d’universalité qui lui serait adressée du dehors. L’expérience singulière la dessine plutôt de facto, de manière immanente sinon contingente, par la mise en défaut radicale des termes majoritaires qui participaient jusqu’alors à la définir.
La brèche est ouverte par Fanon dans les Damnés de la terre : la rencontre possiblement conflictuelle et risquée autour du projet de décolonisation n’a pas besoin de lisser les raisons de lutter contre l’oppression coloniale – raisons qui diffèrent selon que l’on appartient au lumpenprolétariat, aux classes urbaines éduquées ou à la paysannerie – ni à être assujettie à un principe d’universalité qui la précèderait, extérieur à la lutte, dont la définition aurait été tracée par l’histoire impériale et coloniale. Pourtant, dans le mouvement même d’unification du peuple, tout un monde (de mots et de voix, de créations artistiques, d’espoirs et de corps) s’invente, dessinant les contours d’une humanité « neuve » dont le sens n’est à chercher nulle part ailleurs que dans l’interpellation – forcément énigmatique – que l’appel révolutionnaire suscite en soi.
En un autre espace-temps, Anna Julia Cooper (1858-1964), théoricienne, activiste et poète africaine-américaine, concevait, elle aussi, la position de féminité la plus minoritaire (celle des femmes noires du Sud des États-Unis, dont l’expérience à la fin du XIXème siècle est façonnée par la ségrégation raciale, la violence sexuelle et l’exploitation au sein des emplois de service) comme l’unique entrée possible vers l’universel : la position la plus à même de redéfinir le sens de l’humanité au point où les signifiants humankind et womankind deviennent, dans son écriture, indiscernables. Parce que l’humanité et l’universel ne sont pas des notions abstraites, leur définition et portée méritent d’être redéployées depuis l’approfondissement d’une position de singularisation-minorisation : celle des femmes dont l’humanité et la participation à l’universel ont été le plus violemment niées par ceux-là mêmes qui en faisaient des principes aptes à consolider la nation états-unienne – y compris au sein des mouvements féministes suffragistes.
Ainsi réinvestie, la féminité n’est plus simplement une norme complémentaire ou opposée à la masculinité dont elle serait le revers. Elle n’est pas non plus une féminité alternative, venant décaler les significations majoritaires qui en étaient données par les féministes blanches. Elle s’affirme positivement par l’approfondissement d’une singularité inassignable et non aisément reconnaissable au prisme des catégories-identités existantes. Elle tient toute seule – et sans script.
Cette idée de singularité universelle est, au fond, éminemment féministe, si l’on entend par « féminisme » un projet visant à bouleverser l’ordre du monde et à abolir les rapports sociaux de sexe, de race et de classe qui assurent la subordination-infériorisation-humiliation des femmes. Le « personnel est politique » : l’expérience vécue est un processus ouvert, susceptible d’être approfondi, diversifié, intensifié afin que s’y affinent ses potentialités (de résonance ou connexion, d’affirmation du désir de liberté et d’égalité).
Le personnel, soit le plus apparemment anodin, ce qui peut le plus être suspecté d’insignifiance et être mis sous silence – éventuellement le désir, le corps, l’amour de soi et des autres, la sensibilité ou recherche de joie – n’a pas à devenir politique, à prendre sa part au sein du politique ; il l’est et les deux régimes personnel-politique ne sont plus séparés. Parce que le féminisme n’est pas un « refuge[13] », une grande famille au sein de laquelle chercher confort et confirmation, sa réinvention n’est susceptible d’advenir qu’aux lieux de son impossibilité. La (non)rencontre Beauvoir-Fanon en est, d’une certaine manière, l’invite.
NDLR : Mickaëlle Provost a récemment publié L’expérience de l’oppression.Une phénoménologie du racisme et du sexisme aux PUF
