Écrire à l’université à l’heure des IA génératives : trouble dans l’auctorialité (1/2)
En mars 2025, la start-up japonaise Sakana annonce que son système d’intelligence artificielle générative (IAG), The AI Scientist V2, est parvenu à automatiser l’ensemble du processus de production d’un article scientifique dans le domaine du machine learning : de la formulation des hypothèses à la conduite des expérimentations, en passant par la création de visualisations et la rédaction du manuscrit.
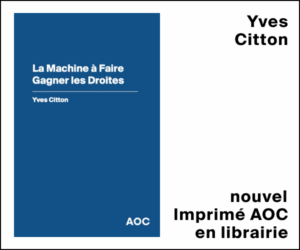
L’article, généré sans intervention humaine directe, a été soumis à un workshop de l’ICLR, une conférence internationale en intelligence artificielle, où il a passé avec succès l’évaluation en double aveugle par les pairs, bien que les workshops soient généralement moins exigeants que les panels de la conférence principale. Conformément à un accord préalable avec les organisateurs, le papier a été retiré avant publication. L’objectif n’était pas de créer un précédent, mais de susciter un débat sur les nouvelles normes de la recherche automatisée. Cette expérience, qui n’a impliqué qu’une forme de curation humaine en amont (l’article soumis ayant été sélectionné parmi plusieurs versions générées), montre que la communauté scientifique a désormais besoin de définir des règles en matière d’attribution et de labélisation de ce type de contenus.
Bien qu’encore marginale et loin de pouvoir s’étendre à toutes les disciplines, cette expérience illustre un questionnement qui traverse l’ensemble du champ académique : que reste-t-il de l’auteur lorsque le texte n’est plus que partiellement attribuable à un sujet humain identifiable ? C’est en raison de ce trouble dans l’auctorialité que, dans l’enseignement supérieur et la recherche, les problèmes posés par les IAG se cristallisent essentiellement autour de l’écriture. Dès l’arrivée de ChatGPT à l’université, une même interrogation s’est imposée tant aux étudiants qu’aux enseignants-chercheurs : faut-il s’interdire d’y recourir pour rédiger ses travaux ?
Depuis deux ans, de nombreux acteurs du champ académique ont enga
