Faire de la recherche en pleine apocalypse (2/2)
Le rapport de détestation que plusieurs figures de l’entrepreneuriat, de la finance et de la politique entretiennent à l’égard du personnel académique peut se comprendre à partir d’un texte originellement publié en 1967 par Howard Becker.
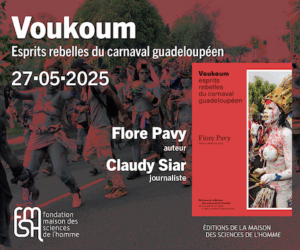
Dans « De quel côté sommes-nous ? », le sociologue s’intéressait aux soupçons de partialité que les élites politiques et économiques entretenaient à l’égard des chercheurs, Becker parlant de sa propre expérience de sociologue de la déviance. Il les expliquait par deux facteurs : l’empathie développée par les chercheurs pour leur objet et le fait que les travaux de recherche bousculent la « hiérarchie de crédibilité » précédemment établie.
Concernant le premier point, l’auteur d’Outsiders avançait ainsi qu’en tant que chercheurs nous développons « une sympathie profonde pour les gens que nous étudions. Alors que le reste de la société les voit comme indignes de la considération habituellement accordée à nos concitoyens, nous croyons qu’ils valent autant que tout un chacun, et plutôt que de les voir comme des pécheurs, nous estimons qu’à l’inverse on pèche contre eux. » Il précisait que cet attachement avait des implications morales et politiques, car en livrant un « portrait » différent de ceux et celles que le reste de la société considèrent comme déviants, nous condamnons implicitement « ces citoyens respectables qui, à nos yeux, ont fait du déviant ce qu’il est. »
De fait, l’existence de certaines sciences, indépendamment des résultats produits, des valeurs défendues, du vote ou des convictions intimes des chercheurs, conduit à bousculer la « hiérarchie de crédibilité » que certaines élites souhaitent instaurer ou voudraient ne pas voir changer. Becker considérait ainsi qu’au sein de tout système, il est généralement accepté que « les membres du rang le plus élevé détiennent le droit de définir la situation ». Or, si l’on soupçonne certains chercheurs de partialité, c’est qu’ils refusent « de tenir pour acquis, sur les
