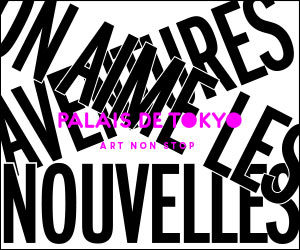Kupka chez les pauvres
J’étais à la recherche d’une articulation. Premier élément : le souvenir de l’exposition « Cosa Mentale » de Pascal Rousseau au Centre Pompidou-Metz en 2015, où le rapport du tchèque Kupka (mais aussi de Kandinsky, Mondrian et de bien d’autres) à la théosophie était remis en valeur. Ce qu’est la théosophie, on essaiera de le dire un peu plus tard. Deuxième élément, qui corrobore le premier : une visite, plus récente, au palais Veletrzní de Prague où Kupka, enchaîné par le déroulement chronologique des salles aux mystères symbolistes de Jakub Schikanider ou Jan Preisler, semblait donner une peinture visionnaire et organique à la fois, pleine de formes « naturelles » (mais réinterprétées par le Jugendstil) : fleurs, feuilles, stalactites, ronds dans l’eau, par exemple avec Amorpha, fugue en deux couleurs (1912). Je pensais à un art phénoménologique, quoique techniquement « abstrait », ayant entrepris de rendre sur la toile le gargouillis de nos vibrations intracellulaires face aux objets du monde, sismographiant la perception entre deux courts-circuits synaptiques. Cela me semblait profondément humain, apte au partage, un art accessible à tous car venant d’un tréfonds commun.
Troisième élément à articuler, le plus épineux, qui apparaît dès les premières salles de la rétrospective du Grand Palais : l’engagement politique du jeune František (mais il signe François car il vit et travaille à Paris) Kupka. Par exemple, en décembre 1906, à 35 ans, il dessine un Ouvrier crucifié au fusain, à l’encre et l’aquarelle pour la der de la revue anarchiste les Temps nouveaux. Un jeune homme à petite moustache de hipster, yeux baissé, peut-être mort, est attaché à une roue dentée géante. Rien de réaliste ou dérangeant ici, nulle broyure, plutôt une icone glacée. On ignore si Kupka a lui-même emprunté cette iconographie socialiste, mais elle se retrouve évidemment dans la scène des Temps Modernes de Chaplin, trente ans plus tard, où le héros fait corps avec un rouage machinique qui l’entraîne. Kupka n’a pas été le seul à illustrer les Temps Nouveaux : on y trouvait aussi Pissaro, Steinlen ou Vallotton. Et il ne travaille pas que pour cette publication, mais aussi pour l’Assiette au beurre et le Canard sauvage du côté gauche ou l’Illustration sous un angle plus bénin. Plus tard il écrira : « Le travail de dessinateur et d’illustrateur de la première période de ma carrière a été l’expression du fait que, par manque de moyens, j’ai dû renoncer au droit de peindre. En tant que pauvre, j’ai vécu avec les pauvres, et c’est ainsi que sont nés mes dessins satiriques militants. » Ou, avec un certain repentir : « j’espérais pouvoir aider à aplanir les maux dont souffre la société et dont j’étais moi-même victime, par des dessins forcément tendancieux. »
Qu’on se rassure, toute cette belle science n’est pas de notre cru, mais provient de l’excellent catalogue de l’exposition, sous la direction scientifique de Brigitte Leal, Markéta Theinhardt et Pierre Brullé. Néanmoins, la violence et l’humour du travail de Kupka « anarchiste » (il a illustré L’Homme et la Terre du géographe Elisée Reclus en 1905) est un premier point d’achoppement pour qui ne connaîtrait que son travail abstrait des années 10 et 20 et serait habitué à le considérer comme décoratif ou hors-sol, à l’image des œuvres « pures » de Delaunay.
L’articulation entre pratiques ésotériques et inspiration révolutionnaire n’est historiquement pas très compliquée à expliquer. On l’a déjà évoquée à l’occasion de l’exposition de Louise Hervé & Chloé Maillet ce printemps dernier au Credac. Ainsi dans le cas du spiritisme, « l’idée de réincarnation, qui peut s’effectuer dans le corps d’un homme ou d’une femme, d’un Noir ou d’un Blanc, oblige les croyants spirites à réfléchir à ce que signifie l’égalité », comme l’a montré Nicole Edelman (1). La communauté des âmes dans l’éternité invite en quelque au communisme sur terre. La connexion avec la « phénoménologie de la perception » qui inspire Kupka, comme le pointe Brigitte Leal dès l’introduction du catalogue, est a priori un peu moins aisée à faire.
Kupka fut placé en apprentissage chez un sellier qui était spirite. Doué d’une grande sensibilité, l’adolescent est utilisé comme médium par son patron.
Les penchants théosophiques d’une partie de la modernité ne sont pas une révélation : la première étude à ce sujet date de 1970. Une bonne moitié des essais de ce nouveau catalogue Kupka aborde donc directement la question. En particulier le chapitre de Linda Dalrymple Henderson sur l’influence qu’a pu avoir Swedenborg sur le jeune artiste : en 1983, cette chercheuse avait déjà publié un livre essentiel la théosophie et la notion moderniste de « quatrième dimension ». La plupart des artistes ont cependant fait leur propre cuisine à partir de différentes inspirations ésotériques. Pour ce qui nous occupe, on pourra retenir certaines définitions de Rudolf Steiner dans Théosophie. Étude sur la connaissance suprasensible et la destinée humaine (1904). On sait que Kupka a lu cet auteur, comme il a lu Helena P. Blavatsky ou La philosophie du mysticisme (1885) de Carl du Prel, qui a aussi influencé Kandinsky.
Steiner appelle « Sagesse divine » ou « Théosophie » la « sagesse qui, dépassant le monde des sens, révèle à l’homme son essence et sa destinée. On peut appeler science spirituelle l’étude des phénomènes spirituels qui se passent dans la vie humaine et dans l’univers. » L’homme est selon lui à la fois minéral, végétal, animal et humain, ce qui le place dans un règne à part. Il est intéressant de voir Steiner définir les animaux comme « tous ceux qui perçoivent leur entourage et qui développent une vie intérieure sur la base des impressions extérieures », devançant ainsi les anthropologies posthumanistes actuelles. Le théosophe accompli a appris à « ouvrir » en lui certain organe secret qui lui permet de percevoir « outre les couleurs, les parfums, etc., des êtres vivants, la vie même qui les anime. Dans chaque plante, dans chaque animal nous voyons, en plus de la forme physique, la forme spirituelle remplie de vie » mais aussi « on peut contempler le monde des sensations d’un autre homme » en tant que ce « monde caché à l’“intérieur” d’un autre homme se dévoile au regard spirituel objectif. » Application immédiate : le théosophe « laisse les choses parler leur propre langage, lui apprendre ce qui a, pour elles, et non pour lui, une signification ». On voit assez l’intérêt que peut avoir cette « prose du monde » à la fois en termes phénoménologiques et pour une anthropologie de la sémiose.
Kupka fut placé en apprentissage chez un sellier qui était spirite. Doué d’une grande sensibilité, l’adolescent est utilisé comme médium par son patron. Plus tard, à Vienne, il tente – en vain – de gagner sa vie en exerçant cet étrange métier. Selon Meda Mládek qui se fonde sur la correspondance et des entretiens avec des proches, jusqu’à la fin de sa vie, « il croyait non seulement au transfert de pensées, mais aussi d’énergies et de forces » (2). C’est par les théosophes (qui ne sont pas spirites) qu’il entre dans la communauté du peintre Karl Diefenbach de 1894 à 1896, devenant végétarien et naturiste. Diefenbach se fait appeler « peintre d’idées » ou « artiste protestataire », prônant le retour à la nature comme remède aux désordres sociaux engendrés par les comportements humains. Ironie de l’histoire, c’est en peignant un tableau à la place de ce dernier, le Dernier rêve de Heine mourant, que le jeune Kupka se fera remarquer par l’impératrice Elisabeth au Kunstverein de Vienne. A côté des bains de soleil et de couleurs dont l’aura cosmique le pénètre, le spiritisme lui apporte d’autres satisfactions, liées à un « intérêt pour la physiologie, la biologie, la neurologie » telles que des dissociations de la conscience, des flashes de couleur, le sentiment de flotter dans l’espace intersidéral. En 1924, il écrit à un ami : « à présent, j’arrive à rendre ce qui auparavant se mouvait dans mon esprit comme des visions trop lointaines pour êtres maîtrisées ni même pleinement perçues. » (2)
Nous voilà donc avec une valence à peu près établie entre l’abstraction de Kupka et son engagement social par le biais de la théosophie et du spiritisme. Pour le dire à truelle : tous égaux, tous à poil, baignés « par les teintes qui s’écoulent du clavier titanesque de la couleur ». Pour le lien entre la vision cosmique et la phénoménologie de la perception, on n’est pas trop loin. Meda Mládek estime que, dans le groupe de Puteaux auquel Kupka participait en 1911, avec Apollinaire, Gleizes, Metzinger ou Picabia, il a pu discuter de la philosophie de Bergson et elle voit chez lui « un fort écho du rôle de découvreur de vérité que Bergson assigne à l’art ». De fait, si l’on s’en tient à quelque paragraphes de Bergson sur l’art comme moyen de perception (3), on est frappé par la proximité spiritualiste avec les écrits de Steiner cités plus haut, qu’ils précèdent de quelques années : « Comme il les perçoit pour elles et non pour lui, c’est la vie intérieure des choses qu’il verra transparaître à travers leurs formes et leurs couleurs. Il les fera entrer peu à peu dans notre perception déconcertée […] et il réalisera ainsi la plus haute ambition de l’art, qui est de nous révéler la nature. » (le Rire, 1900) Ou encore : « De loin en loin, par un accident heureux, des hommes surgissent dont les sens ou la conscience sont moins adhérents à la vie. La nature a oublié d’attacher leur faculté de percevoir à leur faculté d’agir. Quand ils regardent une chose, ils la voient pour elle, et non pour eux. » (« La perception du changement », 1911, in la Pensée et le mouvant).
Relier maintenant, pour finir notre promenade, autrement que par une intuition, phénoménologie de la perception et politique du partage, est un exercice périlleux. Phénoménologie et politique, c’est toujours compliqué. On se rappelle la condamnation marxiste de Lyotard dans sa Phénoménologie (1954) : « La phénoménologie, posant une histoire ambigüe, pose sa propre ambiguïté dans l’histoire. […] Ce n’est pas par hasard que son aile droite va au fascisme et que sa “gauche” se contredit dérisoirement » (il vise Sartre). Un peu plus haut, il a essayé d’expliciter le « social originaire » qui est le fondement de toute anthropologie, c’est-à-dire « le “postulat” implicite de la compréhensibilité de l’homme par l’homme ». Opposant Merleau-Ponty à Sartre — le premier disant du système du second qu’il s’agissait d’un ridicule « solipsisme à plusieurs » — Lytotard précise qu’une pensée sociale n’est possible qu’à condition de ne pas prendre l’autre pour un objet de pensée mais « descendre au dessous de la pensée d’autrui et retrouver la possibilité d’un rapport originaire de compréhension […]. On doit par conséquent découvrir antérieurement à toute séparation une coexistence du moi et d’autrui dans un “monde” intersubjectif, et sur le sol de laquelle le social lui-même prend son sens. »
Ce monde intersubjectif, Steiner en avait donné une version spiritualiste à Kupka, qui lui permit peut-être, même embourgeoisé, de rester pauvre parmi les pauvres, ou du moins « mineur » : « chacun de nous peut pénétrer le monde de ses propres sensations ; mais seul le voyant, dont l’œil spirituel est ouvert, peut contempler le monde des sensations d’un autre homme. Lorsque l’on n’est pas voyant, on ne connaît le monde des sensations qu’en tant qu’expérience “intérieure” ; quand l’œil spirituel s’est ouvert, le monde caché à l’“intérieur” d’un autre homme se dévoile au regard spirituel objectif. » Si je regarde une toile de Kupka, me voilà peut-être ouvert à la vie organique de l’univers, nu sous le regard de la pierre, de la plante ou de l’animal, non pas me mettant « à la place de tout autre » comme disait Kant mais tout autre se mettant enfin à ma place pour me débarrasser de moi, de mon habitus et du « jeu de destitution ou dégradation réciproque » dont parle Lyotard pour décrire la conception sartrienne des consciences. Me voilà rendu, peut-être, à une humanité également pauvre, c’est-à-dire riche de partage.
Kupka, pionnier de l’abstraction, Grand Palais, Paris jusqu’au 30 juillet 2018.