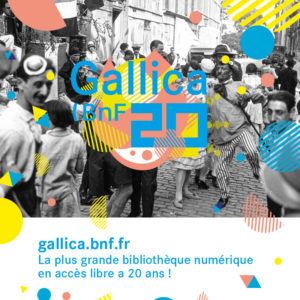Une seconde chance pour les universitaires déplacés ?
Alors qu’en Turquie des milliers d’universitaires sont limogés depuis le coup d’État raté de 2016, les résultats des élections présidentielles turques du 24 juin sonnent le glas de leurs espoirs. Les procès continuent, les purges aussi. Jeudi 28 juin se tiendront 13 procès convoquant les universitaires de Galatasaray, İstanbul, Yıldız, İstanbul Teknik, Arel. La semaine avant l’élection a enregistré un triste record avec 44 procès sur 4 jours.
Ce n’est pas la première fois que des universitaires perdent leurs postes dans l’histoire ou voient leur carrière interrompue par des séismes politiques ou des guerres. Dès la Loi allemande sur la restauration de la fonction publique du 7 avril 1933, les universités ont licencié 614 membres considérés comme non-aryens ou hostiles politiquement. On connaît l’histoire de ces migrations, on connaît la place de l’exil dans les travaux de grands intellectuels contemporains, de Hannah Arendt à Edward Saïd. Norbert Elias, décédé en 1990, une des références importantes de la sociologie contemporaine, a quitté l’Allemagne en 1933. En France il ne parvient pas à trouver un poste. Il travaille dans un magasin de bois. C’est l’Angleterre qui l’accueillera grâce à un comité d’assistance aux réfugiés juifs. Les « academic émigrés » outre-atlantique ou ailleurs en Europe furent pris en charge par des organisations philanthropiques en charge de leur « rescue », qui avaient déjà accueilli en 1919 des étudiants russes fuyant la révolution, puis en 1922 les exilés italiens après la prise du pouvoir par Mussolini. Le fond IIE Scholar Rescue Fund de l’aide « en urgence » existe aux États-Unis depuis cette période.
On a d’abord peu réfléchi à ce qu’il était possible de faire pour faire de la place à ces collègues « en danger » dans leur pays.
Il y a trois ans, en 2015, l’Europe faisait face à la plus grande crise de l’accueil observée depuis la seconde guerre mondiale. Parmi les personnes qui fuyaient les violences du monde et qui cherchaient refuge se trouvaient des réfugiés d’un type particulier, des savants et des scientifiques, des intellectuels et des artistes. Le vingtième siècle a vu passer des vagues migratoires qui charriaient des esprits trop contestataires, on a raconté les passages héroïques, les échecs désespérés, la manière même dont les milieux intellectuels sont devenus cosmopolites et mixtes par la force de ces déportations. On connaît aussi les passeurs, les Varian Fry, et les fondations, les associations qui aidèrent un temps ou un peu plus longtemps.
Pourtant, en 2015, au milieu des débats sur l’accueil, le trop-plein, la crise migratoire et les centres de rétention, on a d’abord peu réfléchi à ce qu’il était possible de faire pour faire de la place, dans les institutions universitaires et culturelles, à ces collègues « en danger » dans leur pays. La création du Programme d’Aide en Urgence aux Scientifiques en Exil (PAUSE) et les recherches qu’il a été nécessaire de faire pour comprendre quels types de dispositifs pouvaient être lancés, ont permis d’élaborer une première démarche comparative et de constater que, parmi les nombreux travaux sur les migrations, l’accueil des « scholars at risk » n’avaient pas fait l’objet d’études et de recherches en France.
Beaucoup de questions restent ouvertes. Que faire et comment accueillir des personnes qui écrivent et publient dans une autre langue et un autre contexte, qui sont exposées et souvent restent « en danger » même dans les mondes de l’exil ? Comment faire en sorte que leur présence en Europe ne soit pas simplement une présence entre parenthèses, qu’elle infuse les mondes intellectuels européens et qu’elle permette des échanges complexes ? Comme l’exemple des années trente l’a montré, leur migration a contribué au développement de nouveaux de domaines sciences sociales ou sciences dures. Par ailleurs, ces étrangers trouvent dans l’exil un lieu à partir duquel ils agissent, témoignent et nous aident à comprendre le monde d’où ils viennent. Les exilés sud-américains, chiliens, brésiliens et argentins notamment, installés durant les années 1970 et 1980, ont été en France des vigies des dérives totalitaires et des observateurs attentifs de nos démocraties. Même lorsqu’ils ne parlaient pas de « chez eux », ils pensaient et agissaient à partir de l’expérience qui les avaient poussés à l’exil. En retour, ils ont permis à la France d’avoir une vision plus fine et plus complexe d’un sous-continent entier.
Quelle place peut-on faire, dans les politiques d’accueil, à un statut qui fait de ces intellectuels des personnes suspendues entre deux lieux, qui ne peuvent « s’intégrer » qu’en intégrant leur combat à leur nouveau lieu de vie ?
Mais cette tribune et cette visibilité ne se sont pas construites d’elles-mêmes. Ces migrants bénéficièrent du soutien continu d’un monde associatif et militant très mobilisé. Des syndicats, des partis et des hommes politiques de gauche prirent fait et cause pour l’accueil de ceux que l’on considérait comme des combattants de la liberté. Ceux-là comme d’autres avant eux intégrèrent l’histoire glorieuse de la science « sans frontière ». Cette histoire obère les effets de la concurrence sur les postes en situation de marché académique saturé, ou les autres récits de l’après-guerre où les scientifiques sont parmi les laissés pour compte de la reconstruction.
Aujourd’hui, il nous faut nous demander : notre accueil est-il avant tout un geste humanitaire pour accueillir une catégorie qui semble déjà favorisée, alors même que l’on connaît la difficile insertion du plus grand nombre ? Comment définir cette catégorie étrange qui fait de quelques-uns des personnes plus « en danger » que d’autres ? Quelle différence y a-t-il entre cet accueil et ce que l’on appelle le « brain drain » et n’espère-t-on pas, en leur offrant des soutiens, enrichir nos universités et nos centres de recherche à peu de frais ? Quelle place peut-on faire, dans les politiques d’accueil, à un statut qui fait de ces intellectuels des personnes suspendues entre deux lieux, qui ne peuvent « s’intégrer » qu’en intégrant leur combat à leur nouveau lieu de vie. L’étanchéité entre ces espaces peut-elle être garantie dans un monde devenu plus poreux, et plus sensible aux circulations des idées et des personnes ?
L’atelier que nous organisons au Centre Marc Bloch de Berlin les 27, 28 et 29 juin 2018 vise à mettre en question les catégories en usage de « endangered scholars / scholars at risk » et à mettre au défi à la fois les politiques à l’oeuvre en Europe et les recherches portant sur ces migrants intellectuels et/ou scientifiques. Il rassemble des universitaires qui portent des regards différents sur cette réalité, qu’ils soient des spécialistes des migrations, des sociologues ou des historiens des intellectuels, ou des universitaires accueillis dans le cadre des dispositifs « at risk » (à parité dans le comité scientifique). Il a pour objectif de consolider les réseaux existant et d’enrichir nos savoirs et nos pratiques pour envisager des espaces de l’exil qui nous concernent tous et soient des lieux d’une réflexion sur le partage et les mondes communs. Il s’agit également, en nous appuyant sur la longue durée et des histoires croisées, de prendre en compte les dynamiques globales et les enjeux de ces migrations d’élites. Dans les débats actuels sur la migration et l’(in)hospitalité en Europe, il est parfois allégué que nos pays choisissent ainsi les « bons » migrants, accroissant la fuite des cerveaux, les plus chanceux dotés de compétences utiles échappant ainsi aux périls des embarcations de fortune en mer.
La catégorie d’universitaires « en danger » désigne des réalités multiples.
Pourtant l’accueil dans les années 1970 des « boat people » montre que des universitaires sont arrivés par les mêmes voies que les autres. Des collègues turcs n’ayant plus de passeport prennent aussi des voies risquées pour fuir leur pays. Les actions de l’État islamique contre le patrimoine en Syrie ne se limitent pas aux objets et aux monuments, elles font des archéologues des cibles de l’éradication du passé comme on l’a vu à Palmyre en août 2015. La catégorie d’universitaires « en danger » désigne des réalités multiples : des personnes qui partagent le sort commun de la fuite en temps de guerre ou de conflits armés, ou qui sont visés spécifiquement comme certaines catégories de la population (intellectuels, artistes, journalistes, syndicalistes, …) aujourd’hui en Turquie, ou hier au Chili, en Uruguay, en Argentine. Les scientifiques et chercheurs de toutes disciplines ne constituent pas un critère d’analyse ni une catégorie au regard du statut de réfugié, à partir du critère de la persécution. Cependant, il peut exister des situations dans lesquelles les scientifiques sont menacés en tant que tels par des États ou des groupes persécuteurs, tels les « intellectuels » (Phu) ciblés par le régime communiste au Vietnam, les médecins menacés en URSS ou les étudiants en Pologne en 1968. Les régimes autoritaires n’aiment généralement pas beaucoup les penseurs libres.
Enfin, la dimension humanitaire de nos pratiques de « secours » des élites intellectuelles peut obscurcir la façon dont les individus accueillis éprouvent leur situation. Elle doit être interrogée alors même que nos collègues se définissent comme membres d’une communauté scientifique globale, et non uniquement comme des intellectuels marginaux « mis en danger » ou « menacés ». Il est de notre devoir d’avancer avec eux pour sortir de cette vision inégale, et de rétablir une histoire à parts égales. Car ce qui est en jeu, c’est aussi une science vraiment transfrontalière et libre.