HATE, Laetitia Dosch : Liberté, Égalité, Animalité
Dans un court texte aux accents désespérés, Stig Dagerman soutenait que « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Si Laetitia Dosch partage ce cri du cœur, elle a pris le parti de la joie malgré tout, cette joie que son prénom annonce déjà comme un étendard. Lutter contre son désespoir dans les grandes lignes et les petits recoins, contre les coups de mou et l’amour qui fait la moue, trouver de la poésie malgré tout, voilà le programme. Dans un monde dépourvu de foi, où la vie est condamnée à une errance absurde vers une mort certaine, où l’on ne nous a légué ni « la fureur bien déguisée du sceptique », ni « les ruses de Sioux du rationaliste ou la candeur ardente de l’athée » (Dagerman), mais bien plutôt un monde desaxé qui nous laisse sans repères auxquels s’arrimer, cela relève d’une forme de courage, sinon naïf, du moins consolateur.
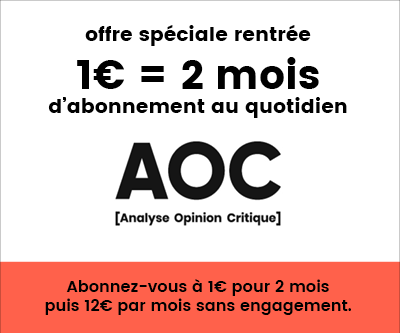
Laetitia Dosch incarnait dernièrement la « jeune femme » éponyme du film de Léonor Serraille : elle tend à représenter cette génération de trentenaires un brin paumées, un pied dans l’adulescence, qui se débattent dans leurs désirs contradictoires, et essayent de trouver un sens dans le tamis de leur existence. Elle regarde autour d’elle, avec l’envie de combattre nihilisme et cynisme, mais rien ne peut repousser le désarroi, qui ne la laisse pas pour autant désarmée : dans HATE, la comédienne brandit une épée, tout à la fois arme et jouet de l’enfant sauvage, pour pourfendre la morosité. Elle trouve surtout du réconfort auprès de Corazón, un cheval doux et tranquille qui l’accompage sur scène dans cette « tentative de duo », elle qui avait préféré les solos dans ces deux précédents spectacles, Laetitia fait péter… et Un album (déjà co-écrit avec Yuval Rozman).
Car avec ce spectacle tout à la fois touchant et casse-gueule, Laetitia Dosch cherche une nouvelle relation à l’autre, et trouve une équité avec l’équidé.
Une scène, un cheval, une femme. Une femme à fleur de peau, peau diaphane, qui devient membrane vibrant aux bruits du monde, une femme qui tombe des nues et se met à nu. On n’en dira pas autant du cheval. Dans une de ses conférences, « L’animal que donc je suis », Jacques Derrida s’interroge, alors qu’il est surpris nu dans sa salle de bain par son chat : « j’ai du mal, oui, du mal à surmonter une gêne », et surtout la gêne de cette gêne, qui nous fait prendre conscience du sentiment de la nudité, dont l’animal est dépourvu. Derrida poursuit : « Il a son point de vue sur moi. Le point de vue de l’autre absolu, et rien ne m’aura jamais tant donné à penser cette altérité absolue du voisin ou du prochain », dans son cas celle du chat, dans celui de Dosch du cheval, redoublée par le point de vue du public.
Car avec ce spectacle tout à la fois touchant et casse-gueule, Laetitia Dosch cherche une nouvelle relation à l’autre, et trouve une équité avec l’équidé. Avec innocence, l’actrice décille les regards par des métaphores qui trouvent leur efficace dans une simplicité enfantine ; racontant à l’oreille de Corazón son passage à Calais, elle prend le détour de l’animal pour nous mettre face à la cruauté des inégalités humaines : « tu vois c’est comme si toi tu mangeais du foin, et Melocotón de la paille… ».
Tout le spectacle ne tient qu’à un fil, et dans ce numéro de funambule, l’équilibriste Dosch risque de basculer dans le ridicule, mais reste à cheval avec le tragique de l’ordinaire. Verbe haut et voix haut perchée, l’actrice n’hésite pas à se risquer à quelques maladresses qui pourront peut-être agacer ; mais, apparaissant dans toute sa béance, elle n’appelle finalement que notre bienveillance. Ce jeu de l’extimité, de la mise en scène de l’intime, souvent dans ses aspects les plus prosaïques, n’atteint le spectateur que lorsque ce dernier sent les failles et les blessures secrètes de l’être humain face à lui. Il reçoit alors ces confessions comme des cadeaux, loin du ballet des masques sociaux de la vie « réelle » : paradoxalement, le théâtre, dans tous ces artifices, devient le lieu d’une sincérité renouvelée où les préoccupations contemporaines nous font rire jaune, un rire jamais loin de la grimace. L’anecdotique déclenche alors des résonances et des reconnaissances, dépassant tout à la fois le voyeurisme et l’indifférence qu’il pourrait sinon entraîner.
Pour démêler l’écheveau de la vie, voici le cheval : le salut viendra de l’animal.
Le style farfelu et singulier de la comédienne, que d’aucuns séquestreraient dans le rôle d’hystérique, se donne à cœur joie dans cette fantaisie équestre qui va à sauts et à gambades, tant dans les genres – le rap dérape, elle époussette la chansonnette, allonge des listes plus terre battue que Prévert – que dans les thèmes : la solitude, l’écologie, la politique…
Tout souligne une forme de honte du monde, de la présence de l’inhumain dans l’humain, de nos manquements à l’avance acceptés et de nos prévisibles repentirs. Que faire alors ?
Pour démêler l’écheveau de la vie, voici le cheval : le salut viendra de l’animal. L’animal, cet être doté du souffle vital, anima, dont l’être humain relève mais dont il a voulu se séparer avec le terme « bête » (bestia), qui renvoie a contrario à une sphère subalterne, alors que cette bestialité même constituerait bien plutôt l’espèce humaine, Laetitia Dosch en fait son compagnon de jeu et de vie. La comédienne en a l’idée lors d’un tournage, à l’été 2016, dans un western fauché au fin fond des États-Unis. C’est dans l’utopie théâtrale qu’elle décide de mettre fin sans tabou à un anthropomorphisme délétère : si les hommes sont si mauvais, autant alors faire un enfant avec un cheval, dit-elle dans sa conversation à corazón ouvert. « Et si l’animal répondait ? » Se déploie alors sur le plateau une relation tendre, ludique, improbable, où le cheval acquiert un « visage » et une voix, comme dans le livre de Wajdi Mouawad, Anima. Le cheval n’est pas un animal de cirque, pas une bête de scène, mais un performeur de théâtre.
À notre époque où la coupure ontologique radicale entre l’homme et l’animal est remise en question, et que la prise en compte de leur souffrance devient une question salutairement pressante – et est in fine probablement la question à se poser à propos des animaux, que pointait déjà Bentham au XVIIIesiècle, soutenant qu’il ne s’agissait pas de se demander « peuvent-ils raisonner » ou « peuvent-ils parler », mais « can they suffer ? » – Laetitia Dosch esquisse des réponses sur de nouvelles manières de se lier aux animaux. Ce lien, sans règne ni de l’homme ni de la bête, se rapproche « des passages, des souverainetés furtives, des occasions, des fuites, des rencontres » défendus par Jean-Christophe Bailly dans Le Versant animal.
Laetitia Dosch configure un univers où se met en place une nouvelle économie de l’attention, du soin entre l’animal et la femme, provisoirement à l’abri du monde et de ceux qui les pourchassent.
Hic et nunc, l’animal au théâtre pose sa présence avec force, impose une prise de risque. Déjà une annonce au micro et des petits papiers distribués à l’entrée de la salle nous en alertent : soyez silencieux, je peux être brusque et saboter le spectacle et ma partenaire de jeu, si vous me perturbez ! Pourtant, durant la performance, c’est plutôt Laetitia Dosch qui tient le rôle du bout-en-train… toujours est-il qu’avoir un animal sur scène, c’est amener quelque chose qui reste, au fond, incontrôlable. Même si la « coach équestre », Judith Zagury, qui refuse le titre de « dresseuse », contradictoire avec sa démarche, n’est jamais loin. Dans son centre, Shanju, elle défend la méthode du clicker training, une « méthode d’apprentissage basée sur le principe de renforcement positif », indique-t-elle dans un entretien, où il s’agit de récompenser un comportement intéressant. Mais l’animal est encouragé à rester disruptif, animé, pour demeurer le compagnon idéal aux improvisations, obligeant sa camarade à une grande écoute et à un sens de l’adaptation, féconds en jeux théâtraux.
HATE apparaît donc comme une petite féérie, mêlant un humour léger et faussement naïf avec un esprit grinçant, un espace de liberté où l’on peut se délester des oripeaux de la civilisation pour l’une, des carcans de la domestication pour l’autre. Amazone moderne, Laetitia Dosch nous convie à sa fantaisie où l’enfance reprend ses droits, où la poésie s’invite avec le sourire, parfois avec cocasserie, pour tenter, un petit moment, d’ « aller mieux ». Tout est possible : courir nue sans pudeur, s’entendre répondre par un cheval, soulever un gros rocher sans problème, dire des grossiéretés indignes de la bouche d’une jeune femme bien mise…
Pourtant, comme cette toile peinte d’un paysage romantique qui délimite la scénographie signée Philippe Quesnes, tout cela relève aussi de l’artifice. Lieu où l’on interroge le monde en en suspendant les règles, le théâtre est aussi caractérisé par un temps et un espace limités. L’homme est « créateur de monde », soutient Heidegger, là où la « pierre est sans monde » et l’ « animal pauvre en monde » ; dans l’utopie théâtrale proposée dans HATE, qui s’avoue comme telle à de nombreuses reprises par des références métathéâtrales, Laetitia Dosch configure un univers où se met en place une nouvelle économie de l’attention, du soin entre l’animal et la femme, provisoirement à l’abri du monde et de ceux qui les pourchassent. Comme l’écrit Jean-Christophe Bailly : « La vérité est qu’un point de solitude est toujours atteint dans le rapport que l’on a avec les animaux. Lorsque ce point s’ouvre en une ligne et que cette ligne s’ouvre en une voûte, alors se forme un abri qui est le lieu en propre où cette solitude rencontre librement ce qui lui répond : un animal aimé. »
Mais le cheval et la femme vont quitter la scène, chacun à sa place : le cheval reprend son licol et ses attaches, la femme ses propres formes de soumission.
Malgré tout, l’image finale, lors du salut, clôt l’ensemble sur l’ouvert, avec une note d’espoir : les animaux, encore quelques instants libres, rejoignent de leur propre chef les humains pour se tenir à leurs côtés. Rêverie, fantasme, douceur : il se dégage de la scène « la sensation d’un accord, d’une possibilité paisible, d’un sursaut alangui du monde en lui-même » (Bailly). Là se tient aussi une forme de politique, un doigt pointé dans une direction où « tout animal est un commencement, un enclenchement, un point d’animation et d’intensité, une résistance » : liberté, égalité, animalité.
HATE de Laetitia Dosch,
Nanterre-Amandiers, du 15 au 23 septembre 2018-09-17
Les 26 et 27 septembre 2018 : Festival Actoral au Théâtre du Gymnase, Marseille
Du 16 au 20 octobre : TNB, Rennes.
Les 30 novembre et 1erdécembre : festival Next à la Rose des vents – Scène nationale de Lille métropole, Lille.
Du 16 au 18 janvier 2019 : Bonlieu, Scène nationale d’Annecy.
Les 15 et 16 février 2019 : TPR, La Chaud-de-Fonds (Suisse).
Les 7 mars et 8 mars 2019 : Le Quai, CDN Angers.
Du 13 au 16 mars 2019 : Sortie Ouest, Béziers.
Les 16 et 17 mai 2019 : MA – Scène nationale de Montbéliard.
Les 5 et 6 juin 2019 : Tandern, Scène nationale de Douai.
