Penser l’extrême droite en Allemagne de l’Est : de la contestation du communisme à la peur de l’étranger
Une fois passée l’émotion politico-médiatique autour de la Saxe et plus précisément de la ville de Chemnitz érigée en « épicentre de l’extrême droite », il faut prendre le temps de poser le problème de la radicalisation politique en Allemagne de l’Est en la contextualisant davantage dans le temps long. Une telle perspective ne vise pas à établir de manière déterministe une ligne de causalité directe entre un passé est-allemand et le temps présent. Elle offre par contre la possibilité de penser la complexité de ce phénomène.
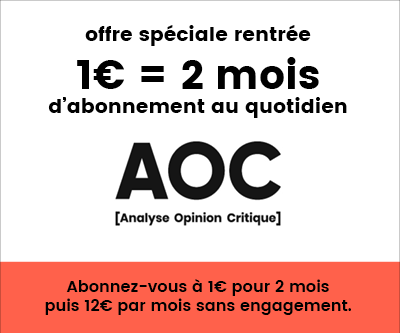
La plupart des journalistes et des « experts » mobilisés pour expliquer cette flambée de violence extrême la qualifient de « phénomène assez ancien (sic) postérieur aux années de la Réunification. » En clair, les conséquences socio-économiques de la révolution néolibérale en Allemagne de l’Est sont présentées comme la principale clé d’explication à l’épanouissement des idées d’extrême-droite.
Le nez collé à l’écume de l’actualité, ces spécialistes omettent trop souvent d’inclure dans leur analyse une dimension historique double. D’une part, l’Allemagne de l’Est a connu de manière quasi continue un régime de dictature entre 1933 et 1989, ce qui se traduit par une absence sur la longue durée d’une expérience de l’État de droit et de la culture démocratique ; d’autre part, la RDA a produit une culture d’extrême-droite dans les années 1970 et 1980.
Bref, il est impératif de réinscrire l’actualité de l’extrême-droite allemande en Allemagne de l’Est dans une histoire de moyenne durée. Il ne s’agit évidemment pas de disqualifier les facteurs liés aux conséquences de la Réunification mais de montrer comment un certain héritage est-allemand a constitué le socle d’un sentiment croissant d’insécurité parmi de nombreux citoyens d’Allemagne de l’Est.
L’extrême droite à l’ombre de l’État antifasciste
Depuis sa fondation en 1949, la RDA s’est toujours définie comme la « bonne Allemagne » : celle des universalistes humanistes (Goethe et Schiller), des socialistes internationalistes (Marx et Engels) et des combattants antifascistes (Thälmann, Beimler). Dans le cadre d’une dictature dominée par le parti socialiste unifié, le SED, les communistes ont imposé une mémoire historique et une culture politique reposant sur l’internationalisme prolétarien et la solidarité entre les « peuples frères ». Se présentant comme un modèle aux antipodes de celui de la RFA, le régime est-allemand dénonçait le racisme, le chauvinisme et le nationalisme qu’elle prétendait avoir extirpé par un processus radical de dénazification. Dans le discours public, tous les Allemands de l’Est étaient présentés comme des résistants au nazisme et se trouvaient ainsi rangés du côté des « vainqueurs de l’Histoire ».
Pourtant à l’abri du Mur de Berlin, une culture politique d’extrême droite s’est développée dans les interstices de l’espace public étroitement contrôlé par les organes de sécurité du régime communiste, la Stasi en tête. Elle se définissait avant tout comme une culture de la provocation et de la transgression, un levier permettant de critiquer le régime communiste. Elle s’est tout particulièrement implantée dans les stades de football à partir du début des années 1980. Des slogans et des chants néo-nazis étaient proférés dans les enceintes de Berlin-Est (« Donnez du Zyklon B au BFC »), Dresde, Leipzig ou Karl-Marx-Stadt. Des supporters étaient en contact avec leurs homologues d’Allemagne de l’Ouest eux-mêmes infiltrés par l’extrême droite dans le bassin de la Ruhr. Dans le dossier de surveillance d’un fan du Lokomotiv Leipzig en 1983, la Stasi a intercepté une lettre écrite à des supporters ouest-allemands et dans laquelle le fan en question présentait Leipzig comme « la ville de foires du Reich » et annonçait qu’il arborait au stade une veste portant l’inscription « J’aime l’Afrique du Sud ».
Le milieu des supporters infiltré par le mouvement skinhead était un lieu propice à la diffusion d’idées racistes et nationalistes qui étaient instrumentalisées pour critiquer le régime communiste. La violence débordait des stades et des attaques (contre des étrangers, des homosexuels, des Juifs, des Punks) se multipliaient dans l’espace public. Ces comportements qualifiés dans le jargon de la Stasi de « négatifs et décadents » étaient pris très au sérieux et faisaient l’objet de nombreuses opérations de surveillance et d’infiltration. Simplement, le cadre d’analyse des tchékistes est-allemands était erroné : ces violences étaient perçues comme des actes de « sabotage politico-idéologique » orchestrés par l’Ouest fasciste, impérialiste et capitaliste. Les organes de sécurité étaient incapables de penser que l’extrême droite est-allemande était la manifestation d’une culture endogène qui se diffusait dans le milieu des classes ouvrières bien intégrées dans le régime au sein des organisations de masse et des collectifs de travailleurs dans les entreprises. Dès l’époque de la RDA, ce milieu n’était pas constitué de marginaux sociaux.
Le régime communiste ne communiquait évidemment pas sur ce sujet. Officiellement, la culture d’extrême droite avait été éradiquée au début des années 1950 avec la construction du socialisme. Le 7 octobre 1989, quelques semaines avant la chute du Mur, le leader communiste est-allemand Erich Honecker était fier de commémorer le 40e anniversaire de la RDA en rappelant que celle-ci avait fait « ses preuves à la frontière occidentale des pays socialistes en Europe de sa capacité à fonctionner comme un brise-lames contre le néonazisme et le chauvinisme. »
L’Étranger : une figure abstraite et menaçante
Dans le même temps, à la différence de l’Allemagne de l’Ouest, la société est-allemande n’a jamais fait l’expérience du multiculturalisme et du contact avec les étrangers. Le fossé était énorme entre d’une part le discours officiel sur l’internationalisme prolétarien et la méfiance voire la persistance d’un racisme latent d’une partie de la population est-allemande qui est restée pendant quarante ans homogène sur le plan ethnique.
À la fin des années 1980, environ 200 000 étrangers étaient installés en RDA de manière temporaire (travailleurs sous contrat, étudiants) ou durable (réfugiés politiques). Depuis sa création, la RDA aimait se présenter comme la terre d’accueil de tous les réfugiés politiques socialistes (Espagne, Grèce, Chili) et comme un pays ouvert sur le monde. Il n’en reste pas moins que ces étrangers, qu’ils soient étudiants ou travailleurs invités, étaient rarement mis en contact avec la société est-allemande. Les travailleurs algériens, mozambicains ou vietnamiens invités (environ 90 000 en 1989) étaient placés dans les grands centres industriels de la RDA : Berlin-Est, Dresde, Hall, Leipzig et Karl-Marx-Stadt. Ils travaillaient de manière séparée au sein des entreprises d’État et ils vivaient dans des immeubles distincts du reste de la population. Ils n’étaient pas autorisés à participer à la vie socio-politique encadrée par les organisations de masse. Si une femme étrangère tombait enceinte, son contrat de travail était rompu et elle était renvoyée dans son pays d’origine.
1990 ou l’entrée dans une ère d’insécurité
La Réunification a constitué un choc à la fois structurel et personnel, une césure biographique parfois violente pour de nombreux Allemands de l’Est. Elle a certes produit des « gagnants » en favorisant l’épanouissement de nombreuses personnes qui se sentaient à l’étroit dans la dictature communiste. Mais elle a aussi produit beaucoup de « perdants », notamment parmi la classe ouvrière qui connut un profond processus de prolétarisation et de délégitimation à la fois socio-professionnelle et « culturelle ». De nombreux Allemands de l’Est avaient le sentiment d’être considérés comme des « citoyens de seconde zone ».
Par sa double dimension néo-libérale et « néo-coloniale », la Réunification a ouvert une fenêtre d’opportunité pour que les mouvements d’extrême droite apparaissent au grand jour, soit sous la forme d’actions violentes contre des foyers d’immigrés, soit sous une forme institutionnelle à travers des partis politiques présents dans les Parlements régionaux (Brandebourg, Saxe…)
Cette entrée dans l’ère de l’insécurité se combina avec la persistance d’une culture de la méfiance pour tout ce qui venait de l’État et pour la figure souvent fantasmée de l’Étranger, très peu présent dans cette partie orientale de l’Allemagne. Entre 1991 et 2013, environ deux millions de personnes ont « émigré » vers l’Allemagne de l’Ouest. De nombreux territoires en Saxe, en Thuringe et dans le sud du Brandebourg ont connu une véritable saignée démographique. Dans ces régions désertifiées, où les habitants se sentent abandonnés par l’État, la « crise des réfugiés », à travers les médias, est vécue comme un nouveau choc.
2015 ou le choc de l’insécurité globale
Vingt-cinq après la Réunification, de nombreux Allemands de l’Est eurent l’impression de vivre un second choc émotionnel très fort avec l’accueil en Allemagne de centaines de milliers de réfugiés. Le choc n’était pas de nature social mais il relevait d’une dynamique globale qui était présentée par les mouvements populistes et d’extrême droite comme une sorte de vague submersive. Au final, même si les nouveaux Bundesländer ne concentrent que 5% des personnes d’origine étrangère, la « crise des réfugiés » contribua à renforcer ce sentiment d’insécurité. La figure de l’Étranger, omniprésente dans les médias, a servi de catalyseur à des mouvements populistes.
Ces derniers ne font pas confiance à l’État de droit et à la culture du dialogue démocratique pour trouver des solutions raisonnables. Ils instrumentalisent l’émotion produite par les médias et investissent l’espace public en reproduisant le modèle des mouvements citoyens de l’automne 1989. Un slogan permet d’illustrer la manière dont ces mouvements instrumentalisent la notion de Peuple. En 1989, des centaines de milliers d’Allemands de l’Est surmontaient leur peur du régime et descendirent dans les rues au cri de « Wir sind das Volk » (« Nous sommes le peuple »). Le Peuple renvoyait ici au Demos, à ce corps des citoyens égaux en droits, indépendamment de leur origine sociale ou ethnique. Vingt-cinq ans plus tard, le Peuple dans le langage de Pegida ou de l’AfD renvoie à une vision ethno-raciste d’une communauté homogène fermée à tout mélange et à toute ouverture sur le monde extérieur.
Une partie des Allemands de l’Est a peur et jusqu’à présent, ni la droite chrétienne-démocrate humaniste, ni la gauche sociale-démocrate internationaliste n’ont trouvé de réponse à même de calmer ce sentiment d’insécurité. L’Allemagne doit faire un examen critique de sa révolution néo-libérale et repenser un modèle social apportant la sécurité à ses concitoyens. Elle ne le peut faire seule mais en articulation avec un projet européen renouvelé, capable lui aussi de produire davantage de sécurité à la fois socio-économique et géopolitique. Le chantier est immense et de longue haleine.
