La chercheuse de traces – sur Où vivre de Carole Zalberg
Après chaque acte antisémite en France, depuis plusieurs années, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu appelle les juifs d’Europe à émigrer en masse vers Israël. Un mois après la prise d’otages de l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes, en 2015, il avait ainsi réaffirmé qu’Israël accueillerait tous les juifs d’Europe « les bras ouverts ». « Nous disons aux juifs, à nos frères et sœurs : Israël est votre maison et celle de chaque juif ». Ces appels, répétés, s’ils sont favorablement accueillis par une partie de la communauté juive, en irritent profondément une autre. Un des motifs à la fois politiques et moraux les plus souvent invoqués à cet égard, est l’attachement foncier à la France, terre républicaine, où a pu fleurir depuis la Révolution française, cette identité juive si particulière et aujourd’hui un peu oubliée qui a porté le nom d”’israélitisme”, promesse républicaine par excellence d’émancipation et d’assimilation non destructrice.
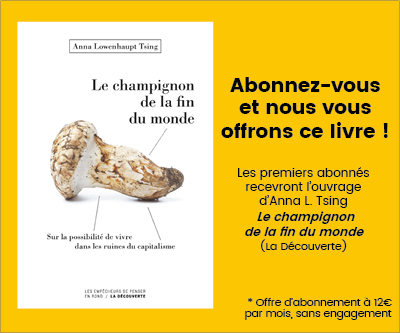
La Seconde Guerre mondiale, qui offre son arrière-plan aux extraordinaires histoires de vie que Carole Zalberg a recueillies, marque une cassure irrémédiable avec ce monde des juifs français d’autrefois. Désormais, la question de savoir, à chaque attentat, à chaque pourrissement de la vie civile et politique, s’il faut partir ou pas, ce qui est la question du rapport difficile de ceux qui sont partis à ceux qui ne sont pas partis, et de ceux qui ne sont pas partis à ceux qui le sont, se pose à chaque fois en des termes plus cruels, plus culpabilisants, jusqu’à paralyser la réflexion. Elle agite ainsi et divise profondément la communauté juive en France depuis la création de l’État d’Israël, plus précisément depuis 1950, soit deux ans après la proclamation d’indépendance, puisque la loi du retour stipule que « tout juif (né d’une mère juive ou convertie au judaïsme et qui ne pratique pas une autre religion) a le droit d’émigrer en Israël ».
Sans point d’interrogation
Il y a, en littérature, bien des façons de s’y confronter. L’une consiste à montrer les formes contemporaines du mal à l’œuvre en Israël de façon totalement dépsychologisée, et c’est ce que font des auteurs comme Etgar Keret, ou l’auteur arabe israélien Sayed Kashua, qui écrit en hébreu mais a quitté Israël avant l’opération à Gaza en 2014 pour partir s’installer aux États-Unis. Une autre s’emploie à tenir le mal à distance en utilisant la littérature comme point de suture humaniste et formel face à la détresse existentielle dans laquelle nous jette la violence du monde. C’est le pari de Carole Zalberg qui publie en cette rentrée, Où vivre (Grasset) un objet un peu étrange, ne serait-ce que par son titre sans point d’interrogation, et tant il s’affranchit de questions extrêmement polémiques, mais assurément délicat, poétique et sensible.
Les lecteurs familiers de la Trilogie des tombeaux (La mère horizontale, 2008, Et qu’on m’emporte, 2009, A défaut d’Amérique, 2012) de Carole Zalberg ne s’étonneront pas. Cette fois-ci, cela commence encore par quelque chose qui ressemble à une agonie, étrangement christique. « Compter ses os en silence, le corps cloué en croix sur un lit raide. Égrener le chapelet de ce qui fait mal, de ce qui est entravé. Tout ?! Dans la mâchoire barbelée combien de dents manquantes ? La langue, non, elle s’écorche au métal, elle est là. » En fait, Noam percuté de plein fouet par une voiture en Israël, où il venait de revenir, après un long exil aux États-Unis pour y mener la grande vie, exil jalousé tout autant que vu comme une trahison par ses proches, survivra. Mais piteusement. Il nageait dans le bonheur, sa réussite « effaçant presque sa culpabilité, sa honte ancienne » d’avoir déserté l’armée « et ce pays dont elle est devenue l’identité ». Le voilà immobilisé « dans une impuissance pâteuse, tout emmailloté des paroles et des » voix de sa mère, de sa tante, et de ses frères venus se relayer à son chevet, à l’endroit même qu’il avait fui.
Si c’est bien Noam, le déserteur, l’exilé, le fils prodigue, qui se retrouve sur un lit d’hôpital, celle qui parle pour lui, et qui, d’une certaine façon, lui rend sa voix, est absente de la scène : c’est sa cousine Marie, nouveau prénom lui aussi étrangement chrétien, parisienne, née en France en 1960, d’une mère qui fut une enfant cachée pendant la guerre mais ne voulut pas partir en Israël, Anna (la mère de Marie dans les Évangiles). Longtemps, Marie, double fictionnel de l’auteure, s’est trouvée embarrassée par « la rudesse des Israéliens et l’omniprésence des uniformes et des armes ». Mais voilà que le corps brisé, presque morcelé, de son cousin accidenté devient soudain le lieu même des guerres et des paradoxes d’une famille à jamais hantée par la Shoah qui, sur cette question-là, comme sur bien d’autres, l’amour, le désir, la maternité, ce qu’est une vie réussie, n’a jamais parlé d’une seule et même voix.
S’ouvre alors un roman polyphonique, où Marie s’efface pour donner la parole aux exilés, et à celles qu’on devrait appeler les exilées de l’exil, les vivants comme les morts se parlant et se répondant. Si quelques événements historiques sont mentionnés dans ces récits – la guerre du Kippour, l’assassinat d’Anouar el-Sadate en octobre 1981, celui du Premier ministre israélien, Yitzhak Rabin, le 4 novembre 1995, par un extrémiste juif, les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis perpétrés par Al-Qaïda – c’est bien du quotidien de la branche israélienne comme de la famille restée en France, dont il est question ici.
Tombeaux d’encre et papier
Cette thématique de l’exil, de la filiation et de la recherche d’une terre d’accueil, on la retrouve comme un fil conducteur dans bien des romans de Carole Zalberg. Chez eux (Phébus, 2004) raconte l’histoire romancée de la mère de l’écrivaine, contrainte de fuir la Pologne alors qu’elle n’avait que six ans et cachée, sous un faux nom, chez des paysans de la Haute-Loire pendant la guerre. A défaut d’Amérique (Actes Sud, 2012) retrace, à travers les voix de deux femmes puissantes, le destin de leur aïeule, Adèle, qui survécut à l’exil et à deux guerres mondiales. Feu pour feu (Actes Sud, 2014), suit l’errance d’un père contraint de quitter son pays d’Afrique dans une embarcation de fortune, après un massacre dont il n’échappe que parce qu’il a fait le cadavre au milieu des cadavres, et de sa fille, qui un jour de désarroi, met le feu aux boîtes aux lettres d’un immeuble de sa cité.
Carole Zalberg vient d’une famille juive polonaise exilée en France au moment de la Seconde Guerre mondiale. Elle n’a pas mis les pieds en Israël pendant trente ans. Ce n’est qu’en 2015, à la faveur d’une bourse Stendhal de l’Institut Français, qu’elle s’est décidée à revenir sur les lieux qui n’étaient jusqu’à lors que ceux de ses vacances d’enfance, des vacances dont elle revenait toujours embarrassée, comme on l’est d’un « vêtement trop lourd » qu’on est obligé de porter.. Pour écrire Où vivre, il lui en a fallu d’abord passer par l’écriture de son journal de voyage en Israël, publié sous le titre À la trace. Comme s’il fallait d’abord déposer la trace de ce réel trop encombrant dans un tombeau d’encre et de papier, pour pouvoir ensuite, s’en affranchir et s’attacher, uniquement, dans Où vivre, au travail de la langue, puissante, et à la peinture, la plus juste en même temps que la plus chatoyante possible, des émotions complexes, paradoxales, des exilés.
Dans Où Vivre, Carole Zalberg reprend un procédé cher à Faulkner dans Tandis que j’agonise, celui du flux de conscience de narrateurs multiples, dont les noms composent les titres de chapitres, de longueur et de style variables. Or, ce qui frappe, ici, c’est la position de celle qui s’efface en racontant et comment on l’entend, d’autant plus, comme écrivain, parce qu’elle s’est effacée en racontant. Si le roman est tout entier centré sur les histoires de ceux qui sont partis, Lena, son mari Joachim, leurs parents, mais aussi leurs enfants Elie, Dov, et Noam, c’est bien à celles qui sont restées, Anna et sa fille Marie, que l’on pense, puisque, par leur choix de rester en France, elles se retrouvent, elles-mêmes, exilées d’une famille dont on comprend que, pour vivre leurs vies de femmes, et s’autonomiser, elles n’ont pas souhaité épouser les codes.
Cependant, si quelques chapitres sont précédés de l’en-tête, « Marie », jamais Marie ne parle frontalement, au présent, de ce qui a lieu en Israël. La possibilité de raconter ce qui se passe « ici » est vue depuis un « là-bas », même quand Marie décide de se rendre sur place. Pour la narratrice, parler d’Israël est soit envisagé sous le mode de la négativité « qui suis-je pour avoir une opinion, moi qui n’ai pas remis les pieds ici depuis si longtemps » ; soit de biais (Comme chez Faulkner, encore, où c’est toujours un autre qui dit pour soi : « Peut-être que nous n’étions pas faits pour avoir un État, à nous, après tout. Voilà ce que me confie, à voix basse, comme pour elle-même, ma tante assise sous la pergola devant sa maison inchangée depuis ma dernière visite, trente ans auparavant. »), soit, enfin, évoqué au futur : « Je dirai ce que je découvre et comprends ici […] mon soulagement d’avoir une famille ”du bon côté” : celui de l’esprit critique et de la volonté de paix […] Et je ne dissimulerai pas ce qui se refuse à mon esprit forgé trop loin de cette société complexe […] Et je dirai, Anna, ma mère, que ta sœur et toi n’avez jamais été séparées, que nous tous, finalement, sur nos radeaux entraînés par le courant, vivons les heurts, malheurs et beautés d’une seule et même vie, enracinée dans la perte et tendue vers l’embellie. »
Nous sommes des grands cimetières flottants. Les voix de nos morts affleurent dans chacun de nos choix, chacune de nos tristesses, chacune de nos joies. Il arrive que ces voix nous étouffent. On en fait alors une maladie, qui peut s’avérer mortelle. Il arrive aussi qu’elles nous fassent voguer sur des « radeaux entraînés par le courant » où nos malheurs se changent en félicité, nos vulnérabilités en liberté, jusqu’à une terre qui n’existe que dans les songes, où une rue de Paris devient une chambre d’hôpital à Tel Aviv, et deux sœurs séparées se retrouvent, enfin, dans l’éclair blanc d’une page qui se tourne.
